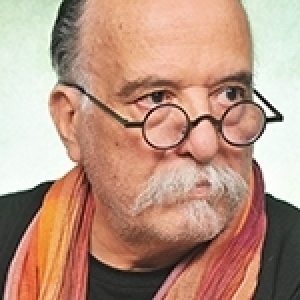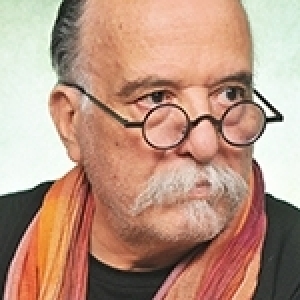Mansour Moalla: A la recherche d’un «pouvoir» rationnel et efficace

Depuis l’indépendance, le 20 mars 1956, la Tunisie est à la recherche d’un système de gouvernement cohérent et efficace. Le système présidentiel choisi dès le départ par Bourguiba prouvera rapidement son inefficacité. Le pouvoir est détenu théoriquement par le président.
Ce dernier l’exercera efficacement les premières années jusqu’au début des années 1960. Auréolé de la victoire de l’indépendance et de son prestige immense de chef du mouvement national et d’artisan de l’indépendance, il parviendra à entreprendre une série de réformes essentielles concernant la restauration de la souveraineté nationale et la modernisation de la société tunisienne.
Le problème économique et la défaillance du pouvoir
L’essentiel dans ce domaine ayant été réalisé, il devait affronter le problème économique et financier relatif au développement du pays. Il est conscient de l’importance de ce secteur et se met à la recherche d’un collaborateur qui puisse le prendre en charge. Il finit par désigner un syndicaliste, Ben Salah, qui choisira de s’y lancer pour parvenir au pouvoir, la voie politique étant encombrée. Son ignorance en la matière, l’aventure de la généralisation du système coopératif vont se traduire par une première et grande défaillance du pouvoir, détenu par le président mais exercé en fait par son ministre : les deux vont en souffrir, le premier en arrêtant et en traduisant en justice son ministre qui, condamné, réussira à «fuir» et à s’exiler de longues années. La conséquence logique de ce premier et grand échec du pouvoir aurait été normalement la démission des deux responsables, aussi étroitement impliqués l’un que l’autre, l’organisation de nouvelles élections et l’établissement d’un gouvernement mieux organisé et plus efficace.
Les années 1970 : de nouveau la défaillance du pouvoir
On continuera avec le même système durant les années 1970, la seconde décennie, avec quelques retouches. Ce n’est plus un ministre détenant un grand nombre de départements qui gouverne mais un Premier ministre, Hédi Nouira, nommé par le président. Il exercera ses fonctions convenablement jusqu’au jour où il entrera en conflit avec Bourguiba qui, entraîné par Masmoudi, signera dans la précipitation l’accord d’union avec la Libye, union qui aurait pu être une idée de génie mais qui a été victime d’un système de gouvernement incohérent, l’accord d’union ayant eu lieu en l’absence du Premier ministre, qui, ainsi humilié, s’acharnera à effacer toute trace de cette union après avoir exigé le départ de son rival, ministre des Affaires étrangères.
La dégradation du système de gouvernance se poursuivra durant les années 1975-1980 : Nouira, le plus concerné par la succession du chef de l’Etat, ne pourra qu’accepter la nomination de Bourguiba, président à vie, ce qui est la négation de la république. Cela ne lui servira à rien, il quittera la scène après l’aggravation de la tension avec la Libye, et le «coup de Gafsa». La preuve est faite que la Tunisie était mal gouvernée, et on peut même dire qu’elle ne l’était pas.
L’ultime défaillance du pouvoir : vers la dictature et la révolution
Une réaction s’imposait. Un gouvernement de « salut public » a été constitué, dirigé par Mohamed Mzali, et comprenant des ministres expérimentés. Quelques mois d’activités sérieuses
et un espoir de redressement qui, de nouveau, sombrera sous les coups de la lutte pour la succession, Mzali ayant remplacé Nouira à la tête de ce «combat» douteux. Le nouveau Premier ministre acceptera, pour se maintenir, le «truquage» des élections de 1982 : il ne sera plus question de salut public, le pouvoir traînera, subissant les « émeutes du pain » en janvier 1984, le bombardement par Israël du quartier général de l’OLP à Hammam-Chatt en 1985. Mzali est limogé en juillet 1986 et se réfugiera le 3 septembre à l’étranger. Une telle confusion s’achèvera par l’entrée en scène du «général» Ben Ali, deux fois expédié au Maroc et en Pologne comme «diplomate» pour incapacité et soupçon de complicité avec l’organisateur du «coup de Gafsa». Les clans politiques qui ont accaparé le pouvoir sous Bourguiba, effrayés par l’état de sa santé, ont jeté leur dévolu sur Ben Ali, supposé des leurs, pour éviter toute surprise.
L’ancien «caporal» commencera par «destituer» Bourguiba le 7 novembre 1987, et se présentera au pays avec beaucoup de promesses. Il trompera l’opinion et installera une dictature mafieuse sous le couvert d’un régime présidentiel et d’élections à plus de 90%. Les excès en tous genres commis durant cette période finiront par déclencher la révolution en décembre 2010. Ben Ali prendra la fuite et se réfugiera au Moyen-Orient.
La révolution et le pouvoir: l’espoir
La Tunisie connaîtra après la révolution une période confuse de 4 années, dominée par l’accaparement de la scène politique par le parti islamiste et ses alliés « démocrates ». Cet accaparement traduisait une volonté envahissante « d’islamiser » le pays, comme si ce dernier était habité par des chrétiens ou athées depuis plus de 15 siècles, d’où la précipitation avec laquelle ils ont entrepris l’envahissement de l’Etat et la dislocation de la société, provoquant ainsi la dégradation du pouvoir et la naissance et le développement du terrorisme.
Ces excès entraîneront une réaction salutaire de la société civile, où la femme tunisienne, plus particulièrement visée par les excès islamistes, a joué un rôle prédominant. Le gouvernement a fini par céder, et a été obligé d’accélérer la rédaction de la constitution qui a traîné deux ans, alors qu’elle devait être légalement établie au bout d’un an, l’accaparement du pouvoir étant plus important que la constitution. Des élections législatives et présidentielle organisées par un gouvernement indépendant de technocrates dirigé par Mehdi Jomaa auront lieu en 2014.
La Tunisie est, depuis le début de cette année 2015, dirigée par un gouvernement légitime comprenant un président de la République élu au suffrage universel et un gouvernement dirigé par un chef de gouvernement, Premier ministre, désigné par le Président et bénéficiant de la confiance du Parlement, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).
Le pouvoir ainsi constitué va-t-il pouvoir faire face à la situation ? Une première et grande fragilité peut constituer un handicap sérieux. En effet, aucun des deux partis dominants composant l’Assemblée ne détient la majorité absolue lui permettant d’appliquer ses programmes. Il manquait au premier des deux partis (Nida Tounes) vingt à trente voix pour atteindre cette majorité et gouverner. Il a préféré une alliance avec le second (Ennahdha) pour bénéficier d’une large majorité et pouvoir agir sans « opposition » importante.
Alliance et union nationale
Cette alliance n’est pas sans poser un problème sérieux. Une alliance symbolisant «l’union nationale» est la bienvenue dans les circonstances actuelles, encore faut-il qu’elle remplisse certaines conditions. Elle doit être conclue avant les élections au vu d’un programme établi d’un commun accord. Cela n’a pas été le cas. Les deux partis concernés se sont livrés à une bataille électorale sévère jusqu’au dernier instant. Les électeurs ont donc eu à trancher entre deux programmes, deux doctrines, deux orientations différentes et opposées.
On peut concevoir l’établissement d’une alliance et d’une union nationale après les élections, encore faut-il prendre le temps pour le faire, et créer les conditions pour y parvenir, le parti le plus majoritaire (Nida) décidant de gouverner avec les autres partis, et le parti le moins majoritaire (Ennahdha) acceptant de le soutenir et de s’engager dans la discussion sur l’orientation et le programme commun à établir pour réussi une alliance et une union nationale viable et durable. Cela n’a pas été le cas. On a adopté une solution équivoque, peu claire, fragile et non durable qui fait participer Ennahdha «symboliquement» au gouvernement. Ce qui laisse la porte ouverte à une «opposition» intérieure qui ne dit pas son nom, et une action indépendante de chacun des deux «partenaires», ce qui diminue la crédibilité et l’efficacité d’une telle alliance, qui a un objectif propre à chaque allié : Nida Tounes pour éviter une opposition déclarée et gouverner en paix, et Ennahdha pour éviter des évolutions similaires à celles adoptées au Caire.
Les conditions d’une union nationale durable et efficace
Il y a lieu donc aujourd’hui, si l’on veut réellement instituer une union nationale durable, d’engager un processus clair pour y aboutir. Il n’est jamais trop tard pour bien faire. La présence «symbolique» d’Ennahdha au gouvernement peut y contribuer. En contrepartie de cette participation aux «affaires», Ennahdha doit oeuvrer à la définition d’une nouvelle orientation générale lui permettant de devenir un parti politique au sens plein du terme dont la préoccupation essentielle concerne la gestion des affaires publiques et permettant aux citoyens de décider librement de leurs rapports avec la foi et la religion: cesser donc d’exploiter la religion à des fins politiques. L’islam politique n’est pas viable et n’est pas vivable. Il fait des dégâts énormes, surtout dans les pays arabes. Un parti islamique ne peut que rester isolé et dépérir comme cela se passe déjà là où il a existé ou existe encore. Il subira le sort des partis doctrinaires : il n’y a plus de parti communiste au pouvoir, sauf peut-être encore en Chine, et il se fait plus discret.
L’islam politique est un danger pour le pays. Il a provoqué la persécution des islamistes, laquelle a conduit à la restriction des libertés, le durcissement de la dictature et le renforcement de la corruption. Il constitue un excès et ne peut qu’entraîner d’autres excès. C’est le pays qui va en souffrir.
Si donc les orientations générales des deux forces existantes parvenaient à se rejoindre grâce à leurs congrès attendus pour la fin de l’année 2015, on pourra alors procéder à une union nationale sincère et à une alliance efficace dont le pays a aujourd’hui besoin pour sortir de la situation actuelle qui est loin d’être réconfortante.
Tenir les promesses électorales
Si cette union se révèle impossible, le parti majoritaire (Nida) doit prendre ses responsabilités et gouverner. Les citoyens qui ont voté pour lui, au vu de ses objectifs, et dont je fais partie, se considéreront
comme trompés, sinon «trahis», s’il se dérobe à sa mission. Il risque de se disloquer s’il se contente de «régner».
S’il gouverne bien, une majorité confortable se créera autour de lui. Ennahdha se retirera dans l’opposition. Une opposition «civilisée» est indispensable pour un gouvernement efficace. Sans une telle opposition, on aura tendance à «s’endormir». On pourra ainsi avoir un gouvernement démocratique et efficace.
Cette efficacité restera cependant tributaire d’une réforme constitutionnelle supprimant la dualité du pouvoir exécutif. La constitution actuelle a «partagé» le pouvoir exécutif entre le président élu au suffrage universel et le «président» du gouvernement. Ce «partage» est impraticable comme je l’ai expliqué il y a deux ans dans le numéro de la revue Leaders du mois de juin 2012, page 24.
Ce système reproduit celui établi par la constitution française actuellement en vigueur et constitue le produit d’une évolution historique propre à la France, où un régime parlementaire «anarchique» a été «redressé» par l’élection d’un président (de Gaulle) élu au suffrage universel. Le conflit entre ce président et le chef du gouvernement (Pompidou en dernier lieu) a contribué à l’échec du système.
Pour qu’il puisse continuer à fonctionner, on a été obligé d’unifier la durée des deux mandats à 5 ans, celle de la présidence ayant été alignée sur celle du parlement (5 ans au lieu de 7 ans). La dernière élection présidentielle (celle de Hollande) a précédé l’élection législative, ce qui a permis d’avoir la même majorité. Le régime est devenu ainsi, en pratique, un régime présidentiel, le «gouvernement» devenant en fait un simple secrétariat du président : on a ainsi supprimé en fait la dualité du pouvoir exécutif qui s’était révélé impraticable. Du reste, le cas de la France est isolé en Europe où l’élection du président au suffrage universel n’existe plus. Le chef de l’Etat (le roi ou le président) est désigné par le statut de la monarchie (Grande-Bretagne…) ou par le parlement (Allemagne). De toute façon, même si le président est élu au suffrage universel (pour lui conférer plus d’autorité) comme en Finlande, il exerce un rôle d’arbitre et de recours et ne participe pas à la gestion des affaires courantes, ce qui sauvegarde son crédit, préserve son autorité morale et renforce sa mission essentielle, la sauvegarde de l’Etat, le respect de la constitution, la stabilité du pays et le renforcement de la cohésion sociale. Etant élu pour 5 ans et ne pouvant être révoqué, il est donc incontrôlable et il n’est pas indiqué de lui confier des pouvoirs de gestion qui peuvent le discréditer en cas de contestation et d’échec, ce qui lui enlève sa capacité de «dernier recours».
Il y a lieu donc, après la sortie du « provisoire » et l’établissement de la constitution, de rétablir l’unicité du pouvoir exécutif, de renforcer le rôle du parlement et du gouvernement dont le chef est appelé à gérer les affaires du pays et de redonner au chef de l’Etat la mission essentielle de respect de la constitution et de la défense des institutions républicaines.
La Tunisie a échappé au désordre total provoqué ici et là par les révolutions et les insurrections. Elle doit asseoir ses institutions pour éviter le retour aux régimes autoritaires qui ont mal fini et ont empêché le pays d’avancer et de parvenir à un développement aussi important que celui enregistré dans les pays devenus indépendants à la même époque comme la Corée et la Malaisie par exemple.n
Mansour Moalla
- Ecrire un commentaire
- Commenter

j'ai noté deux phrases importantes et inhabituel : gouverner selon le programme électif consolider et fixer mieux les rôles des institutions

.png)