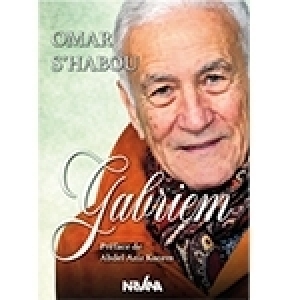Ahmed 1er le bey réformateur et ses sujets

.jpg) Par Mohamed-El Aziz Ben Achour - En Tunisie beylicale, comme dans tous les pays où durant des siècles domina le despotisme oriental l’introduction, au cours du XIXe siècle, de mesures de réformes et de modernisation imposées à une société et une économie archaïques aboutit à une perturbation des équilibres anciens due aux difficultés financières d’un Etat engagé dans des réformes au coût supérieur aux capacités fiscales, ce qui conduisit tout droit à l’augmentation et à la multiplication des impôts, à leur affermage, aux exactions et à la corruption. La mémoire collective tunisienne entretient – souvent avec excès – le souvenir du règne certes exécrable de Sadok Bey (1859-1882), dernier prince régnant d’avant le protectorat. En réalité, la spirale des réformes ruineuses, de la spoliation et de la répression se met en place – ou à tout le moins s’amplifie dangereusement - dès le règne d’Ahmed 1er Bey (1837-1855).
Par Mohamed-El Aziz Ben Achour - En Tunisie beylicale, comme dans tous les pays où durant des siècles domina le despotisme oriental l’introduction, au cours du XIXe siècle, de mesures de réformes et de modernisation imposées à une société et une économie archaïques aboutit à une perturbation des équilibres anciens due aux difficultés financières d’un Etat engagé dans des réformes au coût supérieur aux capacités fiscales, ce qui conduisit tout droit à l’augmentation et à la multiplication des impôts, à leur affermage, aux exactions et à la corruption. La mémoire collective tunisienne entretient – souvent avec excès – le souvenir du règne certes exécrable de Sadok Bey (1859-1882), dernier prince régnant d’avant le protectorat. En réalité, la spirale des réformes ruineuses, de la spoliation et de la répression se met en place – ou à tout le moins s’amplifie dangereusement - dès le règne d’Ahmed 1er Bey (1837-1855).
Cette période elle-même commença d’ailleurs sous de mauvais auspices puisqu’elle héritait des dettes considérables accumulées à partir du règne de Husseïn II Bey (1824-1835) suite à la fameuse affaire de l’huile. En effet, l’Etat impécunieux vendit par anticipation à des négociants européens la récolte d’olives qui malheureusement vint à manquer deux années de suite, obligeant le Bey à rembourser des sommes considérables à ses créanciers, à imposer des contributions importantes aux caïds du Sahel [ la plus importante oliveraie, à l’époque], lesquels «nous dit l’historien Ahmed Ben Dhiaf, secrétaire de la chancellerie du Bardo et contemporain des événements, se saisirent de l’argent de leurs administrés comme si c’était leur bien propre».

C’est dans cette atmosphère qu’Ahmed Bey, succédant à son père Mustafa, monta sur le trône le 10 octobre 1837, à l’âge de 31 ans. Dans l’exercice du pouvoir, il s’appuya prioritairement, selon la vieille conception orientale, sur la caste des mamelouks, ces dignitaires de statut servile, ramenés enfants du Caucase mais aussi de Grèce. Ils étaient généralement mariés à des princesses et c’est ainsi qu’Ahmed avait pour beaux-frères Mustafa Khaznadar, futur Premier ministre, Mustafa Bach Agha, plus tard ministre de la guerre, et Mustafa Saheb Ettabaâ, qualifié en raison de sa sagesse et de son pouvoir d’influence, de «cheikh al dawla». Si les mamelouks tenaient le haut du pavé, il convient de rappeler cependant que les beys husseïnites eurent le mérite d’associer assez tôt des compétences autochtones à la gestion des affaires. C’est ainsi qu’existaient au Bardo, cœur battant de l’Etat husseïnite, d’influents personnages tunisiens (premier secrétaire comme les bash kâtib Lasram et secrétaires particuliers du bey comme notre Ahmed Ben Dhiaf et de titulaires de fonctions militaires et de sécurité (comme le bâch hânba). Certains caïds gouverneurs et adjudicataires de grandes fermes fiscales se constituèrent en puissantes familles ayant un accès direct au souverain, telles les Al Jallûli de Sfax, les Ben Ayed de Djerba ou les Belhâj de Bizerte. Les chefs des grandes tribus bédouines n’étaient pas en reste, et certains, auxquels le pouvoir conférait des titres officiels, avaient leurs entrées au Bardo. La cour comptait aussi des Tunisiens de confession israélite à qui l’on confiait la comptabilité générale à l’exemple de Youssouf Bîchî sous les règnes de Husseïn, Mustafa et Ahmed, et plus tard du puissant Nessim Chammâma, caïd des juifs.

Mais revenons à Ahmed 1er. Curieuse personnalité que celle de ce prince à la fois très oriental dans sa conception du pouvoir et dans sa culture, et dans ses rêves de grandeur à l’européenne. Nul autre que lui, en effet, ne fut si attaché au culte des saints et à la vénération des chérifs, descendants du Prophète. Sa piété évidente et ostentatoire s’exprimait en diverses occasions. C’est à lui que les Tunisiens doivent jusqu’aujourd’hui le faste donné, à partir de 1841, à la célébration du Mouled. Simultanément, – comme son homologue le pacha d’Egypte, comme le sultan lui-même - il manifesta très tôt son souci de moderniser son pays. L’histoire a retenu son côté réformateur ou, à tout le moins, son souci d’engager son Etat sur la voie de la modernité. C’est ainsi qu’il décréta, en février 1840, la réorganisation de la mosquée-université de la Zitouna et établit, dans la foulée, l’égalité entre oulémas malékites et hanéfites. A partir de cette réforme, l’enseignement devint officiel et ses lauréats sanctionnés par un diplôme beylical. Il enrichit cette vénérable institution en fondant une bibliothèque universitaire supplémentaire (Al Ahmadiya). Son décret de janvier 1846 portant abolition de l’esclavage des Noirs fut une décision historique en termes de dignité et de droits humains.

Cette volonté réformatrice, en quelque sorte stratégique, péchait cependant par ce qu’elle avait de tronqué, dans la mesure où tous les efforts du bey étaient orientés non pas en direction de la société ni de l’activité économique, ni de la connaissance et de l’enseignement, mais de la création d’une armée organisée à l’européenne. Preuve que, dans son esprit, la modernisation était en fait une manière de donner une nouvelle vigueur au pouvoir despotique sans se soucier de réformer en profondeur l’Etat dans ses rapports avec la société. On est donc dans une logique tout à fait différente de celle du despotisme éclairé d’une Catherine II de Russie ou d’un Frédéric de Prusse ; ni même de celle des sultans qui, à l’ère des Tanzimat (1839-1876), souhaitaient introduire des réformes institutionnelles, mais dans celle, toujours vivace, de l’autocratie orientale mise au goût du jour. Ce n’est pas l’archaïsme aux formes multiples des milieux citadins, ruraux ou tribaux ni la torpeur de l’économie qui interpellaient le prince mais l’allure de son pouvoir, l’envie d’imiter les monarques d’une Europe alors en plein essor.

Il se berçait de l’illusion, fondatrice de la modernisation à l’orientale, que la clé du progrès résidait dans une armée la plus nombreuse possible et organisée à l’européenne. En la matière, le véritable acquis fut la création le 5 mars 1840 d’une école militaire au Bardo dont il confia la direction à des militaires européens. Outre l’instruction militaire, cet établissement allait devenir le creuset de la pensée réformiste. Il tenta aussi, mais sans succès durable d’introduire une économie industrielle liée à l’armée régulière telle que la création d’une manufacture de draps au Batân de Tébourba et une fabrique d’armes à la caserne de Bab Saadoun. Mais en matière de conscription, les résultats furent généralement catastrophiques.

Le prince, en effet, ne se préoccupait pas de la capacité du pays à supporter le fardeau des dépenses qu’exigeait la nouveauté. L’augmentation drastique des dépenses consacrées à l’armée régulière eut des conséquences dévastatrices sur le pays, l’Etat, l’économie et les sujets. De sorte que dès 1840, on créa de nouvelles fermes fiscales sur le savon, le commerce de l’huile, de nouveaux impôts. Le pouvoir imposa de nouvelles taxes et droits d’octroi. L’entretien de l’armée requérant sans cesse des moyens considérables, il fallut aussi créer de nouvelles fermes fiscales. La conséquence, au plan politique et social, fut l’exploitation éhontée des populations par les caïds-gouverneurs et des adjudicataires des grandes fermes fiscales. Les premiers mettaient un zèle brutal à collecter les impôts pour donner une preuve de leur dévouement au prince mais surtout pour prélever une part des sommes réunies en faisant « suer le burnous ». Les seconds s’arrachaient les grandes fermes fiscales (telles que le monopole des peaux et cuirs, du tabac, du savon, du commerce de l’huile, et diverses taxes), faisaient de la surenchère en attendant de se «dédommager» sur le dos des sujets. Caïds et fermiers d’impôts disposaient de prisons dans lesquelles s’entassaient les « récalcitrants ».

Les spoliations prirent une telle ampleur que l’économie eut à en souffrir. Le découragement des cultivateurs face aux exactions des agents du pouvoir et des fermiers aboutit rapidement à une réduction des surfaces emblavées. «On s’est mis à importer les grains, note Ben Dhiaf dans sa chronique, cependant que la liste administrative des henchirs «abiadh-s» [les terres céréalières en friche] ne cessait de s’allonger.» Pire encore, au Sahel et ailleurs, beaucoup d’exploitants, réduits aux expédients qui ne faisaient qu’aggraver leur endettement, furent ruinés. Le cas extrême de cette manière féroce d’exploiter les hommes au prétexte de servir l’Etat est celui de Mahmoud Ben Ayed. Ce fils d’une grande famille de dignitaires makhzen n’était pas le seul caïd et fermier d’impôts à agir de la sorte mais il fut le seul à jouir d’une confiance telle de la part d’Ahmed Bey qu’il commit toutes sortes d’abus dans une impunité totale. Pire encore, il sut susciter l’ire (bien entendu, intéressée de l’impécunieux pacha) à l’égard des puissants rivaux des Ben Ayed, les Al Jallûli, à un point tel que les frères Hassûna et Farhat furent contraints de se réfugier à Malte. Un membre de la famille Belhâj connut le même sort. On ne sait pas très bien ce qui explique cet aveuglement du prince mais il est possible que dès leur jeunesse, Ben Ayed sut entretenir l’affection et l’indulgence d’Ahmed par des «cadeaux» de prestige en espèces sonnantes et trébuchantes. Toujours est-il qu’il accumula une fortune considérable par le recours à d’infâmes procédés dont la fraude systématique lors de la collecte dans les silos à grains de l’Etat (Râbta), du dixième de la récolte. Par l’intermédiaire de ses employés, il ne faisait rien d’autre que tricher sur les quantités délivrées par les cultivateurs. Avec l’appui du bey, il avait affermé la perception de cet impôt en nature et réussi, «selon des procédés scandaleux que seuls, écrit malicieusement Ben Dhiaf, les Tunisiens, habitués à toutes sortes d’exactions, peuvent croire à la réalité de tels méfaits.». Dans toutes les fermes fiscales dont il avait obtenu l’adjudication, les détournements au détriment de l’Etat étaient systématiques. Plus tard, en juin 1852, sentant le vent tourner, Mahmoud quitta le pays (chose extraordinaire, avec la bénédiction du bey), obtint à Paris la nationalité française et porta sans vergogne plainte contre le gouvernement tunisien en réclamant le paiement de cinq millions de piastres !
Enferré dans son obsession d’une armée moderne et nombreuse, Ahmed Pacha Bey couvrait les exactions des caïds et fermiers à la stupéfaction des oulémas. C’est ainsi qu’Ibrahim Al Riahi, grand mufti et imam de la Grande mosquée, dénonça plus d’une fois ces abus, en chaire ou directement au souverain. Aussi l’historien Leon Carl Brown, spécialiste de la période, a-t-il raison d’écrire que sous le règne d’Ahmed Bey, l’Etat était, par le biais de la ferme des impôts, le marché des hommes d’affaires comme les caïds territoriaux et fiscaux. Le prince avait d’autant moins d’excuses qu’à l’instar de ses aïeux, il connaissait parfaitement le pays, ses ressources limitées, le mode de vie rustique de ses tribus pour avoir naguère sillonné le pays à la tête du Camp volant (mhalla). Ce qui est assez extraordinaire, c’est que le même Ahmed, qui présentait dans sa correspondance au sultan les arguments les plus solides quant à l’impossibilité du beylik de Tunis de verser un tribut annuel au gouvernement impérial à cause de la médiocrité de ses ressources, occultait complètement cette réalité quand il s’agissait d’engager des réformes coûteuses.

Son obstination à maintenir le même nombre de soldats malgré le surendettement de l’Etat aggravait le caractère irrationnel de ses décisions. Lors du choléra de 1849, certains régiments ayant été décimés, il décida de faire enrôler des hommes des environs de Béja et Siliana. Ses conseillers tentèrent de l’en dissuader en lui rappelant que ces régions avaient été particulièrement touchées par l’épidémie et que l’agriculure manquait de bras. Rien n’y fit et les malheureux, arrachés à leur famille en détresse et à leurs champs, vinrent combler inutilement les places laissées vacantes par les victimes du fléau.
Malgré toutes les vicissitudes, la nouvelle armée régulière donna-t-elle au moins naissance à un esprit de corps ? Probablement oui dans le milieu des élèves officiers de l’école du Bardo et sans doute d’une manière plus générale au sein des régiments qui comptaient des officiers turcs de Tunis mais aussi d’Alger et de Tripoli installés dans la régence et des officiers autochtones. Toutefois, l’ambiance dans les casernes n’incitait pas à l’émergence d’un tel esprit. Certains officiers, confondant service militaire et exploitation des soldats pour leur usage personnel, les traitaient avec rudesse et mépris. Et d’une manière générale, on confondait rigueur et cruauté. En 1849, des réguliers zwâwas qui s’étaient mal positionnés furent insultés et un des leurs giflé par leur officier qui courut se plaindre au bey pour leur «insolence». Craignant le pire, ils se réfugièrent dans leur foyer mais finirent par être conduits devant le bey qui ordonna d’exécuter six d’entre eux séance tenante. En août 1851, une vague agitation des marins est signalée à bord d’une frégate ancrée à La Goulette. Le bey, informé, ordonna évidemment sans enquête préalable de fusiller sur-le-champ huit infortunés matelots.
Alors que retenir de positif de l’ère d’Ahmed Bey (mort à 48 ans, le 30 mai 1855) ? La création de l’école du Bardo eut deux aspects constructifs. D’abord, la constitution d’un corps d’officiers rompus aux méthodes modernes et qui allaient plus tard faire leurs preuves pendant la guerre de Crimée. Ensuite, cette école fut le creuset de la pensée réformiste que tentera d’appliquer plus tard l’élève le plus brillant de la première promotion, le général Khérédine (Premier ministre de 1873 à 1877). Rappelons aussi sa décision historique d’abolir l’esclavage, et la réforme de l’enseignement à la grande mosquée. Il faut aussi souligner son attachement à l’autonomie tunisienne malgré une allégeance toujours affirmée – quoique parfois tendue – à l’égard de son suzerain, le sultan-calife.
Le souci d’Ahmed Pacha Bey de faire de son pays un Etat moderne et fort était sincère. Toutefois, replacée dans le contexte régional marqué par la présence française en Algérie, la politique beylicale (non seulement sous le règne d’Ahmed mais depuis 1830 et durant tout le restant du siècle) bénéficia davantage à la France qu’à notre pays. C’est vrai que cette sorte de reconnaissance tacite d’une protection diplomatique française a sans doute épargné à la régence de Tunis le sort de l’Algérie et lui a donné un «sursis» de quelque cinquante ans avant de subir l’occupation dans un contexte international différent. Le cas n’était pas unique. Tous les Etats non occidentaux, l’Empire ottoman en tête, eurent à pâtir des effets pervers des politiques de réformes et de modernisation conduites cahin-caha par des pouvoirs empêtrés dans leurs conceptions archaïques, appuyés sur des économies atones et des sociétés fourbues. L’exercice du pouvoir continuait d’être celui de toujours, c’est-à-dire les décisions intempestives, la répression fiscale, l’incitation à la corruption des fonctionnaires. Le corollaire tragique de cette politique de modernisation fut l’amplification de la corruption, l’accroissement des exactions pour un résultat non seulement limité mais surtout annonciateur des calamités politiques, économiques et financières qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, frappèrent une Tunisie meurtrie. A plus long terme, l’exploitation éhontée des populations, la corruption généralisée, le vol sans vergogne des recettes publiques au nom de la modernisation fallacieuse du pays –en fait de son armée– ont aggravé de manière durable– et au-delà du règne d’Ahmed Ier- la méfiance des sujets à l’égard de l’Etat d’une manière générale et des réformes en particulier.
Mohamed-El Aziz Ben Achour
- Ecrire un commentaire
- Commenter