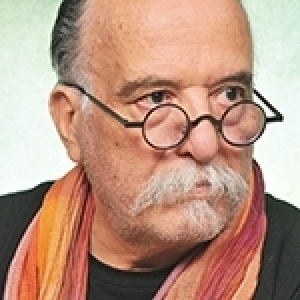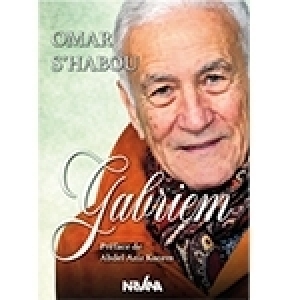Mohamed-El Aziz Ben Achour: Les Karamanli, pachas de Tripoli

.jpg) Au XVIe siècle, l’Empire ottoman, dans sa compétition avec l’Espagne pour la domination en Méditerranée, réussit à asseoir durablement son autorité sur le Maghreb oriental et central avec pour solides points d’appui Alger (1519), Tripoli (1551), (Tunis 1534 puis reprise définitivement aux Espagnols en 1574). On sait, par ailleurs, que les beys de Tunis réussirent à acquérir définitivement en 1705 un statut de princes vassaux du Sultan avec une large autonomie et un pouvoir héréditaire jusqu’à l’occupation française en 1881, et que la régence oligarchique d’Alger fut perdue par l’Empire au bénéfice de la France en 1830. Ce que l’on sait sans doute moins c’est que la Tripolitaine fut le pays qui garda le plus longtemps son statut de province ottomane qui s’exerça jusqu’en 1911, lorsque l’Italie entreprit d’envahir la province qu’elle appela dès lors « Libia » en référence à l’époque romaine.
Au XVIe siècle, l’Empire ottoman, dans sa compétition avec l’Espagne pour la domination en Méditerranée, réussit à asseoir durablement son autorité sur le Maghreb oriental et central avec pour solides points d’appui Alger (1519), Tripoli (1551), (Tunis 1534 puis reprise définitivement aux Espagnols en 1574). On sait, par ailleurs, que les beys de Tunis réussirent à acquérir définitivement en 1705 un statut de princes vassaux du Sultan avec une large autonomie et un pouvoir héréditaire jusqu’à l’occupation française en 1881, et que la régence oligarchique d’Alger fut perdue par l’Empire au bénéfice de la France en 1830. Ce que l’on sait sans doute moins c’est que la Tripolitaine fut le pays qui garda le plus longtemps son statut de province ottomane qui s’exerça jusqu’en 1911, lorsque l’Italie entreprit d’envahir la province qu’elle appela dès lors « Libia » en référence à l’époque romaine.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, le pachalik de Tripoli connut cependant une expérience qui s’inspirait de celle des beys mouradites et husseïnites de Tunis. En effet, un officier du nom d’Ahmed Karamanli accapara la réalité du pouvoir, inaugurant une dynastie héréditaire alors que jusque-là, l’autorité civile et militaire y était exercée par un pacha nommé directement par la Sublime Porte. Toutefois, des querelles familiales fréquentes et toutes sortes de conspirations et de rébellions tribales fragilisèrent de manière endémique cette expérience d’un Etat autonome.
Voyons cela de plus près. Ahmed ben Youssouf ben Mustafa Karamanli appartenait à une famille originaire de Karamanie en Anatolie, depuis longtemps installée à Tripoli au service du gouvernement de cette province. Selon certains, le fondateur de la famille était un janissaire, selon d’autres, c’était un corsaire. L’arabisant et consul de France à Tripoli de 1879 à 1884, Laurent-Charles Féraud, écrit ainsi dans ses Annales tripolitaines : «Les descendants du corsaire se transmirent de père en fils le nom générique de Karamanli, leur aïeul, mais, en continuant à s’allier à des Arabes, il ne leur restait bientôt du Turc que le nom et ils en ignoraient même la langue.» (Paris, 1927, 2e éd. Nora Lafi, 2005). Ahmed appartenait donc, comme son contemporain Husseïn Ben Ali, bey de Tunis, au milieu que les ottomans appelaient les kouloughlis, entendez les natifs du pays, de père d’ascendance turque et de mère autochtone (« arabe»). Les réseaux d’alliance que ces kouloughlis tissaient dans la société leur procuraient un sérieux avantage politique sur les Turcs, même haut placés, mais fraîchement débarqués dans les provinces maghrébines. Cette réalité sociale a fait dire à l’historien Kolawole Folayan : “The attenuation of Ottoman rule in Tripoli, especially in the 17th century, and the gradual ascent of the Kuloglu class provided the political and social background to the emergence of the local dynasty of the Qaramanlis” (Tripoli during the reign of Yusuf Pasha Qaramanli, 1970).
.jpg)
Ahmed se distingua, à la suite de son père comme bach-aga, commandant la cavalerie du Sahel (le littoral) et de la Menchia (les environs de Tripoli). En 1711, dans des circonstances mouvementées, le gouverneur de la province ayant cherché à le faire tuer par une tribu, il retourne le stratagème à son avantage et, par d’habiles manœuvres et arguments convaincants qu’il serait fastidieux d’exposer ici, il obtient le ralliement des notables des tribus mais aussi des dignitaires politico-militaires ottomans et se fait élire comme chef du pays. Prenant modèle sur Husseïn Bey de Tunis, il se proposait de donner à son pouvoir la forme d’une dynastie héréditaire et autonome. Toutefois, les choses furent beaucoup plus compliquées qu’à Tunis, puisque Ahmed Karamanli n’obtint le firman impérial qui l’investissait en qualité de pacha qu’en 1722, c’est-à-dire onze années après son coup de force. Les alliances avec les tribus étant traditionnellement précaires, il eut à vaincre diverses rébellions à Tajoura près de Tripoli, au Fezzan, au Djebel El-Akhdhar et ailleurs, et réussit à étendre son autorité à la Cyrénaïque et une partie du Fezzan. Il acquit, de ce fait, une puissance et un prestige inégalés. Une activité économique florissante due au négoce avec les pays européens et au trafic caravanier transsaharien et les revenus considérables que lui procurait l’activité corsaire assurèrent à son règne une certaine prospérité et lui permirent de mener une politique fiscale supportable pour ses sujets, de sorte que la dynastie fut alors à son apogée.
Toutefois, son long règne (1711-1745) ne fut pas exempt de troubles et de calamités naturelles (peste en 1733, sécheresse et disette en 1745). A deux reprises, il fallut repousser un débarquement de troupes turques. Les relations avec les puissances étrangères et notamment la France étaient régies par des traités qui stipulaient l’obligation pour ces puissances de verser un tribut au pacha en échange de la sécurité de leur marine marchande. Toutefois, en fonction du rapport de force, ces relations tournaient parfois à l’affrontement. Ainsi, en juillet 1728, une escadre française bombarda Tripoli et ses environs. En temps de paix, en revanche, on ne répugnait pas à lui prêter main-forte. En 1731-32, des artilleurs laissés à la disposition d’Ahmed Ier par l’amiral René Duguay-Trouin tirèrent à boulets rouges sur la ville-oasis de Mourzouk, contribuant ainsi à la victoire du pacha sur les insurgés du Fezzan.

A sa mort, survenue en novembre 1745, son fils cadet Mhammad lui succéda, alors que l’aîné Mahmoud, absent de Tripoli et sa santé affaiblie à cause de son goût immodéré pour la boisson, fut tenu à l’écart. Il dut se contenter du titre de bey de Benghazi et Derna. En juillet 1754. Ali, le plus jeune de ses frères, lui succède. Son règne fut marqué par les querelles entre ses fils qui se terminèrent tragiquement par l’assassinat de Hassan par son ambitieux et sanguinaire frère Youssouf. Face à une telle situation qui mettait en péril non seulement la province mais probablement le maintien même de Tripoli dans le giron ottoman, la Sublime Porte, soucieuse de garder le contrôle d’une province en proie à de tels déchirements, confia, en juillet 1793, à un officier du nom d’Ali Borghol Cezayri « l’Algérois » la mission de destituer la famille régnante et de rétablir l’administration directe de la province. L’expédition réussit et le Pacha fut contraint de se réfugier auprès de Hammouda Pacha Bey (1782-1814) où le rejoignirent bientôt ses fils Ahmed et Youssouf. Le bey de Tunis n’avait d’autre intention vis-à-vis de Tripoli que de garantir la sécurité de son infortuné hôte. Mais la prise de l’île de Djerba, qui relevait de la souveraineté tunisienne, par les troupes d’Ali Borghol et le spectre d’une intervention militaire, semblable à celle montée par le Dey d’Alger contre la régence de Tunis quelques années auparavant, décida le prince husseïnite à intervenir énergiquement. L’objectif était désormais non seulement de reprendre Djerba mais de rétablir manu militari Ali Pacha Karamanli sur son trône. Un corps expéditionnaire fut constitué qui quitta Tunis en octobre 1794 et réussit, le 20 janvier 1795, à investir Tripoli, après avoir réduit la résistance des troupes de Borghol et des habitants des environs de la ville. Le général tunisien Mustafa Khoja rétablit aussitôt le trône kâramanli et rejoignit Tunis à la tête de son armée. Ce succès, ainsi que la reconquête rapide de Djerba, ajouta au prestige de Hammouda Pacha dans son pays et aux yeux de ses voisins. Cependant, le caractère en quelque sorte insolent de l’expédition provoqua la colère du Sultan, suzerain du pacha bey de Tunis. Il fallut donc faire amende honorable et renouveler au Commandeur-des-croyants les marques de la plus respectueuse et très obéissante allégeance. Le vizir Youssouf Saheb Ettabâa fut chargé de se rendre à Constantinople dans ce but. Le Gouvernement impérial, par une de ces réactions inattendues et à la fois intelligente et généreuse dont il avait le secret, non seulement assura Saheb Ettabâa du pardon du Sultan mais lui confia, en outre, le firman d’investiture du prince Ahmed II b. Ali Karamanli en qualité de pacha en remplacement de son père, et un second firman par lequel le prince Youssouf, son frère, était nommé bey. Cette investiture – non dénuée d’arrière-pensées - par laquelle Stamboul confiait les deux plus hauts titres politiques à deux princes dont les relations étaient loin d’être paisibles ne manqua pas de provoquer une rivalité au sein de la famille régnante, alimentée par l’ambition dévorante de Youssouf. Son frère n’ayant régné que quelques mois, il accède enfin au pouvoir en juin 1795. Despote redouté, il fut néanmoins confronté à des difficultés de tous ordres, et d’abord au sein de sa propre famille. Son fils Mhammad, en conflit avec lui, est éloigné à Benghazi comme gouverneur de cette région en effervescence. Le jeune homme ne trouva rien de mieux à faire que de prendre la tête du mouvement insurrectionnel, avant d’être contraint à l’exil.
.jpg)
Au plan externe, le rapport de force entre les régences dites « barbaresques» et les Etats occidentaux commençait à se modifier au profit de ces derniers. Youssouf Pacha n’en prit pas conscience. Il rompit, ainsi, le traité du 4 novembre 1796 autorisant le passage des navires marchands américains dans les eaux tripolitaines. Youssouf exigea un tribut de 225 000 dollars, somme colossale. Ce fut le point de départ de la première des « Barbary Wars », celle qui opposa les troupes et la marine du Pacha à l’escadre des Etats-Unis de mai 1801 à octobre 1803. Au lendemain de l’occupation de Derna en Cyrénaïque par des troupes américaines au sol le 27 avril 1805, un traité est signé le 10 juin suivant. Il stipulait que les Etats-Unis ne paieraient plus de tribut en échange de la sécurité du commerce. Ils versèrent cependant la somme, considérable à l’époque, de 60 000 dollars en échange de la libération des captifs dont le capitaine et l’équipage de l’USS Philadelphia. La régence de Tripoli entrait désormais dans l’ère des difficultés financières endémiques et de l’endettement chronique de l’Etat auprès des créanciers étrangers. Le trafic commercial ne compensant guère la perte des revenus générés par le paiement des redevances par les Puissances, le Pacha se mit à pressurer les populations avec une férocité sans limites. A Benghazi, le 5 septembre 1816, 10 000 membres de la tribu des El Jawâzi qui avait refusé de payer un impôt exorbitant furent massacrés.
Dans ces circonstances dominées par des acteurs politiques typiquement orientaux, apparut la figure originale de Hassouna El-Dghiss (Tripoli 1778- Constantinople 1836), issu d’une famille de Tripoli appartenant à l’élite marchande, lettrée et politique. Son père Mohamed était le vizir de Youssouf pacha comme le sera plus tard son frère cadet, gendre du pacha. De l’avis de divers historiens modernes, El Dghiss fait figure de précurseur en matière de connaissance des langues et culture occidentales. En effet, fait rarissime en ce temps-là, son père l’envoya poursuivre ses études en France et finança un grand nombre de ses voyages et séjours à travers l’Europe. Il acquit une maîtrise de la langue française et une bonne connaissance de la civilisation européenne. Le gouvernement du pacha de Tripoli lui confia des missions diplomatiques en Espagne et en France. Sans doute un des premiers intellectuels du monde ottoman à s’imprégner des idées libérales en droit, en politique et en économie, il fut un fervent opposant à la traite des Noirs et un partisan du libéralisme économique. Dans des circonstances assez obscures, probablement une mission diplomatique, il se rend en Angleterre en août 1822. Là, il entra en contact avec le philosophe et juriste britannique francophone Jeremy Bentham (1748-1832) et travailla avec lui à une réforme institutionnelle du pouvoir tripolitain. A la suite de divers entretiens, les deux réformistes projetèrent de rédiger une constitution libérale valable pour tous les pays et, bien sûr, la régence de Tripoli. Il s’agissait ensuite de la proposer à Youssouf Pacha et, au cas où ce dernier refuserait, de susciter rien de moins que la levée d’une troupe armée composée de mille hommes, le soulèvement des tribus et l’instauration d’un régime politique libéral. Youssouf devait s’effacer au profit de son fils Ali. Pour financer « l’opération », Bentham et Dghiss crurent pouvoir solliciter des financiers anglais, et même l’appui du secrétaire d’Etat US, John Quincy Adams. Est-il besoin de préciser que tout cet échafaudage philosophique et politique s’effondra comme un château de cartes ? Heureusement pour Hassouna El-Dghiss, toutes ces cogitations se déroulèrent en Angleterre entre les murs du cabinet de travail du philosophe. De retour dans son pays en avril 1823, notre curieux mais attachant Tripolitain s’en sortit non seulement sans dégâts mais le très despotique Youssouf lui confia même le portefeuille des affaires extérieures ; sans doute pour désamorcer la conspiration qui se tramait contre lui à l’instigation de son fils, le prince Ali, dont El Dghiss était le cousin par alliance et, peut-être, la tête pensante du mouvement. Dans un article sur l’épisode Bentham-El-Dghiss, publié à Cambridge en 2009, l’historien L.J. Hume place cet événement Dans cet article, Hassouna est qualifié, à notre avis abusivement, de «the chief conspirator».

En 1829, ayant, selon un historien libyen récent, Aqil El-Berber, suscité l’hostilité des consuls européens en raison de son intransigeance au nom des intérêts de son pays, il fut destitué par un Youssouf Pacha que les dettes de son gouvernement mettait en position de faiblesse. Il s’exila à Constantinople où il fonda un organe de presse officieux en langue française : Le Moniteur ottoman.
Hassouna laissait derrière lui une famille régnante déchirée par des querelles sans fin et des rébellions princières, celles de Mhammad en 1817 puis en 1826 et encore en 1832, et Mhammad b.Ali en 1824, et en 1835. Le pays fut rapidement en proie aux troubles consécutifs à la poursuite d’une politique fiscale désastreuse. En 1831, Abd-el-Jalil, cheikh de la puissante tribu des Ouled-Slimane, entre en dissidence. En 1832, une contribution imposée aux campagnards de la Menchia qui étaient jusque-là exemptés d’impôts aboutit à leur soulèvement armé. L’aristocratie politique et religieuse de Tripoli, inquiète face à la montée du mécontentement, proposa à Youssouf d’abdiquer en faveur de son fils Ali, ce qui fut fait le 20 août. Les rebelles de la Menchia et d’autres tribus, voulant que le pouvoir revienne à Mohammed, le petit-fils du pacha destitué, n’acceptèrent pas cette mesure, à l’exception des bédouins Mhâmîd et de leur chef, le fameux Ghouma el Mahmoudî, partisans du prince Ali. Cet état de véritable guerre civile était aggravé par les ingérences des consuls étrangers, l’inamovible Warrington qui prit fait et cause pour la Menchia et le consul de France Schwebel, plus circonspect. Face à cette situation, le gouvernement ottoman prit la décision de rétablir son autorité directe sur la province. En juin 1835, le grand vizir Néjib Pacha et son escadre débarquent à Tripoli, abolissent la dynastie Karamanlie et annoncent officiellement le rétablissement de l’administration directe.

Toutefois, la litanie des conjurations, des rébellions et des assassinats, qui rythmèrent tragiquement la vie politique de la Tripolitaine karamanlie, les rapports émaillés d’incidents parfois armés avec les puissances étrangères au plan extérieur, ne doivent pas nous masquer le caractère attachant d’une population peu nombreuse mais diverse. Le voyageur et orientaliste François Pétis de La Croix , séjournant à Tripoli à la fin du XVIIe siècle, estimait sa population à quelque 64 500 habitants : « 3 500 Turcs ou ‘Levantis’, 8 000 ‘Cologlis’, 35 000‘ Maures, 16 000 Juifs, et 2 150 esclaves chrétiens de toutes nations (art. d’Annie Berthier, 1996). Agents au service du pouvoir, militaires et corsaires côtoyaient des lettrés, des magistrats religieux et des marchands tripolitains, maghrébins, voire de Tombouctou. A Benghazi, on retrouvait aussi cette société bariolée propre à toutes les cités du monde ottoman: Turcs, Autochtones, Levantins, Maltais et Grecs. A l’intérieur, dans les plaines, les montagnes et le désert, l’organisation tribale était la règle. Toutes les tribus étaient sunnites et arabophones à l’exception de la communauté du Djebel Nefoussa, ibadite et berbérophone. Le goût de la liberté et la turbulence propres aux tribus nomades rendaient malaisée une alliance durable avec un pouvoir central en proie à ses difficultés internes. Souvent puissantes, les tribus entretenaient un climat d’instabilité et jouaient régulièrement un rôle crucial dans les querelles de succession.

Au voisinage de Tripoli, les campagnards d’El-Menchia, bien que sédentaires, pesaient lourd dans la vie politique. « A toute époque, constatait L.-Ch. Féraud, la population urbaine de Tripoli a dû compter avec la Menchia, dont l’adhésion exerçait un grand poids sur le vote du Divan appelé à élire [ses chefs] les deys». Cette campagne environnante de Tripoli abritait une riche activité agricole en même temps qu’elle était le lieu de villégiature des citadins de la capitale. Pétis de La Croix y admira la beauté des jardins « dans lesquels il y a des ‘bastimens’ et des maisons de plaisance très agréables», les potagers, le système d’irrigation, (…) la quantité d’arbres fruitiers, l’abondance du blé et du sarrasin. Une partie de sa production était exportée, notamment à Malte, grâce à des circuits d’échanges animés par un commerce longtemps actif avec le Maghreb, le Levant et les pays européens ainsi que par le trafic caravanier transsaharien.
A la différence des beys de Tunis qui ne connurent que deux graves querelles de succession en 1728-1740 puis en 1814-15, assurèrent une stabilité réelle, engagèrent, vaille que vaille, un programme de modernisation de l’Etat et réussirent à asseoir durablement la légitimité de leur trône, les Kâramanlî ont échoué à engager leur pays dans un processus de constitution d’un Etat fédérant la société autour de leur trône et finirent par sombrer dans la tourmente qui affectait leur pays. Les causes de l’échec de cette expérience sont multiples, internes et exogènes, mais elles sont à chercher principalement dans l’absence d’une tradition centralisatrice et dynastique dont jouissait, par contre, depuis le Moyen Âge, le «Pays de Tunis».
Mohamed-El Aziz Ben Achour
- Ecrire un commentaire
- Commenter