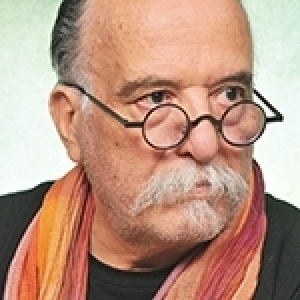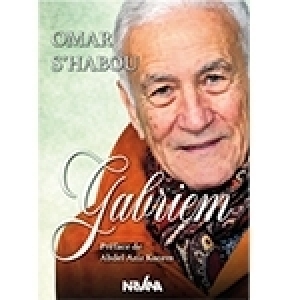Ammar Mahjoubi: La population de l’empire romain

.jpg) A Rome, comme dans les provinces, les autorités disposaient, grâce aux déclarations de naissance des citoyens, de renseignements chiffrés pour dénombrer la population de l’empire. Les provinces étaient aussi astreintes au tribut personnel, qui imposait à leurs cités des recensements quinquennalement renouvelés. Malheureusement, rien ou presque n’a été conservé de ces sources démographiques, et rares sont les chiffres précis qui nous sont parvenus. Non seulement les données existantes sont donc partielles et toujours ponctuelles, mais elles se prêtent surtout, de façon constante, à des conclusions contradictoires. Les insuffisances patentes de la documentation ont ainsi amené les historiens à convenir de la vanité des tentatives pour parvenir à une estimation précise de la population romaine.
A Rome, comme dans les provinces, les autorités disposaient, grâce aux déclarations de naissance des citoyens, de renseignements chiffrés pour dénombrer la population de l’empire. Les provinces étaient aussi astreintes au tribut personnel, qui imposait à leurs cités des recensements quinquennalement renouvelés. Malheureusement, rien ou presque n’a été conservé de ces sources démographiques, et rares sont les chiffres précis qui nous sont parvenus. Non seulement les données existantes sont donc partielles et toujours ponctuelles, mais elles se prêtent surtout, de façon constante, à des conclusions contradictoires. Les insuffisances patentes de la documentation ont ainsi amené les historiens à convenir de la vanité des tentatives pour parvenir à une estimation précise de la population romaine.
Deux inscriptions principales, datées toutes deux de l’année 14 après le Christ, donnent néanmoins un chiffre précis, celui qu’avait fourni le recensement général effectué à cette date. Selon la première, celle des Fastes d’Ostie, l’empire comprenait 4 100 000 citoyens romains ; alors que les « Res gestae » d’Auguste, gravées sur la seconde, avancent le chiffre plus élevé de 4 937 000. La divergence, avait-on conclu, résulte d’une erreur de transcription à Ostie. Parmi les habitants de l’empire était-ce le nombre de tous les citoyens romains ? ou seulement des adultes mâles âgés de 17 à 60 ans ? Et quelle était la proportion des habitants qui échappaient au recensement, sachant que le nombre des pérégrins qui ne bénéficiaient pas de la citoyenneté ainsi que celui des esclaves restent inconnus ? Bien d’autres questions sont posées : la véracité des déclarations ? Celle des âges, toujours arrondis, mal connus ou travestis par les intéressés eux-mêmes ? On cite l’exemple notoire d’un Egyptien qui s’attribuait, à chaque déclaration, un âge invraisemblable : 35 ans en 297, 37 en 308, 45 puis 40 ans dans les déclarations suivantes.
Les statistiques fondées sur l’exploitation des inscriptions funéraires sont aussi sujettes à caution. Mentionnées par ces épitaphes, les espérances de vie paraissent trop élevées (60 ans dans une ville de Numidie) ou trop faibles et ne pouvant assurer le renouvellement des générations (18 ans pour les femmes à Ostie). Constatant la vanité de ces calculs, on a proposé de choisir la méthode comparative, en attribuant plus ou moins arbitrairement à la population romaine une structure identique à celle des mieux connues parmi les sociétés pré-industrielles. Mais les résultats ne sont pas plus convaincants et mieux vaut se contenter des précisions ponctuelles présentées par les recensements égyptiens, les sources écrites ou la table de mortalité utilisée par le jurisconsulte Ulpien. Ce dernier indique une espérance de vie moyenne de 30 ans, et les corrections proposées pour tenir compte de la mortalité infantile, négligée en partie par Ulpien, recoupent les recensements égyptiens et ramènent les espérances de vie à la naissance à moins de 24-25 ans. Quant aux séries épigraphiques qui suggèrent des espérances de 30-35 ans, ces chiffres ne sont valables que pour les individus qui dépassaient la petite enfance.
 Voisin de 45 ‰, le taux de mortalité était très fort et imposait, pour le maintien de la population, une fécondité très élevée : près de 6 enfants en moyenne par couple, et 4,6 par femme atteignant l’âge de 15 ans. Le célibat était ainsi peu répandu et les mariages précoces très fréquents, avec une absence de prévention volontaire des naissances. Dans tout l’Empire, cependant, la démographie devait être naturellement fonction des provinces, des différentes régions et de la diversité des conditions entre les couches sociales ; bien que les démographes aient noté que les différences entre les classes n’ont que peu d’influence, lorsque la mortalité est très forte. Cette population, par ailleurs, était très jeune : 36 % des habitants avaient moins de 15 ans, et 8 % seulement dépassaient 50 ans. Dans une classe d’âge, uniquement le tiers dépassait 30 ans, et un peu plus de 10 % atteignait 60 ans. Dans ces conditions, l’équilibre démographique était très précaire, alors que le progrès était trop lent ; le processus de déclin pouvait engager une diminution durable du taux de reproduction, et les épidémies, les guerres pouvaient provoquer des coupes sombres.
Voisin de 45 ‰, le taux de mortalité était très fort et imposait, pour le maintien de la population, une fécondité très élevée : près de 6 enfants en moyenne par couple, et 4,6 par femme atteignant l’âge de 15 ans. Le célibat était ainsi peu répandu et les mariages précoces très fréquents, avec une absence de prévention volontaire des naissances. Dans tout l’Empire, cependant, la démographie devait être naturellement fonction des provinces, des différentes régions et de la diversité des conditions entre les couches sociales ; bien que les démographes aient noté que les différences entre les classes n’ont que peu d’influence, lorsque la mortalité est très forte. Cette population, par ailleurs, était très jeune : 36 % des habitants avaient moins de 15 ans, et 8 % seulement dépassaient 50 ans. Dans une classe d’âge, uniquement le tiers dépassait 30 ans, et un peu plus de 10 % atteignait 60 ans. Dans ces conditions, l’équilibre démographique était très précaire, alors que le progrès était trop lent ; le processus de déclin pouvait engager une diminution durable du taux de reproduction, et les épidémies, les guerres pouvaient provoquer des coupes sombres.
La structure de la famille dépendait des variations culturelles entre les provinces, et changeait sans doute en conformité avec leurs traditions ; car les règles juridiques romaines ne valaient que pour les provinciaux dotés de la citoyenneté. Mais malgré les limites de nos connaissances, on a pu admettre que pour les habitants libres de l’empire, le couple était la règle, en particulier dans les vastes contrées rurales, et il donnait naissance à autant d’enfants que la fécondité féminine le permettait. Dans la province de Mauritanie Tingitane, au nord du Maroc actuel, l’épouse d’un chef de tribu maure avait dû avoir un enfant chaque année ou presque, car mariée vers 13 ans, elle avait eu à 22 ans quatre enfants vivants âgés de 2 à 8 ans (inscription datée de 177).
En Egypte, grâce aux données des cens, on sait que le mariage, sans être général, était de règle et le divorce peu fréquent, avec à tout le moins un remariage des hommes. Ces derniers se mariaient, le plus souvent, peu avant 20 ans ; mais pour les femmes, l’âge, qui ne se situait que rarement avant la puberté, était cependant précoce, car au moins 60 % des femmes de plus de 15 ans étaient déjà mariées. En se situant à l’âge de 26,5 ans, l’âge moyen d’accouchement montre que la fécondité se prolongeait tardivement, impliquant un nombre de naissances potentiel très élevé. On a pu décompter aussi un déséquilibre entre les sexes, avec 98 femmes pour 100 hommes. Ce qui serait dû à différentes causes, comme les négligences dans les déclarations, l’élimination plus fréquente des filles à la naissance ou seulement un phénomène démographique objectif. A côté des petites unités familiales, se trouvaient des ménages qui réunissaient plusieurs couples sous le même toit tout en exploitant un patrimoine indivis.
En Italie et dans les provinces les plus romanisées, c’est le comportement des élites dans les cités qui, grâce surtout à l’épigraphie, est connu, et qu’il ne faut pas étendre aux couches populaires. La mentalité romaine préférait les familles nombreuses et la stabilité familiale, l’adoption et l’affranchissement des esclaves ajoutant souvent de nouveaux membres. La « familia » réunissait les descendants en ligne masculine d’un ascendant vivant, ainsi que les esclaves et les affranchis ; et le patronyme, le « gentilice » de la famille, primait toujours sur le sang. En vertu de sa « patria potestas», l’ascendant exerçait sur tous les membres de la « familia » une autorité très étendue et c’est seulement à sa disparition que les adultes de la génération suivante pouvaient devenir à leur tour chefs de famille. Rare était l’émancipation légale, qui rompait les liens juridiques, même si les fils adultes vivaient hors de la « domus » de leur ascendant. Ils ne pouvaient ainsi disposer que d’un pécule qu’ils géraient sans en avoir la propriété. La longévité exceptionnelle de cette «patria potestas» la maintint intacte jusqu’à la fin de l’Empire.
Fixé par le droit, ce modèle familial ne concernait en réalité qu’environ un tiers des plébéiens de Rome ; et il en était de même dans les cités des provinces. Partout, les hommes libres, les affranchis et les esclaves nouaient des unions précaires, dont la progéniture illégitime suivait habituellement le statut maternel. Parmi les esclaves ruraux, cependant, les unions des intendants, qui veillaient à la gestion des domaines, étaient encouragées par les autorités, et dès la fin du IIe siècle, on constate une certaine existence légale aux couples serviles. L’âge minimum pour les filles, selon le droit romain, fixait le mariage à 12 ans et à 14 pour les garçons. Mais dans les familles de l’aristocratie, les filles se mariaient normalement entre 12 et 16 ans, alors que les hommes ne convolaient que peu de temps avant 25 ans, vers les débuts de leur carrière officielle. Cette différence d’âge entre les époux était moindre dans les milieux populaires, dont les filles étaient mariées entre 16 et 18 ans. Les lois d’Auguste, cependant, prévoyaient qu’à 20 ans pour les femmes et à 25 pour les hommes, on fût mariés et en puissance d’enfants.
.jpg)
Dans la littérature, le déclin démographique devint une hantise et un lieu commun dès le règne d’Auguste. On stigmatisait la stérilité de l’aristocratie et la diminution de la plèbe, qui provoquait des difficultés aux recrutements de l’armée et faisait craindre une menace servile. La dissociation courante entre vie sexuelle et mariage favorisait l’augmentation du célibat, reculait l’âge du mariage des hommes. S’ajoutant à l’exposition banale des nouveau-nés jetés devant le domicile ou dans les poubelles, elle expliquait le déficit en femmes. Les déficiences de la fécondité des couples étaient toutefois palliées, partiellement, par les adoptions, les affranchissements et les mariages multiples, qui s’ajoutaient aux très nombreuses naissances hors mariage.
La question du déclin, en réalité, était beaucoup plus politique que strictement démographique. Les craintes les plus vives déploraient l’abandon des valeurs traditionnelles de Rome, incarnées par la famille, le déclin des élites, l’affaiblissement du corps civique qui, seul, fournissait les effectifs des légions, et dont on craignait l’envahissement par les affranchis. Les lois décidées par Auguste pénalisèrent en conséquence, lors des successions, les célibataires et les couples sans enfants, tout en avantageant les familles nombreuses et en limitant les possibilités d’affranchissement. Trajan à son tour, au début du IIe siècle, instaura le système des «alimenta», un système d’assistance pour favoriser la natalité des citoyens romains dans les villes italiennes. Mais toutes ces mesures n’eurent, apparemment, qu’une efficience limitée.
Malgré tous les travaux, partiels et toujours ponctuels, l’évaluation de la population globale n’a guère évolué depuis l’ouvrage de K. J. Beloch, publié en 1886 et encore important. On discute toujours le chiffre qu’il avait avancé : 54 millions d’habitants inégalement répartis selon les pays de l’Empire, au début de l’ère chrétienne. A cette époque, l’Italie pouvait compter 7 500 000 habitants, la population de l’Egypte, sans Alexandrie, était peut-être comparable, alors que l’Anatolie, l’ensemble des régions syriennes et les provinces du Maghreb étaient probablement plus peuplées qu’au début du XXe siècle.
Très peuplées, à l’évidence, apparaissent les métropoles de l’Empire. Mais les exemples contemporains, dans les pays du Tiers Monde, permettent de penser que leur gonflement n’était pas dû à un essor économique, mais aux possibilités de survie qu’elles permettaient, en absorbant une part du surplus démographique dans les campagnes. Rome comptait de 500 000 à un peu moins d’un million d’habitants, alors qu’Alexandrie comme Carthage devaient en avoir plus de 300 000 à l’époque antonino-sévérienne. Dans les provinces orientales, Antioche en avait peut-être autant, alors qu’Ephèse et Pergame devaient compter environ 180 000 habitants. Le réseau urbain était dense dans les régions méditerranéennes et jusque dans leurs marges ; on attribue 500 villes à la province d’Asie, 400 à l’Italie et plus de 150 à l’Afrique proconsulaire. Dans les provinces du Maghreb, les villes moyennes, une dizaine environ, étaient peu nombreuses et avaient 15 à 25 000 habitants ; alors que la plupart des cités ne comptaient que 5 000 à 10 000 âmes et que les plus petites bourgades n’en avaient qu’à peine 1 500 à 2 000.
Eparses et localisées, les indications sur le peuplement des campagnes sont encore plus insuffisantes. Dans une région peu urbanisée au nord-ouest de l’Espagne, un recensement daté de la seconde moitié du Ier siècle, indique une densité de 8 à 11 habitants au kilomètre carré. Avant le IIe siècle, de très vastes pays devaient être faiblement peuplés, les Hauts plateaux du Maghreb, par exemple, ou d’Anatolie, ainsi que les Trois Gaules et les pays danubiens. Par contre, le développement de l’agriculture, dans les vallées de l’Afrique proconsulaire, en Numidie ou en Pannonie, suppose une forte augmentation de la population rurale qu’on pourrait tenter d’évaluer.
Sous le Haut-Empire, toutes les conditions d’un progrès démographique étaient réunies, favorisées par une « pax romana » quasi générale et une absence, à notre connaissance, d’épidémie universelle, malgré quelques crises de subsistance endémique. L’essor des villes, la prospérité des campagnes dans beaucoup de régions, un siècle et demi durant, postule une poussée démographique atteignant 25 à 30 %, compte tenu de la forte mortalité. La rupture semble se situer sous Marc Aurèle et Commode, vers la fin du IIe siècle, lorsque les pestes affectèrent une grande partie du monde romain. Même si leurs effets ne sont pas quantifiables, les coupes sombres taillées dans la population n’ont sans doute pas permis aux excédents de compenser une mortalité exceptionnelle, même sur plusieurs générations.
Ammar Mahjoubi
- Ecrire un commentaire
- Commenter