Francophonie : quand l’important importune
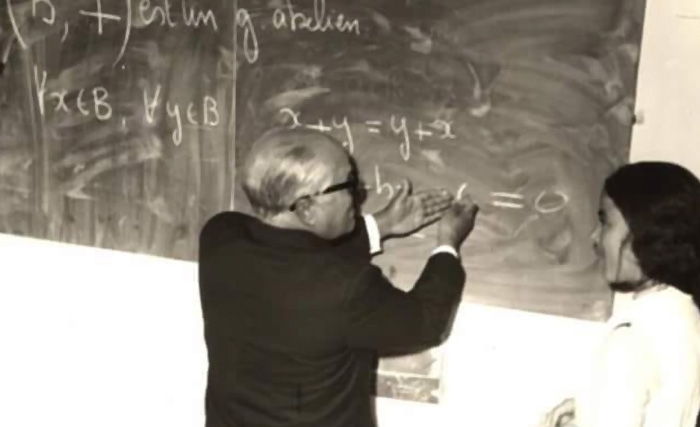
(9).jpg) Par Abdelaziz Kacem - Le cœur n’est pas au calembour et d’aucuns verraient dans ce titre une facilité. Le fait est que l’élégance a toujours dérangé la clochardisation. L’important, c’est la rose, la rose qui a manqué au printemps dit arabe.
Par Abdelaziz Kacem - Le cœur n’est pas au calembour et d’aucuns verraient dans ce titre une facilité. Le fait est que l’élégance a toujours dérangé la clochardisation. L’important, c’est la rose, la rose qui a manqué au printemps dit arabe.
Le sommet de la Francophonie - nous nous en félicitons - a enfin eu lieu. Même avec deux ans de retard, un demi-siècle d’existence se fête avec solennité. Mais nous ne sommes plus au temps des pères fondateurs. Les célébrations ne sont plus ce qu’elles étaient. Remercions, au passage, Madame Louise Mushikiwabo, la Secrétaire générale de l’OIF, pour l’hommage appuyé qu’elle a rendu au «père de la nation tunisienne en ses terres», le grand Habib Bourguiba, perpétuel coparrain de la Francophonie.
La vie, dit le proverbe, commence à 50 ans. Avant, ce n’était qu’un entraînement. Pour se développer, l’esprit a aussi ses exercices, l’équivalent d’une culture physique. Par manque d’entraînement, la langue française, elle-même, a beaucoup maigri, du moins dans nos régions. En Tunisie, mal nourrie à l’école, mal traitée par ses usagers de fortune, mal aimée dans les milieux où sévit l’identitarisme populiste, c’est dans son fief, l’alma mater, qu’elle est menacée. Naguère, parfaitement bilingue, l’Université qui est la nôtre jonglait avec ses idiomes. En traduction, aujourd’hui, le thème résiste encore, mais la version a disparu.
Des noyaux durs subsistent et les professeurs de français, véritables gardiens du temple, s’essoufflent à sauver les meubles, tandis que, survivant à tous les anathèmes, nos écrivains d’expression française font preuve d’une résilience désespérée. Ils doivent, en plus, braver un ostracisme rampant, qui s’insinue désormais jusque chez certains jurys littéraires. Plus insidieux encore, l’indigénisme bédouin, dans une grande institution culturelle, tente d’intimider les francisants, sommés de s’exprimer en arabe, même quand ils font des comptes-rendus d’œuvres exclusivement francophones.
Ces enseignants et ces écrivains linguistiquement incorrects, on espérait les voir dans les coulisses du XVIIIe Sommet. Par-delà les salamalecs convenus, ils auraient pu apporter des éclairages décisifs. La noce, hélas, s’est déroulée en l’absence des mariés, celle aussi des grands témoins, Molière et Voltaire. Et cela mériterait un développement autonome.
Que l’on se rassure cependant : aux pays du Maghreb, le français continuera d’être baragouiné, comme l’explique si bien notre amie Riadh Zghal dans Leaders (novembre dernier), mais une langue ne vaut et ne vit que par sa littérature.
Entretemps, depuis leur réduit universitaire, les départements de français, dans nos facultés des lettres et sciences humaines, peinent à entretenir la flamme et tentent de la projeter hors des murs de l’enceinte.
C’est ainsi que, du 3 au 6 novembre dernier, bien avant le Sommet et indépendamment de ses travaux, le Festival des francophonies de Sousse a tenu sa cinquième édition, grâce à la conviction, à la ténacité de ses organisateurs. Grâce en soit rendue à Férid Memmich, à Ammar Azouzi, à Sami Hochlaf et à toute leur équipe.
J’ai eu le bonheur de participer à leur table ronde du dimanche 6 novembre sur le thème, ô combien important, par les temps qui courent : «Francophonie et identité.s». Le débat en fut serré, mais unanime sur le fait que la langue étrangère n’entache en rien l’authenticité d’une identité bien établie.
L’identité, qui la définit ? De tout temps, tous les régimes totalitaires s’en emparent et, folklore à l’appui, la réajustent aux dimensions de l’idéologie. Or, l’identité ne se dicte pas. Seuls la géographie et l’histoire, le positionnement et l’événement en décident. Et tout bien pesé, que vaut une identité sans rapport avec l’altérité, sans l’apport du divers, voire de l’adverse ?
Qui suis-je ? Je ne me suis jamais posé la question. Mais elle m’a été souvent posée, ici et ailleurs. Je suis un enfant de ce pays, plusieurs fois millénaire, carthaginois des jours glorieux et des jours sombres, citoyen de la mare nostrum, quoi qu’en puissent penser les obédients au Quart-vide.
Plaque tournante des cultures méditerranéennes, outre le berbère, la Tunisie, avant la lettre, parlait le phénicien, le grec et en avant-goût du français, la langue de Virgile. Au cours de sa longue période romaine, la Province africaine constitua l’un des foyers les plus brillants de la latinité. C’est à Carthage qu’est née la première formulation du pari dit de Pascal, que dis-je ? La première littérature chrétienne d’expression latine.
Modèle de résilience, Carthage, la prestigieuse vaincue, dans son nouveau destin de capitale de la Province africaine devint, dès le IIe siècle, au moment où Rome n’était plus qu’une province comme les autres, un centre culturel particulièrement inventif. À Carthage, qui lui éleva deux statues de son vivant, Apulée (125-180), le plus grand auteur païen d’Afrique, menait une carrière d’écrivain et de tribun hors du commun. Son Âne d’or où les Métamorphoses inaugure le fantastique en littérature. C’est un chef-d’œuvre universel où s’enchâssent à l’orientale plusieurs récits. L’épisode d’Eros et Psyché aura sur la notion d’amour en Occident une influence décisive. Honnête homme exemplaire de son époque, de «beaux esprits, écrit Jean-Louis Bory, devaient le comparer, beaucoup plus tard, pour la grande souplesse de son intellect et l’universalité de ses connaissances, à Diderot.»(1) Or, tout comme les écrivains maghrébins d’aujourd’hui, cet homme pétri de culture gréco-latine revendiquait dans son Apologie son appartenance exclusive à la terre natale.
Apulée est donc l’illustre ancêtre des écrivains maghrébins qui ont choisi d’écrire et de créer dans la langue de l’Autre. Mais il n’est pas le seul. Le deuxième siècle finissant voit naître à Carthage une nouvelle éloquence.
Bouleversé par les persécutions subies par les chrétiens, à Rome, l’avocat Tertullien (155-222), autre Tunisien avant la lettre, prend la relève des apologistes grecs, dont il parle parfaitement la langue. «Je me souviens de mon Homère», aime-t-il à rappeler. Mais il choisit d’écrire dans la langue de Virgile, celle aussi d’Apulée, de trente ans son aîné. Il crée ainsi la langue théologique des chrétiens d’Occident. Auteur de plus de trente traités dont un chef-d’œuvre, Apologeticum, son style est flamboyant et ses néologismes dotent le latin de notions et de termes de base tels que trinitas, sacramentum, persona…
Apulée, Tertullien, le Kéfois Arnobe de Sicca (240-327), dit l’Ancien, Lactance (250-325) et même saint Augustin (Thagaste et Hippone faisant partie d’un même territoire, à l’époque), sont des autochtones. C’est là aussi qu’a été inventée l’écriture cursive romane. C’est également à un enfant du pays, d’Hadrumète (Sousse) précisément, le jurisconsulte Salvius Julianus (100-170) à qui l’empereur Hadrien confia la rédaction de l’Acte juridique capital, l’Edit Perpétuel. C’est à un autre enfant de Carthage, Térence (190-159 av. J.-C.), que nous devons cette superbe profession de foi formulée deux siècles environ avant J.-C. : «Je suis homme et rien d’humain ne m’est étranger».
Ces noms illustres constituent ma Jahiliyya fondatrice, sans préjudice de l’arabité, part immense de mon unicité. Issu de l’école franco-arabe, je suis agrégé d’arabe. J’écris dans les deux langues, parce que telles étaient les études en Sorbonne et il m’a été donné d’expliquer que l’arabe et le français étaient pour moi l’endroit et l’envers d’une même étoffe, que l’une des deux langues était ma mère et que l’autre était ma nourrice, ce qui fit de moi pour Villon un frère de LAI.
Il est vrai, toutefois, que la francophonie, par les grandes idées qu’elle véhicule, telles que laïcité, liberté, rationalité, ne laisse pas de déséquilibrer ceux dont l’identité se fonde essentiellement sur la croyance religieuse.
Abdelaziz Kacem
1) Cité par J.-L. Bory, préface, l’Âne d’or, collection folio, Gallimard, 1975, p. 15.