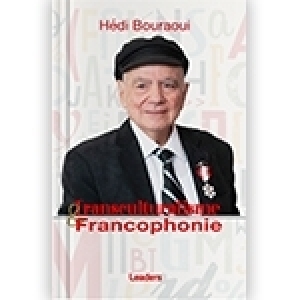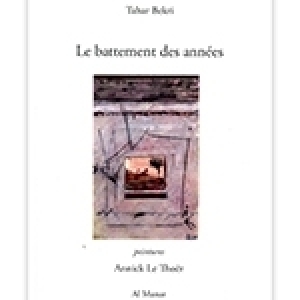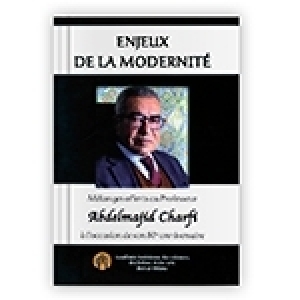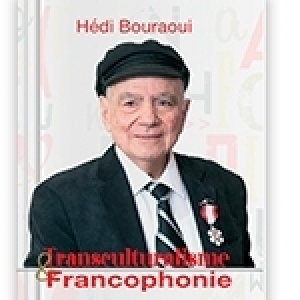La traduction de "Harakat": une entreprise à hauts risques
 Il y a une trentaine d'années, le grand romancier tunisien, Mustapha Fersi avait publié son roman "Haraket", un nouveau pavé que notre regretté romancier jetait dans la mare de la production éditoriale de cette époque, suscitant des polémiques à n'en plus finir. Car Mustapha Fersi prenait un malin plaisir à provoquer ses lecteurs par ses contorsions de style, toujours déroutantes et sa révote permanente contre le convenu. C'est pourquoi ses oeuvres étaient difficilement traduisibles. C'est pourtant à cette entreprise hasardeuse que notre ami Mansour Mhenni s'est essayé répondant aux sollicitations de ses amis, Adam Fethi et Mohamed Mahjoub, "en sachant bien qu'ils me jetaient dans la gueule du loup… Ils savaient sans doute aussi, en le faisant, qu'il peut y avoir du bonheur à se trouver dans la gueule du loup".
Il y a une trentaine d'années, le grand romancier tunisien, Mustapha Fersi avait publié son roman "Haraket", un nouveau pavé que notre regretté romancier jetait dans la mare de la production éditoriale de cette époque, suscitant des polémiques à n'en plus finir. Car Mustapha Fersi prenait un malin plaisir à provoquer ses lecteurs par ses contorsions de style, toujours déroutantes et sa révote permanente contre le convenu. C'est pourquoi ses oeuvres étaient difficilement traduisibles. C'est pourtant à cette entreprise hasardeuse que notre ami Mansour Mhenni s'est essayé répondant aux sollicitations de ses amis, Adam Fethi et Mohamed Mahjoub, "en sachant bien qu'ils me jetaient dans la gueule du loup… Ils savaient sans doute aussi, en le faisant, qu'il peut y avoir du bonheur à se trouver dans la gueule du loup".
 Dans sa préface à l'édition française du livre qui vient de paraître, Mansour Mhenni s'explique sur les raisons de son choix et les difficultés qu'il a rencontrées dans "cette aventure périlleuse" que représente la traduction en français de "Haraket".
Dans sa préface à l'édition française du livre qui vient de paraître, Mansour Mhenni s'explique sur les raisons de son choix et les difficultés qu'il a rencontrées dans "cette aventure périlleuse" que représente la traduction en français de "Haraket".
"Pensez quelle grandeur ce serait de voir une seconde langue répondre à toute l’élégance de la première: et encore avoir la sienne propre. Mais […] il ne se peut faire" (PELETIER, J., Art poétique, p. 265).
il ne se peut faire" (PELETIER, J., Art poétique, p. 265).
Il y a toujours eu dans Mustapha Fersi quelque chose qui m’interpellait et que je n’arrivais pas à cerner avec précision. Au début de mon intérêt pour la traduction, d’abord dans le cadre pédagogique à l’université, puis pour mon plaisir personnel, j’ai commencé la traduction de Al Qantara Hya Al Hayet (Le Pont c’est la vie) de cet auteur; mais d’autres urgences, universitaires et autres, m’ont empêché d’aller au bout de cette entreprise, comme d’ailleurs au bout d’autres tentatives du même genre concernant des textes de la littérature tunisienne qui me faisaient des signes particuliers.
Entretemps, j’ai connu M. Fersi dans des rencontres littéraires et autres, et deux ou trois fois autour d’une table. J’ai eu ainsi à effleurer chez lui cette passion de la vie qui n’avait d’égale que sa passion de la parole. Je ne me suis plus départi alors de mon profond respect pour cet homme, signe d’une affection discrète qui n’a eu ni le temps, ni l’occasion de s’épanouir pleinement. Dans tout cela, Haraket restait en dehors du champ de mes investigations littéraires, jusqu’au décès de l’auteur et à l’attention plus intéressée que j’ai eu le loisir et le plaisir d’accorder à sa vie et à son œuvre, pour des raisons culturelles et professionnelles. J’ai eu ainsi à constater que l’immense culture que je soupçonnais en lui était réelle et que le sens de la modernité littéraire était effectif dans sa tâche créatrice, avec cette part certaine de la jouissance ouverte à l’altérité et à l’universalité.
Puis, par le fait d’un complot amical, je me suis trouvé à traduire ce livre (C’est trop risqué de l’appeler «roman») que d’aucuns se plaisent à considérer comme intraduisible. Aujourd’hui que cette traduction est faite, «nullement parfaite mais perfectible encore comme un homme ou comme une société», je me dois de reconnaître la difficulté de la tâche et de formuler l’espoir de voir cette traduction s’améliorer dans d’autres traductions, pour rendre justice à ce texte qui ne me paraît pas avoir encore l’attention médiatique qu’il mérite, ni l’intérêt critique qu’on lui doit – et cela n’est pas dû au simple fait qu’il a été censuré à sa première parution, comme il plaît à Jalloul Azouna de le souligner.
***
C’est à la traduction qu’on perçoit encore mieux la valeur de ce texte et l’intensité de son labeur. Aussi ai-je doublé ce travail de traduction par un autre de comparaison entre les deux éditions du livre, celle de 1978 et celle de 1996, et ai-je multiplié les notes du traducteur (NDT) chaque fois qu’il m’a paru utile d’insister sur un aspect du livre ou de suggérer un centre d’intérêt critique, toujours dans l’espoir de voir un jour ce modeste travail de traduction inciter à la publication d’une édition critique de Haraket et à la dynamisation du discours critique, voire du mouvement de modernité littéraire annoncés à la parution du livre, mais jamais assez développés.
Sinon, ce livre aura été comme plusieurs textes fondateurs qui, n’ayant jamais réussi à faire école, sont peut-être à l’origine des principales écoles qui leur ont succédé, sans qu’aucun mérite ne leur soit reconnu.
En fait, publié quelques mois après les événements du 26 janvier 1978 où se sont affrontés syndicalistes et forces de l’ordre, Haraket a vu la perception de sa littérarité affectée par le contexte historique de sa première parution. En ce temps de fermeture politique, l’opposition avait besoin d’un texte de référence dans la création littéraire et le texte de Mustapha Fersi, qui a peut-être été écrit dans cet esprit pour une petite part de ses motivations, est arrivé bien à propos pour porter cette charge symbolique du discours d’opposition. Cela a eu pour conséquence l’occultation relative de la dimension essentiellement littéraire, voire artistique, du texte au profit de la cause militante dont on l’a exagérément (sur-)chargé, un peu comme ce qui était arrivé à Kateb Yacine dans l’essentiel de son parcours pendant plusieurs années et dans plusieurs lieux de la critique de la littérature maghrébine de langue française.
Dans son article «Les fondements d’une lecture intégrale de la littérature arabe : Haraket» annexé à l’édition de 1996 en guise de postface, Mahmoud Tarchouna explique la structure du roman par le désir de l’auteur de «se révolter contre les formes classiques et habituelles», de rendre compte de sa propre expérience créatrice dans différents genres de l’expression artistique et littéraire et de donner aux différents tableaux qui se succèdent dans le livre un mouvement impossible dans un seul genre littéraire. Et l’auteur de l’article de souligner l’antériorité d’un tel procédé chez Ezzeddine Madani.
Ces propos de M. Tarchouna ne me semblent pas rendre justice à M. Fersi, particulièrement dans Haraket où la modernité ne saurait se limiter à un assemblage (un «cocktail», note J. Azouna) de formes littéraires, apparenté à la technique du collage.
D’ailleurs, M.Tarchouna passe rapidement sur cette question pour s’étendre largement sur la question qui l’intéresse le plus, en l’occurrence la situation des pays arabes devant les problèmes de la liberté, de l’abus de pouvoir, de l’unité et de la responsabilité de l’intellectuel engagé. M.Tarchouna nous paraît ainsi répondre à un horizon d’attente lectoriale qui pourrait expliquer la négligence de la part spécifique de littérarité du texte de M. Fersi. Ainsi, dans un souci d’auto-justification de son approche dite éclectique et intégrale, M.Tarchouna évoque, à la conclusion de son article, le besoin d’une étude «complémentaire» consacrée à «l’aspect linguistique et à même de prouver l’association des contraires sur laquelle se fonde tout le livre (le littéraire, le dialectal et la troisième langue). Le style aussi, dans son hésitation entre le suggestif et le commentatif, mérite une attention particulière».
Mais, n’y a-t-il pas lieu de se demander : Et si ce «complémentaire» de la littérarité était l’essentiel de Haraket ?!
***
D’un autre côté, Haraket a sans doute été victime aussi de l’engouement attardé pour le formalisme et le structuralisme dans la critique littéraire de langue arabe qui, pour le peu d’articles consacrés à ce livre, s’est limitée à y souligner une certaine originalité structurelle liée à l’écriture transgénérique et à l’intertextualité.
A ce propos, il importe peut-être de rappeler que l’intertextualité n’est pas une poétique nouvelle mise à la disposition des créateurs ; elle est juste une approche « postmoderne », serait-on tenté de dire, ramenant les outils du passé (l’école des influences littéraires) dans l’enceinte de la poétique comme un champ privilégié de la modernité de la critique et de la théorie littéraires. Faut-il souligner alors que, pour la seule littérature tunisienne contemporaine, Haddatha Abu Houraïra Qal de Mahmoud Messaadi est un chef-d’œuvre de la polyphonie littéraire et que le livre du Marocain Abdelfettah Kilito, l kateb yacine roman ’auteur et ses doubles, a développé cette question avec force arguments, en ramenant la logique intertextuelle à certaines de ses manifestations évidentes dans la littérature arabe classique.
Quant à l’écriture transgénérique, et pour rester dans le seul cadre maghrébin, il n’est pas inutile de souligner que Nedjma de Kateb Yacine, que M. Fersi ne pouvait ignorer , est un chef-d’œuvre du genre, publié en 1956. C’est pourquoi J. Azouna, dans sa préface à l’édition de 1996 ayant pour titre « Le roman Haraket de Mustapha Fersi et l’annonce d’une nouvelle ère de la littérature », prend la précaution, en évoquant cet aspect du texte de M. Fersi, de préciser : « L’Occident a vu naître de nouvelles méthodes d’écriture abolissant les frontières entre les genres et de nouvelles approches critiques essayant de comprendre ces nouveaux modes d’écriture. »
Cependant, il faut reconnaître à J. Azouna le mérite de toucher, dans le quatrième volet de sa préface (« La linguistique de Fersi : ou la lettre comme embryon de la parole »), à ce qui nous paraît constituer l’essentiel de Haraket : « Les lettres d’alphabet ne sont pas chez Fersi un prétexte pour le souvenir, c’est plutôt l’imagination de l’écrivain qui joue un grand rôle et qui fait des lettres le but, la destination et la fin du sujet essentiel […] Haraket nous ramène à l’origine des choses, en l’occurrence la lettre, racine de toute chose et de toute civilisation » . Un développement plus ample et une étude plus minutieuse auraient aidé à replacer le livre sur la trajectoire qui est la sienne, celle du mouvement de la littérature vers son éternelle recherche d’une écriture toujours renouvelée, toujours réinventée, une écriture de la modernité.
***
La traduction permet une plongée des plus profondes dans les dédales du texte et dans les menus creux qu’il laisse ouverts à l’exploration et à la fécondation lectoriale et/ou (re-)créatrice. Ma descente aux doux enfers de ce texte de M. Fersi m’a permis de (re-)cueillir certaines remarques qu’il n’est peut-être pas abusif de chercher à partager aussi bien avec le dilettante amusé qu’avec le chercheur intéressé, ou tout simplement de se décider à les jeter comme une bouteille à la mer avec l’espoir de les croire un jour arriver à bon port – n’est-ce pas cela en vérité la destinée de tout écrit ?
La première observation que l’on a au contact de Haraket, c’est cette respiration profonde et ce rythme de vie qui animent tous les lieux de l’expression, débordant le signe et allant au-delà de toute signification. Evidemment, la critique moderne appelle cela une « forme-sens » pour souligner cette interaction fondamentale entre le dire et son objet, entre le dire et le faire. Il va de soi aussi que, du point de vue d’une approche sociologique, on veuille y retrouver l’adéquation recherchée entre la parole et l’action dans la logique d’engagement, souvent perçue dans sa dimension essentiellement politique. Mais chez Mustapha Fersi, le mécanisme est plus « tragique », est-on tenté de dire, car plus existentiel, réinterrogeant l’essence de la relation tragique de l’homme non seulement à la parole comme une unité constituée, mais à toute micro-unité de la parole, fût-elle une lettre écrite, un phonème prononcé ou même une intonation dans la modulation de la voix.
Certes le premier exemple que l’on cite à ce propos, comme le fait J. Azouna, c’est celui de Gahtour dont une lettre d’alphabet a engagé le destin. Mais à l’autre bout de cette même logique, ne peut-on pas évoquer l’exemple du muet qui se fait condamner parce qu’il ne peut pas parler. Ainsi, l’absence de signe linguistique devient elle-même signe, et même signe pluriel, double au moins, porteur de la signification qu’y retrouve d’un côté le juge, de l’autre le poète.
Entre les deux, entre la mutité et l’a-mutité, il y a la lettre que l’on prend souvent pour un constitutif du mot, ce dernier étant l’unité première de la parole. Mais la lettre est chez Fersi un « être » doté de tous les qualificatifs que l’on peut attribuer à un être vivant. Que l’on ne s’y méprenne pas ! Il n’y a pas là une métaphore établissant une simple contiguïté du monde des humains et de l’univers des lettres. Il y a une superposition des destinées de deux mondes qui n’en font qu’un en vérité, à telle enseigne qu’aucune distinction n’est plus possible entre l’être et la lettre.
Cette communauté de destin où sont l’être et la lettre fait qu’il n’y a plus les questions du monde et les questions de littérature, qu’il n’y a plus de texte et de méta-texte ; tout est parlant, tout est vivant : tout est en mouvement. Cela nous rappelle une affirmation de Kateb Yacine qui disait que tout est en révolution parce que la révolution, c’est le mouvement de l’univers. M. Fersi semble ajouter : « … et du langage aussi, malgré qu’il en ait ! ».
Les lettres sont alors en révolution, autrement dit en gravitation permanente, comme des âmes en peine, cherchant à donner un sens à leur être, s’amusant au besoin à signifier chacune par elle-même (exemple le Del qui désigne la lettre et « le signifiant ») ou à signifier au hasard des rencontres et des associations. « Tels les personnages de Pirandello, elles continuent à chercher un metteur en scène à même de préciser leurs déplacements dans le théâtre de la vie ». Et voilà que les lettres Alef, Lam et Mim, par exemple, se voient en mouvement entre cette mystérieuse jonction disjonctive de « alef lam mim » dans le Coran et cette douloureuse jonction conjonctive de « Alam » (« douleur », sa traduction par « mal » reconduit le principe générateur du mot dans le texte arabe), dans le vocabulaire.
En fait, c’est dans cette perspective aussi qu’il conviendrait de considérer le rapprochement ou la similitude que d’aucuns relèvent entre l’écriture de Fersi et le style du Coran. A ce propos, ce serait une grave méprise de penser à une écriture imitative. Il importe même de rester attentif aux nombreuses occurrences où un lecteur peu averti croit retrouver des citations du Coran. Cependant, vérification faite, il découvre le leurre (par exemple, l’expression « Kathibon wa bahtanon », mensonge et calomnie, évoque une intonation et une structure coranique ; elle est courante dans la langue, mais nulle part ainsi donnée dans le Coran). Plus même, M. Fersi se permet de comprimer un verset du Livre Saint en en ôtant certains mots, comme quand il écrit « Tenez bon et ne vous séparez point » qui est donnée autrement dans le Coran, en l’occurrence « Tenez bon à la corde de Dieu et ne vous séparez point ». C’est que M. Fersi cherche à s’attaquer au tabou textuel et au principe de l’immuabilité de la langue sacrée pour réinscrire le langage en général et la langue en particulier dans la logique du mouvement, c’est-à-dire dans la logique de la vie.
Là intervient cette question de l’utilisation des trois niveaux de langue, que les commentateurs ont relevée sans l’analyser profondément. En fait, ces trois niveaux de langue sont trois tranches de vie de la langue, trois tranches de la même vie de la langue ; tout comme la douleur de toute personne et de toute catégorie humaine est en fait la douleur de la même humanité quelque soit l’aspect qu’elle prend et quelque soit le rôle qu’elle joue dans le théâtre de la vie. Dès lors, au plus littéraire des niveaux de langue vous surprend parfois un mot bien habillé de son costume classique et qui n’est rien d’autre qu’un mot du langage courant. Ainsi qu’au cru du langage populaire, des mots et des formules autrement déclinés s’avèrent constitutifs de ce que l’on convient souvent de considérer comme le « beau langage ».
C’est de ce point de vue que j’ai parlé de respiration intérieure de la parole fersienne (Entendez « persienne », si cela vous enchante !), une respiration qui oscille entre le souffle hoquetant d’un langage qui dialogue davantage avec lui-même qu’avec ses personnages, et le rythme régulier d’une musique qui semble se chanter elle-même parce qu’en elle réside la musique du monde. Cela est perceptible encore à cette hésitation de l’auteur, d’une édition à l’autre, sur la distribution de la ponctuation et sur la disposition des paragraphes, des versets ou des alinéas, comme pour souligner un certain malaise générateur de la langue arabe, jadis non ponctuée et dépourvue de signes diacritiques (à souligner les nombreux lieux où l’auteur apporte des indications entre parenthèses sur ces signes diacritiques pour donner le soupçon d’un autre sens ou le préciser au besoin), devant ce phénomène nouveau, conquis au fil de l’Histoire tel un butin de guerre, mais difficile à intégrer totalement dans son système. C’est à qui prend le pas sur l’autre au gré des forces de la règle ou du hasard des pérégrinations de l’usage !
Et la tâche du traducteur d’en être encore plus laborieuse!
***
La seconde observation qui interpelle vient de cette auto-génération des mots dans le texte, comme si ces mots n’étaient pas commandés par la logique du sens mais par la logique des sons, comme si l’enchaînement n’était pas syntaxique mais phonétique (et cela n’est pas pour le seul effet du sajaa’, la rime interne) ; pourtant ces mots ne s’en retrouvent pas moins en harmonie avec la logique de signification conduite par Haraket. S’interroger alors sur l’antériorité de l’un ou de l’autre, le son ou le sens, c’est se trouver piégé dans la question de l’antériorité de la poule ou de l’œuf. Au commencement était certes le verbe, mais celui-ci est-il « être » d’abord ou lettre ? C’est la question !
Dès lors la traduction ne peut s’inscrire qu’au centre du principe de la (re-)création, dans cette fidélité au principe plutôt que dans la fidélité au système. Qu’importe ainsi si la traduction du principe ne reconduit pas toujours fidèlement le sens, il faut alors se contenter de ce que faire se peut, sans guérir tout de même de cette angoisse inhérente à toute entreprise de traduction devant la hantise du sens et la mainmise de la lettre.
Telle est l’aventure où l’on se risque de traduire « Dumu’ » (larmes) obtenu à partir des quatre lettres arabes Del, Mim, Waw et Ain. Comment donc reconduire ces quatre lettres sans perdre totalement le signifié ? L’étymon latin a été le seul recours et « damnum » l’issue la plus plausible.
Telle est l’angoisse que l’on a devant la substitution d’un mot par un autre, d’une édition à l’autre, preuve de ce jeu de lettres que continue de l’auteur pour souligner davantage que son travail s’inscrit à ce niveau plus qu’au niveau du sens. Ainsi, quand d’une édition à l’autre, une lettre change le mot et parfois le sens (tah’taju et tajtah’u / « nécessite » et « envahit » ; zarzah’ et zah’zah’ / le sens de « bouger »), le traducteur s’arrête inquiet et se replace en contexte de recréation pour valider l’une ou l’autre option qui convient à la traduction, toujours malgré l’auteur, celui de la première édition et celui de la deuxième. Car, contrairement à ce que disait Nerval (La treizième revient c’est toujours la première), la deuxième déjà, ce n’est plus la première.
***
Il importe de relever néanmoins dans ce texte de M. Fersi, -- c’est la troisième observation -- ce que l’on pourrait appeler un « principe d’hospitalité » de l’auteur à l’égard de son traducteur potentiel ; en effet, à plusieurs moments, on a le sentiment que l’auteur choisi les associations qui, à la traduction, francophone au moins (ce qui ne peut échapper à notre auteur), donnerait la formule qui convient au contexte et s’inscrit dans le principe du texte.
L’on peut donner ici l’exemple de la fin du chapitre du Del qui finit par « jusqu’au… Jah’im !! jusqu’à Mim » !! Il est impossible de traduire « Jahim » par « enfer », sans quoi se perd totalement le cheminement qui articule le chapitre du Del au chapitre suivant du Mim. Ainsi ; l’auteur semble commander à son traducteur de se situer dans un inter-langue où le lecteur francophone par exemple est obligé de pénétrer le principe même du fonctionnement de la langue arabe, et d’avoir ainsi avec cette langue un contact physique en plus du contact intellectuel.
Un mot ajouté à la seconde édition peut parfois trouver sa justification dans ce principe d’hospitalité à la traduction, tel le mot « de l’affaire » ajouté au mot juridique « les attendus ». Car ce dernier seul ne pose pas problème en arabe, mais en français, on est plus à l’aise avec « les attendus de l’affaire ».
L’exemple de l’enfant qui pleure dans le chapitre du Waw est sans doute plus explicite de cette hospitalité. En effet, dans la phrase « Il pleurait… les larmes pleuvaient de ses yeux perdus », la première proposition (il pleurait) est ajoutée dans la seconde édition comme pour actualiser dans l’esprit du traducteur francophone les deux vers de Verlaine (Il pleure dans mon cœur / Comme il pleut sur la ville) et le pousser à se situer dans le principe de la « contagion homophonique».
***
La quatrième observation porte sur le titre du livre
Traduire le titre d’un livre revêt une importance fondamentale, car traduire le titre, ce n’est pas seulement traduire un mot ou une expression (un syntagme, si vous préférez), c’est traduire l’esprit du livre qui, quand il s’agit d’un texte de création littéraire, suppose un éclatement polysémique et une (il-)logique d’ambiguïté à même de dissiper les frontières du sens et de faire régner une dynamique de signifiance fluide et souvent peu saisissable. Telle est la nature de la littérature et tels sont en fait son sens (dans les deux sens) et son essence. Comment donc ne pas s’interroger, longuement et profondément, sur la traduction d’un livre comme Haraket dont tout le mouvement tourne autour de la polysémie, de l’ambiguïté et de l’errance des signes?
Ainsi, la traduction du titre du livre de Mustapha Fersi, «Harakat», ne va pas sans douleur, celle de la gestation d’un fruit de fidélité dans un acte d’infidélité, car tel est, dit-on, l’acte de traduction. Dût-on à la fin se conformer à ce qui est communément admis ou attendu, on se doit de creuser à la tâche et de fouiner les dédales de l’expression pour se justifier du parti à prendre, fût-il celui de la conformité ou celui de la dissidence.
Au départ, il y avait évidemment la possibilité de reconduire le titre dans sa langue d’origine avec sa transcription en écriture latine, comme il en est dans cette préface. Solution de facilité, s’empresseront de dire certains; riche et provocante interpellation interlinguale et interculturelle du destinataire francophone, expliqueront les autres. Sans rejeter cette éventualité, le traducteur est obligé de chercher plus loin.
Pourquoi chercher, remarquerait-on, puisque l’auteur lui-même traduit son titre par «Mouvements» ? Voilà une autre facilité à éviter dans ce genre d’entreprise! En tout cas la poétique moderne a fini par imposer l’idée que les propos d’un auteur sur son livre ne sont à considérer que comme un paratexte. Au mieux constituent-ils un autre signe du texte qui continue son fonctionnement contextuel, davantage pris en charge par le texte et par son environnement critique que tuteur lui-même d’un texte dont le géniteur ne maîtrise plus les mouvements depuis qu’il l’a jeté, bouteille à la mer, et qu’il l’a laissé partir balloté par les vagues de la curiosité, du désir ou de l’animosité.
Pour ma part, j’ai fait la première traduction du livre (car on ne traduit pas une seule fois) sous le titre «Signes», car je me sentais pris dans la dynamique métalinguistique et métatextuelle et le livre, tel que souligné ci-dessus, me paraissait (je crois qu’il l’est de toute manière, au moins d’une certaine manière) comme la tentative de faire une transposition du mouvement des signes linguistiques sur la vie sociale pour dégager les jeux des pouvoirs sociaux de l’emprise idéologique stricte et les soumettre à «l’empire des signes». Ce titre «Signes» m’a beaucoup interpellé et continue de me séduire; en tout cas je le sens plus proche de l’interrogation essentielle et existentielle qui couve dans les tréfonds de ce livre. Mais là aussi, je l’avoue, on n’échappe ni à la tentation du consensus, ni à l’influence de l’environnement, et l’on se retrouve alors dans cette posture de lâcheté à l’égard du texte qui pousse à «faire dans la fidélité» ce qu’on ne peut faire fondamentalement que dans l’infidélité.
Que l’on ne s’y méprenne pas cependant: le titre «Mouvements» se justifie logiquement plus que tout autre et c’est sans doute pourquoi il est à mettre sur le compte de la fidélité, fidélité à ce qu’il a été convenu de considérer (paratexte et discours critiques aidant) comme «l’intention de l’auteur» et fidélité à ce que semble être la perception générale du texte par les lecteurs, qui sont d’une certaine manière des formes de fidélité au texte.
En effet, comme précisé précédemment; il y a dans le livre une ambiance de violents mouvements sociaux qui n’a pas manqué de commander sa réception si bien qu’il s’est trouvé de fait relié à un contexte historique auquel il ne fait pourtant aucune référence explicite, comme ce fut le cas de plusieurs œuvres de la littérature universelle et l’on a sans doute encore en mémoire, à titre d’exemple, toute la dynamique de lecture de la pièce de Jean Giraudoux, La Guerre de Troie n’aura pas lieu, par rapport à la Seconde Guerre Mondiale.
Mais il y a aussi dans le livre le développement filé du paradigme de la musique et la conduite des composants du texte comme des mouvements dans une partition musicale. Cela est explicite et tellement souligné que l’idée des mouvements musicaux s’impose aussi dans le titre et justifie l’option «Mouvements» comme traduction de «Harakat», sans oublier que telle est effectivement la traduction littérale du titre. Cela paraît d’autant plus convenable dans ce livre que la langue de référence ici, c’est la langue arabe, prise comme sujet et objet du discours, et que la prononciation des phonèmes dans cette langue est répartie en gammes comme les gammes musicales. Il y aurait ainsi comme un souci de ramener la langue arabe à son origine musicale pour la ranimer du souffle de l’oralité, signe de toute vraie vie d’une langue.
De fait, un mouvement social existe-t-il et vaut-il vraiment sans les mots pour le dire, les mots qui sont peut-être son vrai faire et le principe de son action? Par ailleurs, mouvements musicaux et mouvements sociaux ne sont-ils pas eux aussi des univers de signes, à la fois signes des temps et surtout signes du langage?
Quelque part en moi je reste donc fidèle à mes «Signes»; mais pour des raisons éditoriales, j’opte pour les «Mouvements» des autres.
- Jacques Peletier publie son Art poétique en 1555, cet extrait est tiré de l'édition du livre de poche en 1990, pp. 265.
- Mansour M’henni, Rosée suivi de Tempêtes et Autres vers (poésie), Sousse, Dar Nejma, 1992.
- Jalloul Azouna, « Le roman Haraket de Mustapha Fersi et l’annonce d’une nouvelle ère de la littérature », Préface à l’édition de 1996 de Haraket, Tunis, Dar Sahar, 1996, p. 13.
- Mustapha FERSI, Haraket, Tunis, MTE, 1978 (première édition). Tunis, Dar Sahar, 1996 (seconde édition).
- NDT : Jalloul Azouna note la même idée dans sa préface à l’édition de 1996 de Haraket (Op. cit.) : « Dans la littérature tunisienne, on peut considérer la parution du « roman » Haraket de Mustapha Fersi comme le point de départ d’une nouvelle écriture dépassant ce qui accoutumé des points de vue du fond et de la forme, même si Fersi, lui-même, n’a pas poursuivi l’expérience et même si l’idéal qu’il a présenté n’a pas encore tenté – à notre connaissance – quelqu’un d’autre[…] »
- J. Azouna précise, dans la préface de Haraket (Ibid.), que ce texte est un extrait du livre de M. Tarchouna, Recherches sur la littérature tunisienne contemporaine, Imprimeries Unifiées, 1989, pp. 63-83. Il précise en plus (note de bas de page) que l’article a fait l’objet d’une communication prononcée dans les travaux d’un colloque « La lecture et l’écriture », organisé par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Tunis en 1982 ; la communication ayant été publiée dans les Actes du colloque en 1988.
- « Al Insan Assifr » de E. Madani reste un moment crucial de la littérature tunisienne contemporaine, au-delà des problèmes liés à son édition et à sa diffusion. Mais sommes-nous sûrs d’avoir exploré, aujourd’hui encore, l’essentiel de son originalité ? Peut-être en est-il ainsi d’ailleurs de quelqu’un comme Messaadi !
- N’oublions pas que M. Fersi était non seulement un bon bilingue ; mais qu’il s’était même essayé à la poésie de langue française. C’est ce dont témoigne Ahmed Kédidi dans sa préface de la première édition de Haraket (1978), Tunis, MTE, 1978, pp. 8-9 : « […] Il me lisait ses poèmes en langue française, car le français n’était pas sa langue mais son refuge, son abri et son recours, il se cramponne à ses bords quand il vit une histoire d’amour, une histoire d’oppression ou une histoire de perte […] »
- J. Azouna, préface Op. cit.
- L’expression est empruntée à Michel DEGUY dans son article « Tutoiement de Salah Stétié » dans Nunc, revue passagère 15, Editions Corlevour, Mars 2008, p. 30 : «Je compare le poème à la prononciation, courtoise par essence, qui distingue les mots, les syllabes, les phonèmes, articulés discrètement, afin d’accueillir l’autre, le lecteur étrange et étranger, dans sa langue ? Principe d’hospitalité, qui est de traductibilité : un poème est traductible, c’est-à-dire pense aux autres, auditeurs homophones ou non, qui vont l’accueillir, le traduiraient, et peut-être le traduiront. »
- Dans la poétique moderne, on peut peut-être parler de « traducteur implicite », comme on parle d’auteur implicite et de lecteur implicite.
Cf. « Interview donnée par M. Fersi à Habib Belaïd au micro de RTCI », document annexe joint à la fin de cette traduction.
- Ecrire un commentaire
- Commenter