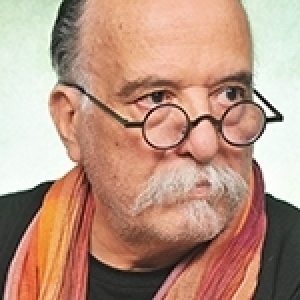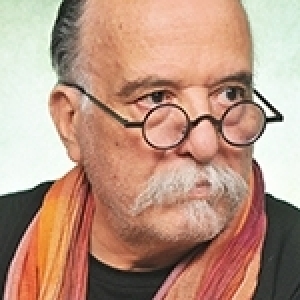John Kennedy, l’Algérien

Il y a 52 ans, le 22 novembre 1963, le président des Etats-Unis, John Kennedy, était assassiné à Dallas, au Texas. Son assassin présumé, Lee Harvey Oswald, sera abattu le 25 dans les locaux de la police en présence de près d’une centaine de policiers et officiels par le propriétaire de plusieurs boîtes à Dallas, Jack Ruby, et l’on ne connaîtra pas de sitôt, malgré le rapport Warren du nom du Président de la Cour suprême établissant la culpabilité du seul Oswald, l’entière vérité sur le crime.
 John Kennedy avait succédé en 1960 à Eisenhower. Mais trois ans avant son entrée à la Maison Blanche, le 2 juillet 1957, le sénateur démocrate du Massachussetts prononcera au Sénat un discours retentissant en faveur de l’indépendance de l’Algérie où il s’est employé à démontrer méthodiquement les limites, voire la faillite française vis-à-vis de sa colonie, dressant un bilan sévère des années de colonisation des pays du Maghreb.
John Kennedy avait succédé en 1960 à Eisenhower. Mais trois ans avant son entrée à la Maison Blanche, le 2 juillet 1957, le sénateur démocrate du Massachussetts prononcera au Sénat un discours retentissant en faveur de l’indépendance de l’Algérie où il s’est employé à démontrer méthodiquement les limites, voire la faillite française vis-à-vis de sa colonie, dressant un bilan sévère des années de colonisation des pays du Maghreb.
Il estimait que la guerre d’Algérie avait réduit les forces continentales de l’Otan à l’état de squelette par la mobilisation d’un fort contingent français et imposé à la France une véritable économie de guerre. De même, il expliquait que la guerre avait sapé les relations américaines avec la Tunisie et le Maroc, naturellement solidaires avec l’Algérie, qui reprochaient aux Américains leur alignement permanant sur la France jusqu’à faire dépendre leur aide aux deux pays de l’aval de leur allié. Le sénateur ajoutait que la guerre avait également mis en danger l’existence des bases aériennes américaines stratégiques, tout en menaçant les avantages géographiques acquis au détriment de la zone d’influence communiste.
Qualifiant de faute grave la capture en plein ciel des leaders du FLN qui ruinait, selon lui, toutes les chances d’un cessez-le-feu et portait un coup sévère à l’image de la France dans le monde, il adressait des reproches amers au président du Conseil français d’avoir tout fait pour torpiller les efforts de Bourguiba en faveur de l’entente entre les belligérants, allant jusqu’à l’interruption arbitraire de l’aide économique française à la Tunisie.
Il adressait des critiques acerbes envers l’administration américaine avec ses positions négatives à l’ONU et reprochait particulièrement aux responsables de son pays d’avoir laissé les Français utiliser du matériel militaire américain en Algérie ».
Il jugeait que «l’on ne pouvait considérer avec fierté le bilan américain à quelques jours de l’anniversaire de l’indépendance et dressait également un bilan assez sombre de la présence française en Tunisie et au Maroc. Il estimait que le problème n’était plus de sauver le mythe de l’empire français. Le problème, précisait-il, était de sauver la nation française en même temps que l’Afrique libre». Il déposera, à l’issue de son discours, le projet de résolution suivant:
Que le Président et le secrétaire d’Etat soient autorisés et fermement encouragés d’user de toute l’influence des Etats-Unis dans les efforts à faire, soit par l’entremise de l’Otan, soit en faisant appel aux bons offices du président du Conseil tunisien et du Sultan du Maroc, en vue d’amener une solution reconnaissant l’autonomie de l’Algérie et établissant des bases pour un système d’interdépendance avec la France et les nations voisines.
 Le Sénat décide en outre que dans le cas où des progrès substantiels n’auraient pas été réalisés lors de la prochaine session de l’Assemblée générale des Nations unies, les Etats-Unis devront appuyer l’effort international en faveur de l’Algérie, destiné à permettre à ce pays d’obtenir légitimement l’indépendance. Lors du débat général, les sénateurs exprimèrent le soutien, les réserves ou l’opposition à l’initiative de Kennedy selon leur conviction ou appartenance. La position du gouvernement viendra de la bouche du secrétaire d’Etat Foster Dulles qui déclara le même jour, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire, qu’il vaut mieux attaquer le colonialisme là où il se manifestait sous la forme la plus virulente, en Lituanie, en Estonie, en Pologne et dans les autres pays satellites communistes, soulignant que la France avait accordé leur indépendance à cinq pays depuis la guerre: le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Tunisie et le Maroc, et qu’on ne peut donc pas considérer de ce point de vue les Français comme réactionnaires.
Le Sénat décide en outre que dans le cas où des progrès substantiels n’auraient pas été réalisés lors de la prochaine session de l’Assemblée générale des Nations unies, les Etats-Unis devront appuyer l’effort international en faveur de l’Algérie, destiné à permettre à ce pays d’obtenir légitimement l’indépendance. Lors du débat général, les sénateurs exprimèrent le soutien, les réserves ou l’opposition à l’initiative de Kennedy selon leur conviction ou appartenance. La position du gouvernement viendra de la bouche du secrétaire d’Etat Foster Dulles qui déclara le même jour, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire, qu’il vaut mieux attaquer le colonialisme là où il se manifestait sous la forme la plus virulente, en Lituanie, en Estonie, en Pologne et dans les autres pays satellites communistes, soulignant que la France avait accordé leur indépendance à cinq pays depuis la guerre: le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Tunisie et le Maroc, et qu’on ne peut donc pas considérer de ce point de vue les Français comme réactionnaires.
Il ajouta que le problème algérien était exceptionnellement difficile et compliqué du fait de la présence d’une très importante minorité européenne en Algérie. Soulignant les divisions au sein de la population algérienne et la difficulté de trouver des personnalités responsables pour représenter valablement leur pays, il indiqua son doute quant à l’utilité d’une intervention directe des Etats-Unis dans la situation algérienne, l’aide américaine restant toujours offerte au cas où le besoin s’en ferait sentir. Le Président Eisenhower lui emboîte le pas le lendemain 3 juillet en adressant de vives critiques sur les propositions du sénateur démocrate. Il déclare que « l’Algérie est une affaire intérieure française et nous n’aurions le droit de nous en mêler que si les deux partis, le gouvernement de Paris et les insurgés, nous demandaient de les aider à trouver un règlement pacifique». Confirmant l’analyse développée la veille par son secrétaire d’Etat, il considéra que c’était «une erreur de trop simplifier la politique étrangère d’un pays en ne tenant pas compte de tous les aspects d’une question».
La France vivait en 1957 à l’heure de la Bataille d’Alger où le général Massu traquait impitoyablement avec ses paras les combattants du FLN retranchés en grande partie dans la Casbah. Larbi Ben M’hidi, «chef historique», est arrêté, torturé et exécuté et diverses voix en France et ailleurs s'élevaient pour dénoncer l’atmosphère pourrie. On ne parle plus de bavures mais de recours systématique à la torture. La ligne électrifiée Morice est installée le long de la frontière algéro-tunisienne et sera balayée tous les soirs par de puissants projecteurs, visibles depuis Kasserine par-dessus le Chaambi.
Dans ce contexte malsain, le discours de Kennedy ébranla la classe politique française et provoqua une véritable levée de boucliers. Le Président René Coty déclare «qu’ on ne compte pas sur nous pour sacrifier de l’autre côté de la Méditerranée une nouvelle Alsace-Lorraine.»
Le ministre-résident en Algérie, Robert Lacoste, s’en prend au sénateur en ces termes: «Non, l’Algérie ne sera pas indépendante», et son prédécesseur Jacques Soustelle renchérit: «L’initiative du sénateur Kennedy, si elle était suivie, aurait pour conséquence la rupture entre la France et les USA et jamais le peuple français n’acceptera l’intervention ni la médiation de qui que ce soit dans l’affaire algérienne.»
La première réaction algérienne viendra du Caire d’où Saâd Dahlab, membre du Comité exécutif du FLN, affirmera que la récente déclaration de Foster Dulles constituait « un appui direct au colonialisme français et que la politique américaine ne changerait rien à la détermination des Algériens à combattre jusqu’à la mort pour leur indépendance », ajoutant que la France utilisait contre les Algériens des armes fournies par les USA qui se comportaient ainsi comme une nation inamicale.
Ferhat Abbas écrira dans ses mémoires (Autopsie d’une guerre) à propos du discours de Kennedy : «L’Algérie, tel un navire poussé par le reflux, quittait les rivages de la France et pénétrait ostensiblement dans les eaux internationales.» De même qu’il rend hommage à Bourguiba, «devenu l’un des meilleurs soutiens de l’insurrection algérienne», et à «son ami tunisien Ahmed Ben Salah qui patronnera l’adhésion de l’Ugta à la Cisl». A l’indépendance, la ville d’Alger aura sa place John-Kennedy, à el Biar sur les hauteurs de la ville, ce qui n’est pas peu comme signe de reconnaissance, quand on sait que seul Che Guevara parmi les étrangers a eu droit à cet honneur. Il y aura également une avenue Mohamed-V. En revanche, aucune artère de la capitale algérienne ne portera le nom de Bourguiba malgré son engagement total au côté de l’Algérie combattante.
Cette réaction de Bourguiba, président du Conseil tunisien, le 4 Juillet 1957, au rapport de Kennedy et aux déclarations des officiels américains l’atteste amplement : «La question algérienne demeure entre la France et nous l’obstacle majeur, qui compromet toute chance de normaliser nos rapports. M. Kennedy a certes critiqué la politique française en Algérie, mais et c’est là l’essentiel, il l’a fait en tant qu’ami de la France. Il s’est attaché à montrer que cette guerre n’ajoutait rien au prestige de la France ni à sa dignité. Au contraire, l’épreuve algérienne l’affaiblit sur tous les plans, amoindrit son potentiel économique, porte atteinte à son poids moral et à son rayonnement en Europe, en Afrique et dans le monde». Sûr de l’issue de la guerre, il affirme que «quelle que soit la volonté des responsables français, quels que soient l’effectif et l’armement dont disposent les troupes françaises en Algérie, il est impossible de venir à bout de l’insurrection algérienne».
Exprimant une note d’espoir, il estime que «l’attitude du sénateur Kennedy permet d’espérer que la solution algérienne est proche et que l’on pourra bientôt convaincre les responsables français que la guerre les a menés à l’impasse. Une impasse dont on ne peut sortir par des méthodes de guerre, pour violentes et inhumaines qu’elles soient». Et Bourguiba se paye le luxe de critiquer le secrétaire d’Etat Foster Dulles, trouvant son attitude «surprenante» d’évoquer la libération des cinq pays déjà cités comme signe révélateur de la politique émancipatrice de la France. Il trouve que Dulles oublie de préciser que les partisans de la poursuite de la guerre d’Algérie considèrent l’émancipation de ces pays comme une catastrophe nationale et Bourguiba estime que ceci révèle un grand désordre de pensée. Il conclut par : «L’Amérique ne peut pas sacrifier tous ses intérêts dans le monde à la politique coloniale de la France et que l’expérience vécue a amplement démontré que la France ne pouvait seule résoudre le problème algérien».
Nous assisterons alors à une réaction assez rocambolesque des autorités françaises avec l’arrestation d’Abdelmajid Chaker, directeur du Néo-destour et avocat de Ben Bella, à Orly, le 11 juillet 1957, qui s’est vu inculpé après fouille et interrogatoire, malgré les protestations véhémentes de l’ambassadeur Mohamed Masmoudi, d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat. Chaker avait admis être porteur d’un message des chefs du FLN aux détenus de Fresnes leur demandant leurs points de vue sur d’éventuelles négociations avec la France et son permis de rencontrer son client Ben Bella a été annulé par décision du juge d’instruction militaire. Masmoudi a comparé cet incident au rapt de l’avion de Ben Bella et ses camarades. A Tunis, Bourguiba exprima sa désapprobation et indiqua que les éléments colonialistes ont cru tenir des preuves accablantes et a estimé que cette affaire avait un caractère discourtois et que les documents auraient dû être restitués avec des excuses. Et on passa l’éponge sur ce burlesque épisode.
En fait, bien avant l’intervention de Kennedy au Sénat, Bourguiba ne cessait de soulever la question algérienne. Il s’est ainsi livré le 2 novembre 1956 à l’exposition d’un diagnostic pathologique assez humiliant des motifs des autorités françaises, en accusant la France et l’Angleterre, dans leur attaque de l’Egypte, de vouloir atteindre la révolution algérienne, la Tunisie et le Maroc pour «ranimer le courage du peuple français ébranlé par une série ininterrompue de défaites depuis 1940 et au lieu de se tourner sur elle-même et de panser ses blessures, la France s’est empêtrée dans des guerres sans fin, toujours dans l’illusion de reconquérir par les armes un prestigen perdu. Chaque fois, elle se trouve acculée à une impasse et s’engage pour en sortir dans une autre». Il rappelle les expériences de Syrie, de Madagascar et d’Indochine. «Après deux ans de guerre sans issue en Algérie, la France se tourne vers Nasser et l’Egypte», précise-t-il.
A la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU où la Tunisie venait d’être admise comme membre, Bourguiba soulèvera longuement dans son discours, le 22 novembre 1956, les différents aspects de la question algérienne. Tirant habilement profit de la répression de la Hongrie par les forces soviétiques pour dresser un parallèle entre agresseurs et agressés, il prend à témoin la délégation d’Irlande pour rappeler «le combat héroïque que la nation irlandaise a mené durant des siècles contre la domination anglaise » pour estimer que les Algériens ne peuvent rester en deçà de l’indépendance et propose un plan en trois étapes pour y parvenir : cessez-le-feu, création d’une commission de conciliation ou de bons offices et négociation d’une paix durable dans le cadre d’une coopération entre les deux peuples.
Le sénateur Kennedy a répondu à l’ensemble de ses détracteurs en intervenant de nouveau fin juillet au Sénat pour déclarer que l’Algérie est une « terrible bombe à retardement, son tic-tac pouvant se faire entendre sans arrêt jusqu’au jour où un autre désastre, pire que celui de l’Indochine, éclate dans le monde libre ». Aussi demande-t-il à la France de se hâter de résoudre la question algérienne.
Le discours a certainement favorisé l’évolution du problème algérien, par son internationalisation, vers plus de compréhension et de solidarité, d’où l’adoption à l’ONU, le 10 décembre 1957, d’une résolution favorable au FLN. On constate que la résolution présentée au Sénat, même si elle n’aboutit pas pour cause de procédures, réussira à ouvrir un large débat international qui tournera vite en faveur de son auteur. Le général Eisenhower entamait son second mandat et les candidats potentiels à sa succession en 1960, dont à l’évidence Kennedy, se devaient de se décider et envoyer assez tôt les signaux de leurs intentions. Le monde vivait à l’heure de la guerre d’Algérie, qui représentait un sujet fort tentant et le sénateur démocrate ne pouvait résister à s’en saisir, ce qu’il fit avec panache et réussite.
Elu le 9 novembre 1960 président des Etats-Unis, il s’est distingué à son investiture, le 22 janvier 1961, par son discours où il lança son célèbre appel : «Ne vous demandez pas ce que votre pays doit faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays».
Salem Mansouri
Chercheur en sciences sociales,
ancien gouverneur 1982-1987
- Ecrire un commentaire
- Commenter