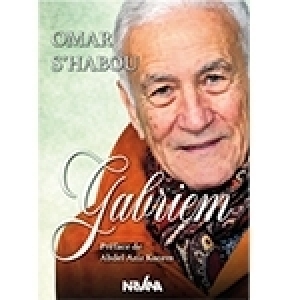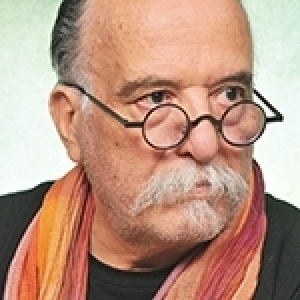Muhammad-Ali, réformateur de l’Egypte et son fils Ibrahim Pacha, vainqueur des Saoud et des Turcs

Par Mohamed-El Aziz Ben Achour - 1805. Alors que le vieil Empire ottoman pâtit d’une torpeur qui ternit sa gloire et met en péril sa puissance jadis redoutée, un jeune et brillant officier du nom de Muhammad-Ali (ou Méhémet Ali), né en Macédoine ottomane dans une famille d’origine albanaise, est nommé gouverneur de l’Egypte, la province la plus importante et la plus illustre, conquise en 1517 par le Sultan Sélim 1er. Rapidement, Muhammad-Ali donna les preuves non seulement de ses qualités de chef mais aussi de sa volonté – une première dans le monde musulman d’alors – de moderniser le pays. La décision politique la plus importante qu’il prit fut de se débarrasser de manière radicale des mamelouks, lointains héritiers de l’aristocratie militaire qui avaient dirigé avec brio l’Egypte du XIIIe au XVIe siècle. Bien que réduits au rang de vassaux du Sultan, leur statut sociopolitique avait été maintenu par les Ottomans mais leurs privilèges constituaient une menace politique et un obstacle évident à tout changement. Le 1er mars 1811, Muhammad- Ali, les attirant dans un piège, les fit jeter du haut de la citadelle, confisqua leurs opulents domaines fonciers et, désormais seul maître du pays après son suzerain le Sultan de Constantinople, s’attela à la tâche du redressement d’une province livrée à elle-même après le départ de l’armée de Bonaparte en 1801.
our la première fois, un prince musulman, conscient du retard accumulé et déterminé à sortir le pays de sa léthargie, mit en œuvre un ambitieux programme de modernisation. Certes, le gouvernement impérial avait lui aussi pris conscience de la nécessité peut-être pas d’un aggiornamento mais de moderniser certains secteurs. Mais Muhammad-Ali Pacha fut le premier à réaliser que les réformes n’avaient de réelles chances de durer que si elles s’appuyaient sur une économie dynamique et prospère. Bien entendu, il avait déjà en tête le projet de s’émanciper de la suzeraineté du sultan-calife. Les beys de Tunis, arrivés au pouvoir un siècle plus tôt, avaient déjà réussi à obtenir une ample autonomie de fait ; mais pour le nouvel homme fort de l’Egypte, province si importante économiquement et stratégiquement pour Constantinople et géographiquement plus proche, c’était une autre affaire. Pour arriver à ses fins, il lui fallait créer une armée moderne et lui consacrer des ressources considérables que l’économie traditionnelle ne pouvait guère procurer. Entre 1811 et 1815, la confiscation des terres de l’aristocratie mamelouke et une réforme fiscale assurèrent d’importants revenus auxquels vinrent s’ajouter les recettes tirées de la création par le Pacha des monopoles publics et l’étatisation des circuits commerciaux. Cette prospérité financière permit la modernisation de l’économie. L’historien Jean Batou, dans une étude sur «Pouvoir politique et Développement économique en Egypte de 1805 à1848», paru en 1991 dans la revue Annales ESC, nous apprend – fait inouï dans le monde musulman - que «dans la première moitié du XIXe siècle, l’Egypte conn[ut] un processus d’industrialisation qui présent[ait] des analogies avec celui de certaines régions d’Europe occidentale à la même époque.» Le pacha développa avec une telle énergie la culture et la filature du coton que son pays occupa – ajoute le même auteur – la cinquième place mondiale en termes de broches par habitant. L’industrialisation était diversifiée, comprenant des usines de textiles, des manufactures de draps, des usines d’armement (canons, fusils et armes blanches) et même une sidérurgie. L’historienne Ghislaine Alleaume estime la main-d’œuvre employée dans ces établissements à un nombre variant de 40 000 à 70 000 hommes. La construction navale, elle aussi, connut un grand essor et les arsenaux d’Alexandrie employaient en permanence des milliers d’ouvriers qui construisaient toute une gamme de vaisseaux dont certains étaient équipés de cent canons. Pour assurer la bonne marche et la pérennité de cette industrialisation à marche forcée, Muhammad-Ali créa des écoles techniques et d’ingénieurs et recruta des spécialistes européens (dont des saint-simoniens comme Prosper Enfantin ou Linant de Bellefonds mais aussi des Anglais spécialisés dans l’industrie manufacturière ou encore des Génois et des Maltais. «A la fabrique des tarbouches de Fuwwa- Rosette, l’encadrement, nous apprend Gh. Alleaume, était assuré par des Tunisiens» qui, comme nous le savons, sont depuis toujours les meilleurs artisans au monde des fameux «bonnets façon de Tunis», les chéchias.

Quant à l’armée, elle eut pour épine dorsale une infanterie dont les contingents étaient fournis par la paysannerie mais disposait aussi d’une puissante artillerie, sans compter la cavalerie. Pour atteindre une efficacité comparable à ce qui se faisait de mieux à l’époque, le pacha fit appel à des instructeurs et conseillers européens, français surtout. Le plus célèbre fut Joseph Sève né à Lyon en 1788. Après avoir bourlingué et acquis une expérience dans le renseignement, cet officier d’état-major polyglotte entra en 1819 au service du Pacha. L’année suivante, il est nommé instructeur en chef de l’armée. Ayant fait preuve de bravoure et contribué à des victoires militaires, il fut élevé au rang de général en 1833. Converti à l’islam, il ne tarda pas à devenir un aristocrate égyptien à part entière sous le nom de Soliman Pacha. D’autres conseillers militaires étrangers repartaient dans leur pays tel le futur général Charles Napoléon de Beaufort d’Hautpoul. Pour former les officiers égyptiens, une école polytechnique fut créée en même temps que des étudiants étaient envoyés en France pour parfaire leurs connaissances scientifiques, techniques et militaires. Bientôt, l’armée égyptienne (armée de terre et marine) compta 100 000 hommes disciplinés, et vêtus et équipés à l’européenne.
.jpg)
Dans un premier temps, à Constantinople, le gouvernement impérial, de plus en plus soumis à la pression interventionniste des puissances européennes, avait apprécié les efforts de relèvement de l’Egypte, car elle ne manquerait pas, en cas de danger extérieur ou de rébellion interne, de mettre sa nouvelle vigueur au service du Croissant ottoman. De fait, outre les manœuvres britanniques, françaises et russes qui lentement mais sûrement sapaient ses assises, l’Empire ottoman voyait sa souveraineté menacée de l’intérieur. Ainsi, vers 1740, apparut du fond du plateau du Nejd, à l’est de la péninsule arabique, le wahhabisme, une secte islamique fondamentaliste extrémiste fondée par le cheikh Mohammad bin Abdelwahhab, qui trouva un appui politique et militaire auprès du clan des Saoud , maîtres de l’oasis de Dariya. Ces sectateurs wahhabites, se réclamant d’un hanbalisme intransigeant, firent du «djihad» pour le retour à la «pureté» de l’islam des origines leur raison d’être. Comme au Moyen Âge musulman, ils répandirent leurs propagandistes dans tout l’Empire en s’en prenant au soufisme et au «culte» des saints, au chiisme bien entendu, et même au sunnisme tempéré pratiqué par les oulémas et le peuple, auxquels ils reprochaient leur «laxisme» et leur tolérance. Ces djihadistes poussèrent l’audace jusqu’à attaquer et piller en 1802 Karbala, ville sainte chiite de l’Irak sous domination ottomane, et massacrer ses habitants. En Arabie, les Saoud wahhabites, bousculant les garnisons ottomanes, réussirent à étendre leur domination au Hedjaz et s’emparèrent de La Mecque et Médine. Pour Mahmoud II, alors Sultan-calife, cela ne pouvait être toléré. Sur ses ordres, le gouvernement ottoman décida de sévir et confia à Muhammad-Ali Pacha la tâche de réduire la sédition. La nouvelle armée égyptienne sous le commandement du fils cadet du Pacha, Ahmed Toussoun (1796 -1816), débarqua à Younbôo, le port de Médine, en 1813. En 1816 cependant, Toussoun mourut et le Pacha fit appel à son fils aîné Ibrahim, alors âgé de 27 ans. Ce dernier, jusque-là gouverneur de Haute-Egypte, avait donné dès son jeune âge des preuves de sa bravoure et de son aptitude au commandement et à la conduite de la guerre. Nommé généralissime en remplacement de son frère, officier énergique et politique habile, il rallia à la cause ottomane des tribus bédouines en supprimant les taxes qui leur avaient été imposées par les insurgés et réussit à repousser les combattants, pourtant coriaces, de l’émirat saoudite. Décidé à en finir avec cette sécession qui portait gravement atteinte au prestige du Calife commandeur des croyants, il pourchassa les rebelles jusque dans leur fief de Dariya. Preuve de leur efficacité augmentée par le charisme, le courage et l’endurance de leur jeune général, les soldats égyptiens traversèrent en bon ordre le désert d’Arabie d’ouest en est, sur quelque 600 km, et mirent le siège devant l’oasis d’avril à septembre 1818, date à laquelle elle fit sa reddition. Ses défenseurs furent massacrés, ses habitants dispersés à travers l’empire et ses habitations rasées. Des chefs furent emmenés en captivité et l’émir Abdallah Bin Saoud fut capturé et envoyé à Istanbul où il fut exécuté. Ainsi s’effondra l’émirat de Dariya, considéré par les historiens comme le premier Etat saoudite (le second connu sous le nom d’émirat du Nejd, installé à Riyad, allait durer de 1824 à 1891; le troisième étant l’actuel Royaume d’Arabie saoudite). De retour au pays après huit ans d’absence, le corps expéditionnaire égyptien fut reçu triomphalement au Caire le 11 décembre 1819.
Presque au même moment, dans les provinces européennes, un autre péril menaçait l’intégrité territoriale de l’Empire ottoman. En 1821, les Grecs, encouragés par certaines puissances et par des «philhellènes » exaltés dont le plus célèbre fut Lord Byron, se soulevèrent. Le Sultan fit encore une fois appel à Muhammad- Ali qui confia, à son tour, le commandement du corps expéditionnaire à l’énergique Ibrahim Pacha. En 1825, le généralissime, à la tête d’une armée de 25 000 hommes, ne tarda pas à reconquérir le Péloponnèse.

En 1826, c’est au tour de Missolonghi de tomber, puis Athènes, l’année suivante. Face à cette contre-offensive victorieuse, les Etats européens décidèrent d’intervenir en faveur de la Grèce, «avant-garde chrétienne en Orient» mais surtout en raison de sa position stratégique. En octobre 1827, dans la baie de Navarin, au sud-ouest du Péloponnèse, une coalition des flottes française, anglaise et russe engagea le combat contre la marine turque appuyée par les Egyptiens et les Tunisiens. La bataille fut acharnée et il fallut la destruction des navires, la mort et la mise hors de combat de la plupart des équipages musulmans engagés (6 000 morts et 4 000 blessés selon les estimations des historiens) pour vaincre la détermination ottomane. Ce grave revers annonçait une ère de repli de l’Empire ottoman désormais sur la défensive face à un interventionnisme européen croissant. En 1832, la Grèce, ottomane depuis le XVe siècle, devenait un royaume indépendant.

Au Caire, Muhammad-Ali et son fils Ibrahim pensaient cependant que les sacrifices consentis n’étaient pas récompensés comme ils le souhaitaient de la part du Padichah, leur suzerain. En outre, les dépenses militaires consécutives aux expéditions d’Arabie et de Grèce constituaient un sujet de d’inquiétude pour les argentiers égyptiens. II fallut penser à agrandir le territoire à la recherche de nouvelles ressources et de nouveaux marchés. La Syrie, ayant été historiquement toujours liée à l’Egypte, le Pacha songea presque naturellement à une annexion de cette belle province qu’on appelait alors le Châm et qui comprenait la Syrie et le Liban actuels ainsi que la Palestine.
Pénétrant en Syrie en 1832, les troupes égyptiennes, commandées par Ibrahim Pacha, prirent d’assaut Akka (Acre ou Saint-Jean-d’Acre) le 27 mai puis occupèrent Damas. Le 8 juillet, l’armée du Sultan fut vaincue devant Homs. Le vaillant général entra même en Asie mineure. Le 21 décembre, à Konya, ses hommes remportèrent une autre victoire contre l’armée ottomane commandée par le grand vizir Réchid Mehmet Pacha en personne. Le traité de paix de Kütahya, signé le 4 mai 1833, entérinait la cession de la Syrie et d’Adana (en Anatolie) au pacha d’Egypte. A l’exemple de son père pour l’Egypte, Ibrahim, nommé gouverneur général civil et militaire du Châm, mit en œuvre un programme de modernisation de cette province où les archaïsmes étaient nombreux. Cependant, en 1839, le gouvernement impérial ottoman jugea qu’il était temps de récupérer la Syrie et engagea les hostilités dans ce qu’il est convenu d’appeler la deuxième guerre égypto-ottomane. Mais le 24 juin, à la bataille de Nizip (ou Nezib, en Anatolie du sud), Ibrahim Pacha est encore une fois vainqueur, malgré la présence aux côtés des troupes sultaniennes du futur maréchal prussien Helmuth Karl Bernhard Von Moltke, en qualité de conseiller spécialiste de l’artillerie. Mieux encore - et fait extraordinaire dans la longue et glorieuse histoire de l’Empire - la route de Constantinople s’offrait à l’armée égyptienne. Mais comme l’Orient était désormais sous haute surveillance étrangère, les puissances européennes qui –pour défendre leurs intérêts et concrétiser leurs visées expansionnistes–voulaient éviter qu’à un probable effondrement ottoman succède une Egypte régénérée intervinrent. Une expédition maritime européenne fut montée.Le bombardement de Sayda, Akka et Beyrouth ainsi qu’un blocus d’Alexandrie obligèrent les Egyptiens à évacuer la Syrie en février 1841. Les négociations menées par l’amiral anglais Charles Napier aboutirent toutefois à une reconnaissance de la souveraineté de Muhammad-Ali sur l’Egypte. Mais à quel prix ! Selon un scénario impérialiste qui allait devenir classique, Muhammad-Ali Pacha, outre l’évacuation de la Syrie, fut obligé de réduire sa flotte de guerre et de limiter le nombre de ses soldats à seulement 18 000 hommes. Quant au Sultan, il accepta, en contrepartie de la récupération du Châm, que les descendants du grand pacha se succèdent sur le trône d’Egypte (notons, à ce propos, que le titre de Khidîwî- khédive - équivalent à celui de vice-roi, n’a été officiellement donné au Pacha d’Egypte qu’en 1867 sous le règne d’Ismaïl Pacha fils d’Ibrahim).
.jpg)
La frustration ressentie au plan militaire et politique s’accompagna de difficultés économiques croissantes. La concurrence des produits manufacturés européens, anglais surtout, devint d’autant plus féroce qu’un accord commercial funeste dit de Balta-Liman, conclu en 1838 entre la Grande-Bretagne et la Turquie, interdisait toute forme de monopoles et imposait une totale liberté du commerce dans tout l’empire. Dès 1850, les manufactures créées à grands efforts et sacrifices par Muhammad-Ali et son peuple étaient désormais frappées de plein fouet par la redoutable concurrence des produits étrangers et fermaient les unes après les autres. L’Egypte, à son tour, entrait dans la tourmente annonciatrice de l’agressivité politique, militaire et économique des puissances européennes puis de l’occupation coloniale. La renaissance à caractère national (qui, certes, pâtissait de certains travers comme le caractère oriental du despotisme des pachas et l’absence d’une structuration sociale susceptible d’acclimater durablement le progrès) fut cependant empêchée, surtout par la volonté agissante des puissances impérialistes. Ici, comme dans tout le monde arabe et musulman, l’entrée dans l’ère moderne allait avoir le goût amer de la défaite et de l’humiliation.

Le généralissime Ibrahim Pacha, pour sa part, n’eut plus l’occasion d’exercer ses formidables talents militaires et n’assuma plus que ses hautes fonctions de prince héritier. Il se rendit en Europe en 1846 en visite officielle et fut reçu avec les honneurs dus à son rang et à sa réputation de grand soldat. En mars 1848, Muhammad-Ali, miné par la maladie, confia le gouvernement de l’Egypte et du Soudan (occupé depuis 1820-24) à Ibrahim. Malheureusement, il mourut en novembre de la même année, précédant son père dans la tombe de quelques mois. Mais, hormis son neveu Abbas Hilmi 1er et son frère Saïd Pacha, tous les monarques égyptiens, du khédive Ismaïl jusqu’à l’abolition de la monarchie en juin 1953, furent ses descendants directs.
Mohamed-El Aziz Ben Achour
- Ecrire un commentaire
- Commenter