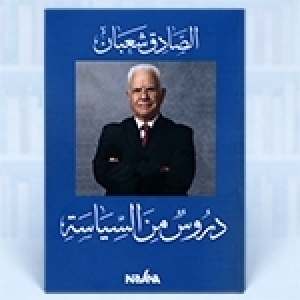Un effet de l’impérialisme: Endettement et paupérisation à Tunis
 Tunis Bab el Bahr en 1920. A la lisière de deux villes,de deux économies et de deux cultures. ( photo Victor Sebag)
Tunis Bab el Bahr en 1920. A la lisière de deux villes,de deux économies et de deux cultures. ( photo Victor Sebag)
.jpg) Par Mohamed-El Aziz Ben Achour - En 1912, un observateur français, dénonçant les ravages causés par l’usure, écrivait «avant cinquante ans si l’on n’y met ordre, il n’y aura plus que des prolétaires chez les musulmans.» Ce cri d’alarme reflétait l’ampleur d’un phénomène apparu dès le XIXe siècle pour se prolonger sous le protectorat, établi en 1881. Il rappelait que si la domination étrangère a été politique et militaire, elle fut cependant précédée puis accompagnée d’une agression économique qui porta un coup fatal aux équilibres traditionnels et entraîna la paupérisation et, souvent, la ruine des producteurs et des marchands tunisiens.
Par Mohamed-El Aziz Ben Achour - En 1912, un observateur français, dénonçant les ravages causés par l’usure, écrivait «avant cinquante ans si l’on n’y met ordre, il n’y aura plus que des prolétaires chez les musulmans.» Ce cri d’alarme reflétait l’ampleur d’un phénomène apparu dès le XIXe siècle pour se prolonger sous le protectorat, établi en 1881. Il rappelait que si la domination étrangère a été politique et militaire, elle fut cependant précédée puis accompagnée d’une agression économique qui porta un coup fatal aux équilibres traditionnels et entraîna la paupérisation et, souvent, la ruine des producteurs et des marchands tunisiens.
Dans les campagnes, déjà fortement éprouvées dans les années 1870 par les effets de la révolte de 1864, de la répression, des confiscations arbitraires faites par un pouvoir beylical aux abois, de l’exode et de la famine, la situation des petits cultivateurs et des métayers (khammès) endettés à vie suscita l’émoi de nombreuses personnalités tunisiennes et françaises. Le résident général de France, Stephen Pichon (1901-1906), signalait que «le prêt à 40% [était] fréquent et nombreux étaient les cas où il était supérieur à 80 et 100%. » Au congrès de l’Afrique du nord, organisé à Paris en 1908, un conférencier, dans son discours sur la situation des campagnes, déclarait : « Des milliers de petits propriétaires ne parviennent à cultiver que grâce au concours d’usuriers qui sont leurs seuls bailleurs de fonds. On peut dire qu’ils travaillent pour ces usuriers.» Si la détresse des campagnes était d’une grande ampleur, les milieux citadins n’étaient pas épargnés. Et leur endettement, voire leur effondrement, était - davantage que dans le monde rural depuis toujours menacé de dépossession - en rapport avec le nouvel ordre imposé par l’expansion européenne. En effet, ici comme partout où l’impérialisme envisageait d’intervenir directement, la dislocation(et même la destruction) des groupes sociaux à vocation économique ou détenteurs du pouvoir de l’argent constitua un élément fondamental dans le processus de la mainmise étrangère sur le pays.Voyons l’exemple de Tunis et de sa société.

Voyageurs et historiens des premiers temps coloniaux avaient constaté ce que certains d’entre eux qualifièrent de «débâcle arabe» sans trop s’attarder sur les causes de l’effondrement des milieux économiques tunisiens. On préféra mettre cela sur le compte de l’imprévoyance et des interdits du Coran, ce qui aurait conduit à l’usure clandestine et ses méfaits. En réalité, le phénomène s’inscrivait dans un contexte international et, notamment, l’évolution du monde méditerranéen sous l’impulsion du commerce européen appuyé par une diplomatie agressive vis-à-vis des Etats dont on convoitait la conquête. Certes, le négoce européen, jouissant des privilèges accordés au XVIe siècle par le pouvoir ottoman (les «Capitulations »), était depuis longtemps présent et actif à Tunis. Elément indispensable des affaires, il n’avait cependant pas un caractère dominateur et donc ne représentait pas pour l’économie locale et ses protagonistes un péril; ou, plus exactement, on n’imaginait pas les risques futurs d’une telle présence dynamique. Des signes inquiétants étaient pourtant d’ores et déjà décelables, en particulier le monopole exercé par les marchands européens sur le courant d’échanges reliant la Tunisie à l’Europe méditerranéenne, l’absence d’une marine marchande tunisienne régulière dans le Bassin occidental de la Méditerranée et la présence agissante des consuls défendant bec et ongles les intérêts de leurs administrés. A partir de 1815, la paix revenue en Europe rendit possible l’essor d’une politique plus cohérente et plus agressive à l’encontre des « régences barbaresques » désormais définitivement privées de l’arme redoutable que constituait l’activité corsaire. Par le recours à la fameuse « politique de la canonnière », les puissances occidentales en imposaient désormais à l’Empire ottoman et à ses vassaux et, dans la foulée, cette politique agressive profitait amplement à l’expansion commerciale européenne. Cette étape précédait et préparait dans les chancelleries l’intervention directe. Sur cette expansion du négoce européen des études d’historiens dont celles de Pierre Pennec, de Md.H. Chérif et de Lucette Valensi, ont mis en lumière le rôle dans le déséquilibre de l’économie locale et la destruction de certains de ses secteurs d’activité. Entré dans un rapport d’infériorité manifeste, le Maghreb connut une rupture d’équilibre en faveur d’une Europe au dynamisme économique adossé à une puissance militaire considérable. En 1830, la prise d’Alger aggrava la tutelle de fait exercée sur des Etats désemparés et, en ce qui nous concerne, plaça la Tunisie dans une situation de quasi-dépendance vis-à-vis de la France. Une conjoncture internationale défavorable survenue après la longue prospérité du XVIIIe siècle aggrava les effets de l’ouverture commerciale sur l’économie tunisienne. Les prix du marché se mirent à baisser, notamment ceux de l’huile d’olive, principal produit d’exportation. « L’âge d’or » (ou plutôt le chant du cygne), qui fut celui du règne de Hammouda Pacha (1782-1814), prit fin et avec lui la puissance économique et financière des élites du pouvoir et leurs associés marchands et navigateurs tunisiens. En effet, outre le milieu des dignitaires de la cour beylicale, les « tujjâr-s », producteurs-marchands citadins n’éprouvaient alors aucune difficulté à écouler sur les marchés traditionnels de l’intérieur, du Maghreb et du Levant, les produits finis, notamment les bonnets de feutre (chéchias) et les soieries qui faisaient la réputation de Tunis dans tout le Bassin méditerranéen. Autour des années 1815-20, les choses se mirent à changer rapidement. Premier effet de l’offensive commerciale européenne, les importations des produits manufacturés s’accrurent dangereusement. Elles doublent entre 1816 et 1829, puis doublent encore dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le péril est d’autant plus grave que ces produits fabriqués à grande échelle et qui inondent le marché concurrencent directement la production locale. Vendus à des prix défiant toute concurrence par la vertu de la révolution industrielle, ils frappent de plein fouet les secteurs les plus actifs de l’économie des souks. Comme, en outre, la concurrence étrangère s’étendait à l’ensemble des marchés naguère ouverts aux marchands tunisiens, les exportations de Tunis en furent sévèrement affectées, aggravant de ce fait la dépression de l’économie locale. Difficultés et faillites frappaient désormais producteurs et marchands. En ces temps difficiles, les ateliers des souks de Tunis fermaient quasiment les uns après les autres et les prétoires tunisiens étaient submergés d’affaires de dettes de tujjâr-s à l’égard de négociants européens.

Il faut dire qu’à la différence des pouvoirs orientaux, les Etats européens ont toujours encouragé l’activité maritime et marchande de leurs sujets. Dans les Etats vassaux du Sultan comme les régences de Tunis, d’Alger, de Tripoli ou l’Egypte, les consuls étaient chargés de veiller à la protection des ressortissants de leurs nations respectives et notamment l’application des clauses prévues par les capitulations. Au XIXe siècle, au fur et à mesure que s’accentuait le déséquilibre des forces au bénéfice des puissances européennes et que progressait rapidement l’offensive commerciale, augmentait en même temps l’influence des consuls sur le gouvernement beylical, placé dans une position d’autant plus faible que la présence régulière des bâtiments de guerre occidentaux dans la rade de La Goulette constituait un solennel et redoutable appui aux pressions consulaires. A partir de 1830, le Consul de France, qui exerçait depuis toujours une sorte de prééminence sur ses homologues (anglais et italien principalement), acquit une autorité incontestable sur la cour du Bardo. Dorénavant, le fondement de l’action diplomatique des consuls consistait à élever le moindre contentieux opposant un marchand tunisien à un négociant européen au rang d’une grave affaire mettant en cause l’intérêt supérieur et l’honneur de la nation à laquelle appartenait l’Européen concerné et engageait de ce fait la «responsabilité» de l’Etat beylical. Par ailleurs, dans les années 1860, et dans les premières années du protectorat, une conjoncture intérieure particulièrement mauvaise (en particulier à cause d’une série de mauvaises récoltes en 1887, 1888 et 1889, d’épidémies en 1849,1856, 1867, 1868 et 1874 et leur cortège de famine et de dénuement) n’arrangea guère les choses en privant la production et le commerce tunisois de l’important marché que représentaient la notabilité tribale et les cultivateurs au temps de leur prospérité. Structurellement, il faut le reconnaître, l’activité économique traditionnelle pâtissait d’archaïsmes tenaces et de méthodes qui apparurent soudain comme un handicap de taille face à la concurrence. La culture marchande séculaire ne privilégiait pas la recherche effrénée du profit. Toutes les valeurs qui, à Tunis comme ailleurs dans le monde musulman, fondaient naguère l’activité de production et d’échanges, apparurent soudain anachroniques. Par ailleurs, lorsqu’une crise survenait, l’absence de toute organisation du crédit et la faiblesse relative des capitaux faisaient le jeu de l’usure avec des taux de l’ordre de 20 à 30% l’an.

Autre faiblesse structurelle, la politique des beys en matière de commerce fut un facteur aggravant des effets de la pénétration européenne. Ces derniers, à l’instar de tous les despotes orientaux, n’ont jamais mis en œuvre une politique de protection du commerce local ni un réel et constant encouragement de leurs sujets à l’exportation (même la mesure qui, en 1867, allégeant la taxe à l’export fut imposée au Bey par les créanciers étrangers craignant la ruine totale de leurs débiteurs tunisiens). Tant que les équilibres étaient maintenus, les choses allaient plutôt bien, surtout si l’on réussissait à s’associer au Prince ou à ses ministres ou si on avait la prudence de se tenir à distance des secteurs convoités par les puissants. Lors de l’offensive commerciale européenne, en revanche, les difficultés budgétaires de l’Etat, consécutives à des réformes coûteuses et une « politique » de répression fiscale, de confiscation des fortunes, de vente par anticipation des récoltes (qui, malheureusement, vinrent à manquer, ruinant l’Etat beylical, une grande partie de ses agents économiques et les oléiculteurs du Sahel), tout cela a aggravé dangereusement l’endettement du pouvoir et des particuliers et précipité l’effondrement de l’économie tunisienne. La relation directe entre la paupérisation tunisoise et celle des populations de l’intérieur du royaume n’était un mystère pour personne. L’historien Ahmed Ben Dhiaf relate dans sa chronique El Ithâf qu’Ali Ben Ghedhahem, le chef du soulèvement de 1864, fit remettre à un caravanier du Djérid, en route pour la capitale, sa marchandise confisquée par des insurgés et lui dit : « Les Tunisois sont nos frères et je sais qu’au fond de leur cœur, ils comprennent notre révolte et nous pardonnent car ils savent que notre détresse constitue un grave préjudice à leur négoce et à leur production. » Une politique monétaire désastreuse provoqua, ici comme en Egypte et au Levant, une hémorragie de la bonne monnaie que les négociants étrangers s’empressaient de sortir du pays alors que les sujets du Bey étaient obligés, par la force armée, d’accepter des pièces de mauvais aloi.
Lorsqu’en mai 1881, les Français entrent à Tunis, l’économie et la société locales étaient depuis longtemps fortement éprouvées par les effets de la pénétration commerciale européenne. La défaite était, en quelque sorte, déjà consommée et l’année du protectorat ne constitua pas, à proprement parler, un tournant décisif. Le nouvel ordre imposé par l’occupant allait toutefois accélérer le processus d’assujettissement de l’économie locale au profit des intérêts français. Pierre Pennec écrit : «Les importations massives de produits manufacturés [ont] déjà fait disparaître certaines corporations et menacent les plus importantes d’entre elles. (…) L’établissement du Protectorat aggrave encore le démantèlement de l’économie urbaine traditionnelle car le nouveau régime permet l’implantation à Tunis d’activités nouvelles et l’immigration d’une population nouvelle ; ce qui aboutit à la juxtaposition de deux villes [la médina et la ville moderne], de deux populations et de deux systèmes économiques. Cette juxtaposition assure un contact direct avec le mode de vie européen qui exerce un effet de démonstration sur une partie croissante de la population urbaine dont la consommation se modifie ainsi progressivement.» L’endettement de la population musulmane qui atteignait des proportions alarmantes ne suscita pas chez les autorités du protectorat l’idée de mettre en place un train de mesure susceptibles d’atténuer les effets de l’usure et de protéger les débiteurs des rigueurs de la procédure judiciaire en matière de faillite. Le résultat fut que les premiers temps coloniaux coïncidèrent avec une vague de démantèlement des patrimoines. Les numéros du Journal Officiel tunisien des années 1883 à 1900 que nous avons dépouillés regorgent d’annonces relatives à des ventes sur saisie. On y rencontre des noms de familles de dignitaires politiques, de notables du commerce, des artisans, des cultivateurs, autant dire que tous les milieux avaient été touchés par la crise.
La mise sous tutelle du Bey et de son administration et, surtout, la création à Tunis, en 1883, d’un tribunal civil français composés de magistrats nommés par le Président de la République, la création de charges d’huissiers et l’installation d’avocats-défenseurs (équivalent des avoués) mirent fin à la possibilité d’un recours auprès du Bey. Désormais, les créanciers bénéficièrent du maximum de garanties. Dans ces conditions, les usuriers se livrèrent à des spéculations scandaleuses auxquelles les tribunaux eux-mêmes, par suite de l’absence d’une loi réprimant l’usure « venaient prêter l’appui de leur autorité et la force de leur décision»(Charles Saint-Paul, La lutte contre l’usure en Tunisie, 1914).
La dépossession – ou à tout le moins, le rétrécissement notable des patrimoines– qui affecta l’élément musulman de la société tunisoise fit de nombreuses victimes. Certes, des îlots de prospérité subsistèrent mais, désormais, la société locale ne contrôlait plus aucun circuit économique. La fortune musulmane, quand elle existait, n’était plus qu’une fortune fondée sur la rente foncière et immobilière ou l’exploitation agricole extensive. Désormais, les vrais patrons de l’économie urbaine étaient les grossistes représentant des maisons de la France métropolitaine et les administrateurs des bureaux tunisois des banques parisiennes regroupés au sein de la Chambre française de commerce.
Consécutivement aux bouleversements d’ordre économique, des mouvements profonds affectèrent la société citadine. Pour pallier les difficultés matérielles, les Tunisois, naguère tournés vers les activités de l’artisanat et du commerce, cherchèrent désormais un emploi dans l’administration centrale et régionale. Les familles comprirent qu’il était dorénavant vital de se détourner des filières traditionnelles. Les plus perspicaces orientèrent leurs fils vers l’enseignement moderne dispensé par les établissements de la Direction de l’Instruction publique créée par le Protectorat : le collège Sadiki (fondé en 1875 mais complétement réorganisé par la France), ou, quoique plus rarement, le lycée Carnot. La société musulmane de Tunis vit ainsi la naissance d’un nouveau profil de notable : celui des diplômés de l’enseignement supérieur : licenciés en droit et docteurs en médecine, avocats au barreau.
Comme on s’en doute, l’effondrement de l’économie traditionnelle et l’introduction de nouvelles pratiques n’ont pas fait que des victimes. Ceux qui en ont bénéficié furent, bien sûr, les étrangers, rentiers de la métropole qui tiraient profit de leurs placements hypothécaires, les établissements financiers ou encore des avocats français qui dans cette atmosphère procédurière purent s’enrichir. Mais au sein de la société tunisoise, le bénéficiaire de la mutation des patrimoines fonciers et immobiliers consécutive à la débâcle fut l’élite juive. Généralement plus prudents, plus prévoyants que leurs compatriotes musulmans, spécialisés depuis longtemps dans les activités de courtage, autorisés par leurs usages à faire fructifier leurs capitaux par le prêt à intérêt, les israélites de Tunis surent tirer parti de la crise durant laquelle s’étaient effondrés aussi bien les débiteurs artisans et marchands musulmans que bon nombre de négociants européens qui ne purent recouvrer leurs créances. L’historien Ben Dhiaf rapporte que dans les années 1860, les plus grosses fortunes de Tunis appartenaient à des familles juives. Cette réussite ne prit pas seulement la forme d’un transfert de l’élément musulman à l’élément juif. Elle provoqua surtout une concentration de la richesse dont furent également victimes de nombreux israélites artisans, commerçants ruinés ou petits prêteurs endettés auprès de puissants coreligionnaires. Leur détresse se cachait dans leur vieux et délabré quartier historique de la Hâra déserté par les plus riches. De cette concentration naquit l’élite moderne de la société juive tunisoise, qui fut le véritable bénéficiaire du protectorat. Adoptant aisément le mode de vie européen, cette élite se mua rapidement en bourgeoisie de type occidental se consacrant aux affaires selon des méthodes modernes. Orientant, parallèlement, ses enfants vers l’enseignement secondaire et l’Université, cette élite ne tarda pas à occuper aussi une place de choix dans les professions juridiques, intellectuelles et scientifiques.
Au terme de cet aperçu sur un effet de l’expansion impérialiste et de la domination coloniale, qu’ajouter sinon que pour le Tunis traditionnel, outre la dépossession, l’entrée dans les temps modernes,ici comme dans l’ensemble du monde arabe et islamique, prit la forme d’une révélation qui n’allait plus cesser de hanter les esprits: la dépréciation des valeurs sur lesquelles au cours des siècles s’était bâtie la culture urbaine. Les conceptions économiques, les institutions, l’urbanisme, l’habitat, voire les usages, tout était fatalement mesuré à l’aune étrangère. Imposée brutalement, l’entrée dans la modernité s’accompagna d’un sentiment d’échec et d’humiliation. Aussi, allait-elle prendre, tout au long de la période coloniale, les formes modernes de la protestation, de la revendication politique et syndicale portées par l’espoir d’une émancipation.
Mohamed-El Aziz Ben Achour
- Ecrire un commentaire
- Commenter