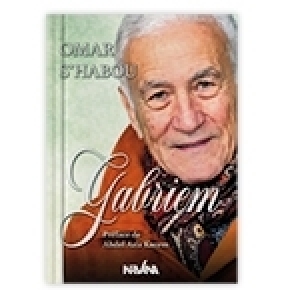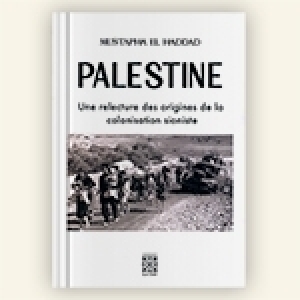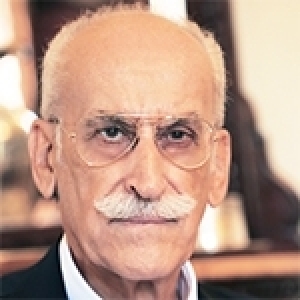L’œuvre éducatrice de Rome

 Par Ammar Mahjoubi - Le titre de cet article est emprunté à celui du chapitre VII, dans l’ouvrage fondamental de Henri Irénée Marrou sur l‘éducation dans l’Antiquité (Histoire de l’éducation dans l‘antiquité) ; chapitre qui débute par la citation bien connue d’Aelius Aristide, «célébrant la grandeur et les bienfaits de la paix romaine». En récapitulant l’œuvre de Rome, les étudiants connaissaient le discours enflammé de ce porte-parole de l’aristocratie ionienne, s’adressant à l’empereur Antonin le Pieux (138-161) : «Le monde entier semble en fête. Il a déposé son ancien vêtement qui était de fer pour se donner en toute liberté à la beauté et à la joie de vivre. Toutes les cités ont renoncé à leurs anciennes rivalités, ou plutôt une émulation les anime toutes : celle de paraître la plus belle et la plus charmante. Partout des gymnases, des fontaines, des propylées, des temples, des ateliers, des écoles.» (A. Aristide, XXVI, 97). Rome ne s’est donc pas limitée, en généralisant la citoyenneté romaine, à rassembler les peuples du monde antique, multiples et dissemblables, dans une même communauté ; à faire, politiquement, «du monde entier, une patrie unique». Elle a, dit Aristide, su aussi faire régner dans toutes les communautés «la valeur suprême, le « télos », la raison de vivre de l’humanité : organiser le monde pour que puissent s’épanouir les valeurs de la civilisation hellénistique, la civilisation du bonheur.» (H.I.Marrou, Hist.de l’éd., p.423).
Par Ammar Mahjoubi - Le titre de cet article est emprunté à celui du chapitre VII, dans l’ouvrage fondamental de Henri Irénée Marrou sur l‘éducation dans l’Antiquité (Histoire de l’éducation dans l‘antiquité) ; chapitre qui débute par la citation bien connue d’Aelius Aristide, «célébrant la grandeur et les bienfaits de la paix romaine». En récapitulant l’œuvre de Rome, les étudiants connaissaient le discours enflammé de ce porte-parole de l’aristocratie ionienne, s’adressant à l’empereur Antonin le Pieux (138-161) : «Le monde entier semble en fête. Il a déposé son ancien vêtement qui était de fer pour se donner en toute liberté à la beauté et à la joie de vivre. Toutes les cités ont renoncé à leurs anciennes rivalités, ou plutôt une émulation les anime toutes : celle de paraître la plus belle et la plus charmante. Partout des gymnases, des fontaines, des propylées, des temples, des ateliers, des écoles.» (A. Aristide, XXVI, 97). Rome ne s’est donc pas limitée, en généralisant la citoyenneté romaine, à rassembler les peuples du monde antique, multiples et dissemblables, dans une même communauté ; à faire, politiquement, «du monde entier, une patrie unique». Elle a, dit Aristide, su aussi faire régner dans toutes les communautés «la valeur suprême, le « télos », la raison de vivre de l’humanité : organiser le monde pour que puissent s’épanouir les valeurs de la civilisation hellénistique, la civilisation du bonheur.» (H.I.Marrou, Hist.de l’éd., p.423).
Enumérant les symboles de la Romanité, Aristide citait des fleurons de son architecture : les propylées, les temples…On joindrait volontiers les thermes, les théâtres et les amphithéâtres, dont les vestiges jonchent encore les innombrables sites archéologiques, du Rhin à l’Euphrate et de l’Ecosse au Maroc. Témoins imperturbables d’un style de vie, qui alliait la commodité au confort et l’agrément aux plaisirs. Plus précieux étaient cependant les autres symboles de la liste: les gymnases, les écoles ; avec leur support linguistique jumelé, fécondant par le grec et sa culture le langage du Latium. Partout, dans toutes les provinces occidentales de l’Empire, une politique aussi décidée que réfléchie avait répandu la romanisation. Prenons le cas de notre pays, sur le sol de la Provincia Africa.
C’est à l’enseignement, aux écoles qu’était due la diffusion du latin. Dans les coins les plus reculés du pays, les sites archéologiques regorgent encore d’inscriptions latines : textes officiels ou honorifiques, offrandes votives, dédicaces…avec, surtout, d’innombrables inscriptions funéraires. Brèves pour la plupart et stéréotypées, elles sont parfois savantes, avec des réminiscences classiques, virgiliennes, rédigées en vers par les lettrés. Ce qui, sans conteste, dénote l’étonnante vitalité d’une extraordinaire instruction populaire. Des enseignants, en grand nombre, répandaient partout la langue de Rome, à commencer par le «litterator», ce qui apprenait aux écoliers des plus petits villages à lire, écrire et compter, sur des tablettes de cire, à l’aide d’un stylet, ou de bois, comme celles de nos kouttabs, avec de l’encre et un roseau taillé. Ces rudiments acquis, l’écolier, en principe sans quitter sa cité, était envoyé chez le «grammaticus» ; même Thagaste (Souk Ahras), la toute petite ville natale d’Augustin avait, en effet, son grammairien qui, avec les leçons sur la structure de la langue et ses règles, lui expliquait les textes des auteurs classiques, principalement ceux de Cicéron et de Virgile. Les inscriptions épigraphiques, sans cesse exhumées de notre sol, sont dans l’ensemble rédigées dans une langue correcte, parfois même prétentieuse et émaillées de réminiscences virgiliennes ; ce qui indique que le niveau de cet enseignement, qui correspond en somme à celui de nos cycles primaire et secondaire, avait atteint un palier des plus valables.
.jpg)
Quant à l’équivalent de notre enseignement supérieur, il était confié aux rhéteurs. Ils inculquaient aux étudiants les techniques compliquées de cette éloquence si prisée, tant par les Grecs que par les Latins. Même si la matière était souvent creuse, c’était une formation pratique, qui devait faciliter les prises de parole au forum, pour briguer les dignités municipales, ou plaider devant le tribunal de la basilique judiciaire pour défendre ses intérêts. L’enseignement de la rhétorique était accompagné par celui de la littérature, par l’étude des textes de Cicéron, toujours, et aussi de Virgile, objet d’une admiration dont témoigne la mosaïque qui orne la salle principale de notre musée. On expliquait aussi les textes de l’historien Salluste, ou du vieux poète Ennius. Les petits poèmes des épitaphes gravées sur les tombeaux avaient sans doute été rédigés par le grammairien ou le rhéteur local, car y abondent les mots étranges, les «archaïsmes nobles» si chers à l’Africain Fronton, natif de Cirta (Constantine) et maître de l’empereur Marc Aurèle, dont les leçons faisaient grands cas de la forme au détriment du fond.
Une phrase de Pline le Jeune, cité par Marrou, signale que « beaucoup de cités entretenaient des écoles publiques ». Plusieurs autres sources prouvent aussi l’existence, dans les cités, d’instituteurs et de grammairiens rémunérés par la caisse municipale, ainsi que de rhéteurs, détenteurs de chaires, qui émargeaient à cette caisse. Le sort commun dévolu aux activités intellectuelles, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, devait rendre leurs rétributions fort peu onéreuses et leur nomination, comme leur révocation, à la merci des notables du conseil municipal. Pour leur recrutement, une loi avait institué une sorte de concours ; en 362, sous le règne de Julien l’Apostat, les candidats devaient présenter un échantillon de leurs compétences au jugement d’un public de notables. Augustin nous apprend ainsi, dans ses Confessions, qu’il avait été informé d’une demande, adressée par le conseil municipal de Milan, où résidaient l’Empereur, à Symmaque, le préfet de Rome, pour le recrutement d’un professeur de rhétorique. Alors professeur privé installé dans la capitale, il se fit présenter au préfet par des amis manichéens influents, lui soumit l’un de ses discours et se fit recruter.
L’emprise de l’Etat, devenue beaucoup plus grande sous le Bas-Empire, ne laissa plus les recrutements à la seule initiative des municipalités. Les gouverneurs des provinces et l’empereur lui-même intervenaient souvent, pour proposer une nomination ou trancher un litige dans le corps professoral. A Constantinople, Constance II désigne en personne au Sénat les noms des professeurs d’éloquence et de philosophie. Le rhéteur Libanios, qu’il avait nommé, ne quittera la Nouvelle Rome pour Antioche qu’avec la permission de l’empereur. Les interventions impériales atteignirent leur aboutissement le 17 février 425, avec la constitution de Théodose II, qui organisa à Constantinople une université qui avait, dans la capitale, le monopole de l’enseignement supérieur, à la seule exception du préceptorat privé. Trois rhéteurs et dix grammairiens y enseignaient les lettres latines. Pour les lettres grecques, dans cette partie orientale du monde romain, de langue et de culture helléniques, le nombre des rhéteurs était porté à cinq, avec le même nombre de grammairiens. Etaient enseignés également la philosophie et le droit. Les professeurs qui avaient donné satisfaction après vingt années de service obtenaient, en vertu d’une décision du 15 mars 425, le titre honorifique de «comes primi ordinis». Cette distinction n’était pas un geste isolé. Depuis la fin du Ier siècle, sous le règne de Domitien, les honneurs consulaires furent conférés au rhéteur Quintilien, qui était, il est vrai, le précepteur de ses neveux et fils adoptifs. Au IIe siècle, le préceptorat impérial permit aussi à Fronton et Hérode Atticus de revêtir le consulat. Par contre, le philosophe Themistios, qui fut nommé par Constance II sénateur, puis archonte-proconsul, ne devait ces distinctions qu’à la seule réputation de son enseignement. C’est seulement plus tard que Valens puis Théodose lui confièrent l’éducation d’un prince impérial. C’est donc surtout au Bas-Empire que les empereurs romains portèrent un intérêt véritable et une sollicitude particulière à l’éducation.
Cette sollicitude n’était pas totalement désintéressée. Un rôle important était, en effet, dévolu aux écoles pour préparer aux différents services de l’Etat un personnel compétent d’administrateurs et d’employés. Depuis Dioclétien, à la fin du IIIe siècle, l’empire était devenu une monarchie bureaucratique, comparable de plus en plus aux vieilles monarchies orientales. En 370, sous Valentinien, le préfet de la ville, à Rome, devait adresser chaque année à l’Empereur la liste des étudiants qui s’étaient distingués, afin de pourvoir aux besoins de l’administration : ceux des tribunaux, des bureaux financiers, des gouvernements provinciaux et des différentes directions dans les ministères (palatii magisteria). Symmaque, le préfet qui avait proposé la candidature d’Augustin, louait dans les études littéraires la voie qui ouvrait l’accès aux magistratures.
A l’exemple de l’institution caractéristique de l’éphébie, cette organisation de jeunesse du monde grec, des clubs de jeunes (collegia iuvenum) se constituèrent dans le monde romain, dès le début du régime impérial et à l’initiative personnelle d’Auguste. Il voulait, vraisemblablement, redonner aux jeunes gens des classes sénatoriale et équestre le goût de la préparation militaire, de ses exercices physiques au champ de Mars et de ses leçons d’équitation abandonnés, semble-t-il, dans les dernières années de la République. Encore enfants, les fils de ces classes nobles participaient déjà au carrousel sacré du ludus Troiae. Plus âgés, ils étaient chaque année passés en revue dans le déploiement cérémonial fastueux de la «pompa», au «Circus Maximus». Vers 11 av. J.-C, Caius et Lucius Césars, les petits-fils d’Auguste, reçurent le titre de «principes iuventutis» (chefs de la jeunesse), qui devient, à partir de l’époque sévérienne, d’un usage régulier pour désigner l’héritier du trône. Ces clubs de jeunes, avec leurs activités sportives comparables à celles des éphèbes grecs, assumaient un rôle actif à l’échelon municipal, comme le montre un texte épigraphique de Pompéi, qui mentionne leur emploi en période électorale. On a noté aussi que les jeunes, dans ces clubs, s’exerçaient aux charges administratives, en élisant les magistrats de leurs associations. En conformité avec la préparation militaire, ils s’adonnaient au culte d’Hercule et disposaient d’un local qu’on a proposé d’identifier, à Pompéi, avec une salle décorée de peintures figurant des armes et des symboles de la Victoire. C’était là, semble-t-il, qu’avait lieu le rassemblement du cortège des «iuvenes», pour le défilé de la Pompa. Dans la province africaine, un texte épigraphique mentionne l’existence d’une formation de jeunes, et on a proposé d’identifier un édifice de la cité de Mactaris avec le local d’une schola des juvenes, mais sans aucune certitude.
Cette sollicitude de l’Etat romain pour l’éducation et la diffusion de la romanisation avait, cependant, des limites. A Rome comme dans l’ensemble du monde antique, l’instruction et la culture étaient des privilèges des classes dirigeantes, à l’échelle des Etats comme à celle des cités. Les écoles municipales accueillaient d’abord les enfants des milieux riches ou aisés, selon l’importance de la cité. C’étaient surtout les enfants des membres de l’ordo decurionum, auquel n’accédait que la tranche supérieure de la société citadine. Les classes populaires et les milieux ruraux étaient écartés et beaucoup d’entre eux étaient restés réfractaires à la romanisation. Dans la provincia Africa, le témoignage d’Augustin, à cet égard, est des plus révélateurs, lorsqu’il avait exhorté les clercs de l’évêché d’Hippone (Annaba) à l’apprentissage de la langue punique, pour pouvoir communiquer avec la population. A cette époque, après des siècles de romanisation et au moment de l’arrivée des Vandales, on parlait encore le punique dans les campagnes africaines.
Ammar Mahjoubi
- Ecrire un commentaire
- Commenter