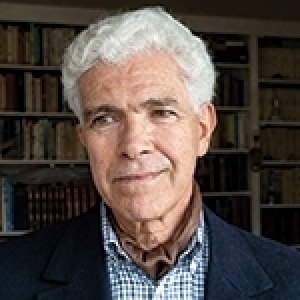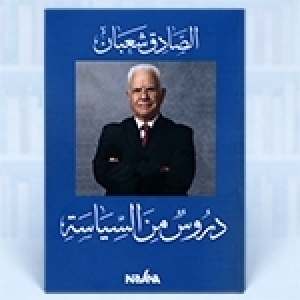Abdelaziz Kacem: Saveur et savoir, même étymologie

(5).jpg) La faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba a organisé, les 9, 10 et 11 décembre dernier, un Congrès international sur le thème «Le Sensible». J’y ai participé. Ci-après ma communication :
La faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba a organisé, les 9, 10 et 11 décembre dernier, un Congrès international sur le thème «Le Sensible». J’y ai participé. Ci-après ma communication :
Au moment où, au téléphone, l’ami Habib Ben Salha me sommait de communiquer, séance tenante, le titre de ma contribution, j’avais sous les yeux un quatrain providentiel:
De notre temps, en dépit des disettes,
Quand savoir et saveur clamaient leur parentèle,
Nous rêvions d’élever nos descendances
En leur léguant de fabuleux carnets d’adresses.
(Quatrains en déshérence)
«Saveur et savoir, même étymologie» et l’une ne va pas sans l’autre. Tout est dit. Ce n’est pas le sujet que j’aurais vraiment aimé développer, en cette circonstance, mais il faut jouer avec les cartes que l’on a tirées. Et, pour ne pas me cantonner aux franges du dire, il m’est venu à l’idée d’en appeler à mon bon vieil ami André Gide. Ses Nourritures s’offrirent de nouveau à ma fringale. J’étais sauvé par tant de saveurs, ce qui me permettait de me livrer à quelques variations sur le thème, mais j’ai fini par me refuser au risque de la paraphrase. Cependant, je fais mienne l’assertion gidienne par excellence : «Je sens, donc je suis» (Les nouvelles nourritures), qui, à l’heure où le cogito est en pleine ménopause, prend une dimension nouvelle. Tous les spécialistes s’accordent à constater que le QI est en train de baisser, partout dans le monde et à tous les niveaux. À elle seule, la brutale stupidité d’un Trump montre bien vers quel crétinisme nous nous acheminons.
.jpg)
À défaut d’investir dans l’intelligence, on mise de plus en plus sur l’intelligence artificielle. Seul, au bénéfice de l’humanisme, le sentir échappera à l’informatique. Adhérons donc à l’autre devise gidienne:
«Il ne me suffit pas de lire que les sables des plages sont doux ; je veux que mes pieds nus le sentent. Toute connaissance que n’a pas précédée une sensation m’est inutile» (Les nourritures terrestres). Cette dernière sentence eut sur moi un tel empire que, aux temps où, féru de littérature comparée, je travaillais sur les troubadours et leurs relations avec la poésie arabo-andalouse, je dus, pour mieux entrer dans mon sujet, sillonner la France méridionale, terre de bardes, de ménestrels, d’amour courtois, mais aussi de sarrasins et de parfaits cathares. Le Moyen âge y était d’or.
.jpg)
J’évoquerai donc avec vous des pérégrinations où je me suis évertué à joindre la saveur au savoir. Je me suis rendu à Moussais-la-Bataille, au lieu appelé par la chronique arabe Balât al-Chouhadâ’ (Chaussée [romaine] des Martyrs), là où l’escarmouche dite de Poitiers est censée avoir eu lieu ; je suis allé, à Poitiers même, sur les pas du comte Guillaume IX, premier troubadour connu et qui savait l’arabe ; j’ai visité la mythique Septimanie mauresque, Narbouna (Narbonne), Qarqachouna (Carcassonne), Noumis (Nîmes), Taloucha (Toulouse), seule ville à avoir résisté aux assauts sarrasins ; j’ai été à Ramatuelle, anciennement Ramatuella, corruption de son nom arabe Rahmatullah (bienfait de Dieu) ; j’ai escaladé le bien nommé Massif des Maures, jusqu’à la citadelle de Farakhchinit dont parlait l’historien andalou Ibn Hayyan (987-1076), autrement dit le Fraxinet, et, en arpentant l’imposant promontoire mauresque, qui domine le beau village de La Garde Freinet, j’eus l’inexprimable sentiment que le fantôme de l’ultime Sarrasin à y avoir monté la garde, attendait toujours la relève.
.jpg)
De 889 à 973, une grande partie de la Provence aura été sous domination arabe pendant plus de quatre-vingts ans. Mais ceci est une autre histoire. Toutefois, pour ceux et celles qui désireraient en savoir plus, outre les ouvrages de Georges Duby, Philippe Sénac, Edouard Brémond, Jacques le Goff, Lévi-Provençal, j’indiquerais Les jardins du Fraxinet (Albin Michel, 1997), captivant roman historique de Nicole Fabre. Elle y brosse un tableau saisissant de ce que fut cette sorte d’émirat au cœur du département du Var et répond à bien des questions que soulève ce point d’histoire.
J’ai senti, j’ai connu, j’ai respiré les lieux où l’Histoire avait eu lieu, mais aussi quelques-uns de mes textes nourriciers. Ainsi, pour mieux appréhender Le Cimetière marin, il m’a fallu mettre le cap sur Sète. Il y ventait, ce jour-là. Une voix infuse scandait en moi : «Le vent se lève, il faut tenter de vivre», et c’est au rythme de cet obsédant décasyllabe que je gravis les hauteurs où Valéry humait «sa future fumée». En bas, la mer, d’assez méchante humeur, avait chassé ses colombes et c’est par translation mentale que j’entrevis, l’espace d’une strophe, ce toit tranquille où picoraient des focs.
Ce jour-là, accroupi au plus près de la tombe du maître du cogito poétique, qui se disait «cloîtré de l’intellect», j’accordai au toucher ses privilèges, laissant mon index, parcourir, pour moi, sur le marbre, les deux vers majestueux gravés en guise d’épitaphe:
Ô récompense après une pensée,
Qu’un long regard sur le calme
des dieux.
Ah, le toucher, le maître-sens, en ces temps covidés, qui nous interdisent (jusques à quand ?) accolades, bisous ou même le simple serrement d’une main amie.
.jpg) À Florence, je devais rendre visite à l’un des hauts lieux de mémoire dont la capitale de la Renaissance abonde: la demeure de l’auteur insigne de la Divine comédie. Pour y accéder, on emprunte une ruelle où se dresse une petite église, dite la Chiesa di Dante, qui ne désemplit guère. J’y entrai et m’agenouillai devant une pierre tombale, celle de l’égérie Béatrice. Je me promis d’y revenir pour, à l’instar des amants, déposer dans la corbeille adjacente une feuille pliée en quatre ou en huit, après y avoir consigné une supplique, un vœu d’amour que la rédemptrice est censée pouvoir exaucer. Ma feuille à moi contiendra un poème intitulé La Corbeille de Béatrice (Quatrains en Déshérence), en souvenir de Nidham/ Harmonie, l’inspiratrice du célèbre mystique Ibn Arabi dont Al-Foutouhat al-Makkiyya (Les Révélations mekkoises) ainsi que Le Livre de l’Échelle de Mahomet ont —Asin Palacios et Enrico Cerulli le montrent— servi de modèle à l’eschatologie du grand poète toscan.
À Florence, je devais rendre visite à l’un des hauts lieux de mémoire dont la capitale de la Renaissance abonde: la demeure de l’auteur insigne de la Divine comédie. Pour y accéder, on emprunte une ruelle où se dresse une petite église, dite la Chiesa di Dante, qui ne désemplit guère. J’y entrai et m’agenouillai devant une pierre tombale, celle de l’égérie Béatrice. Je me promis d’y revenir pour, à l’instar des amants, déposer dans la corbeille adjacente une feuille pliée en quatre ou en huit, après y avoir consigné une supplique, un vœu d’amour que la rédemptrice est censée pouvoir exaucer. Ma feuille à moi contiendra un poème intitulé La Corbeille de Béatrice (Quatrains en Déshérence), en souvenir de Nidham/ Harmonie, l’inspiratrice du célèbre mystique Ibn Arabi dont Al-Foutouhat al-Makkiyya (Les Révélations mekkoises) ainsi que Le Livre de l’Échelle de Mahomet ont —Asin Palacios et Enrico Cerulli le montrent— servi de modèle à l’eschatologie du grand poète toscan.
Une fois de plus, je terminerai la circumambulation aux Ognissanti, pour une méditation aux pieds de Simonetta et de Botticelli ; une fois de plus je quitterai les lieux en titubant, tant l’indicible vous frôle ardent, absolu. Il faut juste fermer les yeux pour voir l’invisible, pour savoir l’inconnaissable. Je n’en dirai pas plus pour ne pas déflorer, «La Sans pareille», objet de la communication dont nous serons gratifiés, tantôt.
En des temps où des termes tels que «sentir» et dérivés tendent à devenir caducs ou ringards, en des temps où le sentiment s’efface devant le ressentiment, où l’indigence du vocabulaire est compensée par la violence physique des malfrats, que d’efforts doit déployer un être normalement constitué pour garder son aptitude à la douleur, à l’émotion, à l’émerveillement, à l’empathie. Ce que le pouvoir politicien cherche à tout prix, c’est de débiliter notre rapport au sensible, empêcher toute réaction affective à la dureté du réel, dureté induite par la médiocrité des gouvernances, d’où les frustrations dévastatrices que l’on sait. La poésie est, à cet égard, la plus subtile des résistances. L’aède, taraudé par la peur d’une possible anosmie, écrira:
Souvent à mon réveil
Craignant la guérison fatale
Je me tâte et m’ausculte
De peur que l’antalgie n’anesthésie nos sens.
(L’hiver des brûlures)
Un siècle si dense, si cruel et si court. Le XXe. Il commence en juillet 1914 avec la Première Guerre mondiale et se termine en novembre 1989 par la chute du mur de Berlin. Si j’ai à le stigmatiser à l’aune de mon humeur du moment, je le ferai en racontant une scène dérisoire par rapport aux atrocités commises, mais significative au regard du thème même de notre rencontre. Dans le Vietnam des terribles années soixante, les brancardiers amènent à un hôpital américain de campagne un GI blessé. Le chirurgien major, scie en main, s’apprête à lui trancher le restant de sa jambe déchiquetée. Le soldat est hagard, ses yeux mobiles roulent de visage en visage. Le praticien, lui-même découragé, lui demande : «Que cherchez-vous, fiston ? De la sympathie? Vous en trouverez dans le dictionnaire, entre scatologie et syphilis».
.jpg)
D’aucuns s’offusqueraient à me voir mettre en exergue un détail infime en face de dizaines de millions de morts. Ce détail explique, à mon sens, le pourquoi de la barbarie : la perte de la sensibilité, la perte du sens, tout court.
Nous autres, ici, la sympathie, nous la cherchons dans le SENSIBLE. Parfois, prenant le maquis intérieur, le maître du verbe cache son arsenal. Ainsi s’exprime la poétesse irakienne Nazek al-Malaïka:
وشفاهٌ تموتُ ظمْأى ولا تسْأل أيْن الرحيقُ أيْن الكأسُ
ونفوسٌ تحِسُّ أعْمقَ إحساسٍ وتبدو كأنَّها لا تحِسُّ
Cela donnerait en français, en respectant la rime:
Et des lèvres de soif trépassent
Sans réclamer nectar ni tasse
Et des âmes ultra-sensibles
Faisant semblant d’être impassibles
.jpg) J’entends souvent le valéryen Monsieur Teste appeler à une sorte de clandestinité métaphysique: «Cache ton dieu, cache ton diable», ce qui, en ces steppes arides de l’esprit, peut s’avérer salvateur. Le fondamentalisme criminogène, en dépit des apparences, n’est pas le monopole de l’islamisme. Dans la débâcle actuelle de la civilisation, toutes les religions, même le bouddhisme, naguère si pacifique, brandissent leur dard. Pires que les intégristes dûment diagnostiqués, les séropositifs abondent. Et c’est dans cette perspective que je relis aujourd’hui l’assertion de Valéry, encore lui : «Il faut entrer en soi-même armé jusqu’aux dents».
J’entends souvent le valéryen Monsieur Teste appeler à une sorte de clandestinité métaphysique: «Cache ton dieu, cache ton diable», ce qui, en ces steppes arides de l’esprit, peut s’avérer salvateur. Le fondamentalisme criminogène, en dépit des apparences, n’est pas le monopole de l’islamisme. Dans la débâcle actuelle de la civilisation, toutes les religions, même le bouddhisme, naguère si pacifique, brandissent leur dard. Pires que les intégristes dûment diagnostiqués, les séropositifs abondent. Et c’est dans cette perspective que je relis aujourd’hui l’assertion de Valéry, encore lui : «Il faut entrer en soi-même armé jusqu’aux dents».
Mais les mots aiment à se pavaner, à se donner à voir. Dans sa pièce, Le Dindon, Georges Feydeau fait dire à l’un de ses personnages:
«Comment veux-tu que je te comprenne? Tu me parles à contre-jour ; je ne vois pas ce que tu dis».
Récemment, à la Cité de la Culture Chedli-Klibi, notre ami, le philosophe Mohamed Mahjoub, nous faisait une belle conférence sur «l’Histoire de la peur». Le tangible est le sensible par excellence, mais le sensible va au-delà, il englobe ce qui dépasse les cinq sens. La peur, par exemple, la peur absolue. Et s’il me faut une citation puisée dans mon répertoire, je la chercherai moins chez un éminent spécialiste tel qu’un Jean Delumeau que dans un humble journal intime où, c’est bien la vie, non la mort, qui fait peur. «Je sens la vie qui se rapproche, alors que tout ce que je veux c’est mourir». Terrible sentence tirée d’un ouvrage mineur, néanmoins étonnant, Fragments. Poèmes, écrits intimes, lettres de Marilyn Monroe (Paris, le Seuil, 2010).
Marilyn, jeune femme partie de rien et parvenue au firmament des stars, n’était pas qu’un époustouflant sex-symbol. Elle s’est donné la mort à trente-six ans, à peine plus âgée que le Christ ou Eva Perón. Martyrisée à rebours, en boomerang, par une beauté tyrannique et surtout par un amour totalitaire, elle notait sur une feuille banale : « Une carrière, c’est fantastique, mais on ne peut pas se blottir contre elle, la nuit, quand on a froid ». Plus poignante encore cette confidence : «J’ai essayé, tout l’hiver, d’imaginer le printemps, il est là et je me sens toujours aussi désespérée». Outre la charge poétique qu’elle recèle, cette souffrance nous touche parce que nous aussi, nous avons mal à notre printemps arabe.
Riche de 430 livres, la bibliothèque de Marilyn réunit l’Ulysse de Joyce à la Bovary de Flaubert, en passant par Aristote, Platon, Fitzgerald, Hemingway, Walt Whitman, Pirandello... Elle a été vendue aux enchères, en 1999, au profit d’une association caritative pour les écrivains nécessiteux.
Lectrice invétérée, cherchant à se hisser au niveau d’Arthur Miller, un moment, son mari, ses nombreuses photos, livre en main, agaçaient Hollywood.
«Hollywood, écrit-elle, est un endroit où ils vont vous payer un millier de dollars pour un baiser et cinquante cents (centimes) pour votre âme...»
De cette âme profondément sensible, et pour rester dans le sujet, gardons une savoureuse déclaration faite, en 1960, deux ans avant son suicide, au magazine Marie Claire et qui a fait le tour du monde : «on me pose des questions, que portez-vous pour dormir? Un pyjama, un bas de pyjama? Une chemise de nuit? Alors, j’ai répondu: quelques gouttes de Chanel N°5. Parce que c’est la vérité ! Je ne vais pas dire nue !»
Nous avons fait, jusque-là, l’apologie du corps. Qu’en est-il de ses servitudes? L’homme est un animal malade, diagnostiquait Nietzsche. Il y a mille ans, un poète syrien aveugle, al-Maarri (973-1057), le Milton des Arabes, écrivait :
وأشْرفُ منْ تَرى في الأرضِ قدْرًا / يعيشُ الدهْرَ عبْدَ فَمٍ وفَرْجِ
Ce qui donnerait en français:
L’homme, ici-bas, si éminent que soit son rang,
S’aliène au sexe et à bouffer, la vie durant.
Mais j’aimerais revenir au pyjama de Marilyn. Sur cette exhalaison suave, je vous exhorte à prendre soin de votre sensibilité. Merci de votre attention..
Abdelaziz Kacem
- Ecrire un commentaire
- Commenter