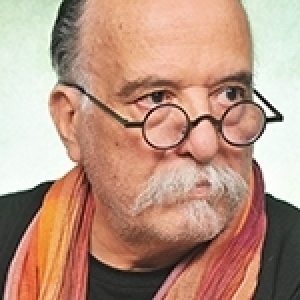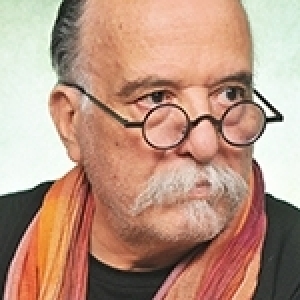Tahar Bekri: L’œuvre littéraire comme devoir de liberté

Un jour, le Prix Nobel de littérature, Claude Simon, était invité par l’Union des Ecrivains à Moscou, on lui posa la question suivante : « Quelles sont vos préoccupations en ce moment ? ». Il répondit : « Mon problème est comment commencer une phrase et la finir ». Je sais combien la littérature est d’abord affaire d’écriture, de mots et de langue, de langage, de forme et de style.
Et pourtant, et ce, depuis peut-être, L’Epopée de Gilgamesh chez les Babyloniens, en passant par Le livre des morts chez les Anciens Egyptiens, appelé aussi (Livre pour sortir au Jour, 1700 av. notre ère) et bien sûr, par L’Iliade et l’Odyssée d’Homère (VIII sème av. JC. ), l’aventure magnifique de l’esprit humain, qu’est la création littéraire, a fait que la langue soit devenue, au-delà des mots, parole qui nous touche, nous bouleverse et nous émeut. Est-ce parce que la littérature porte en elle la parole faite expression des sentiments les plus profonds, des éternelles questions concernant la vie, l’amour, la mort ? Expression de la vision du monde ? Combat humain, permanent, fragile, mais souvent, comme celui de Sisyphe ou de Don Quichotte, trop humain, pour ne pas être tragique ou risible?
Dans le même temps, l’œuvre peut-elle échapper au mystère de l’art, à l’importance des idées dans la création poétique ? Mallarmé me rétorquera, comme il l’a fait pour Degas, « Ce n’est point avec des idées qu’on fait des vers, c’est avec des mots ». Pour autant, il est légitime de se demander si l’œuvre peut se suffire à elle-même, se limiter à un exercice de style, à une quête esthétique ou une affaire de mots ?
Je n’ai pas la prétention ici d’apporter des réponses faciles à ce vaste champ de la pensée littéraire, mais de soumettre à votre attention, de bien modestes réflexions et témoignages personnels sur un parcours, aussi sinueux que complexe, mais toujours ouvert sur ce qui me semble constituer une implication de l’être, dans l’exigence laborieuse et la responsabilité éthique..
D’emblée, je dirais que l’œuvre littéraire s’écrit dans le doute, le questionnement, l’interrogation, l’ambivalence, l’ambiguïté. En somme, dans la quête brûlante des vérités, dans ce feu intérieur qui l’anime et qui tente d’atteindre les profondeurs ontologiques, pour les exprimer dans une langue qui peine toujours à trouver ses mots, surtout si la langue d’écriture n’est pas la langue maternelle, une langue étrangère et c’est mon cas. Je reviendrai sur cette question un peu plus tard, et ce n’est pas un lieu commun que de dire, dans le domaine de l’écriture, toute langue est une langue étrangère.
J’ajouterais qu’écrire est parler en silence, avec ce que le silence porte en lui de signification et de sens. Peut-être, placerais-je ici la poésie, je veux dire, l’économie du verbe, l’allusion, la métaphore, la suggestion, non l’explication et la redondance ou la paraphrase, l’œuvre habitée par l’antagonisme, le conflit intérieur, le tiraillement, le tourment et la rébellion aimante, loin de l’affirmation simpliste ou de l’idéologie linéaire, cette voix de son Maître, si ennuyeuse et dangereuse, l’œuvre faite outil de propagande. Nul besoin de rappeler ici combien cela fut fatal à tant d’écrits, aujourd’hui jetés dans les oubliettes de l’Histoire !
C’est que l’œuvre littéraire, qui retient notre attention, est d’abord acte de liberté, affranchie de toute servitude, politique, sociale, religieuse, idéologique, et linguistique. Elle est expérience humaine singulière, résistance à l‘opprobre, lutte contre l’avilissement, chant de dignité, célébration de la vie. De nombreux écrits littéraires se distinguent régulièrement par leur anti-conformisme, leur courage, échappent à la pesanteur officielle ou collective, contrarient la volonté du dogme figé, remuent le confort stérile de la pensée séculaire.
Je voudrais ici prendre deux exemples dans la littérature arabe contemporaine:
Il y a, à Copley Square, à Boston, un monument érigé en hommage à l’écrivain libanais, Khalil Gibran (1883-1931), l’auteur du Prophète, de La Musique et de Sable et écume, etc. Dans le froid glacial de l’hiver américain, je tenais à aller sur les traces de cet auteur que je lisais, lycéen, en Tunisie et dont les aphorismes poétiques, comme les pensées spiritualistes donnaient tant d’élévation à l’âme, de hauteur à l’amour, à l’art, à la beauté, à la condition humaine qu’il a si bien décrits dans Les ailes brisées. L’écriture de Khalil Gibran, qui vécut aussi en Europe, qui fut un ami de Rodin, apporta, grâce à ses influences extrêmes-orientales une spiritualité nouvelle à la culture arabe, bouscula dans le même temps, la tradition chrétienne. Le clergé n’a pas tardé à combattre son œuvre. Son œuvre innovatrice fut jugée comme une menace à l’ordre religieux, même, si de nos jours, l’ouvrage Le Prophète est parmi les livres les plus lus au monde. Khalil Gibran appartient aux écrivains de l’exil arabe «Al Mahjar», ceux qui ont émigré aux Etats-Unis, en Argentine, au Brésil, en Amérique, en général et ce, au début du 20ème s. Par leur audace, par leur thématique nouvelle au contact de la littérature occidentale, les œuvres de ces auteurs exilés ont participé amplement à la modernité littéraire arabe, celle-là qui a marqué en période coloniale, le jeune poète tunisien, Aboulkacem Chebbi (1909-1934).
J’en arrive au deuxième exemple : Poète révolté contre la tyrannie coloniale, l’oppression et l’humiliation, Aboulkacem Chebbi leur opposa, avant de mourir à l’âge de 25 ans, Les chants de la vie, son recueil. Dans cette œuvre, écrite dans la fougue de la jeunesse, il célèbre la liberté, la volonté humaine, la nature, la beauté, l’amour, l’imagination poétique. Et comme Gibran, il écrit Le prophète inconnu et appelle à la dignité du peuple, dans son poème « La volonté de vivre » :
Si le peuple décide un jour de vivre /Force est au Destin de répondre
Force est à La Nuit de se dissiper /Force aux chaînes de se briser
Ces vers, qui font partie de l’hymne national tunisien, ont été scandés par des milliers de manifestants lors du « printemps arabe ». Pourtant, ce poème, qui fut combattu dans les années trente, pour hérésie, continue à déranger de nos jours les milieux fondamentalistes. Aussi, l’ont-ils réécrit et perverti sur leurs sites. A. Chebbi a découvert les romantiques français, très tard, grâce aux traductions faites au Moyen-Orient arabe. Et si l’on peut faire constater qu’il n’a pas eu connaissance de mouvements poétiques comme le surréalisme, le futurisme ou le dadaïsme, il est facile de le considérer comme l’un des fondateurs de la modernité littéraire arabe, même si la forme de sa poésie est restée classique. K. Gibran comme Chebbi sont deux voleurs de feu et leur modernité, a dû faire face au conservatisme, à la crainte de l’innovation.
La modernité ? Est-elle forcément celle de Baudelaire, pour se référer à la littérature française ou une modernité relative et spécifique à l’histoire littéraire de chaque peuple ?
J’ai lu Khalil Gibran et Aboulkacem Chebbi et leurs œuvres ont fait partie de mon Livre de sable (El libro de arena, 1975) pour reprendre Jorge-Luis Borges (1889-1986), je veux dire par là, l’oeuvre littéraire humaine qui s’écrit à l’infini, inépuisable, immense. Et comme les grains de sable, on ne peut que constater notre incapacité à saisir tout ce qui s’écrit par l’esprit humain, notre orgueil est mis à mal et c’est tant mieux. Nous devons beaucoup apprendre de la littérature, de ses obstacles, de l’entassement de ses connaissances, de l’enchevêtrement de ses pages, dans ce relais humain où l’on découvre plus que l’on invente. Telle est la chance de L’œuvre ouverte, tel est le bonheur d’Umberto Ecco.
Dans la nouvelle « La quête d’Averroès » extraite de El Aleph (L’Aleph, 1949) de J-L Borges, le grand philosophe et théologien musulman andalou, du 12ème siècle, Ibn Rochd/Averroès (Cordoue,1126-Marrakech,1198), le commentateur de la Poétique d’Aristote, ne pouvait saisir les termes qui correspondent à la comédie ou la tragédie chez les Grecs, arts, restés méconnus chez les Arabes jusqu’au 19ème s. Borges veut nous donner ici une grande leçon de modestie : nos connaissances littéraires, forcément limitées, exigent de nous une quête inlassable, harassante, quasi-impossible, mais combien bénéfique car elle nous oblige à nous abreuver à plusieurs sources, quitter nos frontières réelles ou imaginaires. Mais sait-on vraiment où se situe La frontière, existe-elle ? Et j’ai ici une pensée pour l’italien, Claudio Magris et son Danube.
La littérature a ce pouvoir de nous faire voyager dans le temps et l’espace, sans frontière, ce à quoi j’ai essayé de m’employer très tôt, pour découvrir le monde, sa vastitude, la richesse de ses cultures et afin que l’œuvre m’emportât au plus loin, ouvrant les portes des sept merveilles.
Imaginez donc un jeune dans le sud tunisien, aux portes du désert, en train de lire Pouchkine dans ces paysages de neige ! Un peu plus tard, beaucoup d’écrivains russes et scandinaves m’invitaient à ce Nord dont j’avais besoin comme homme du sud, afin de cesser d’être regardé et devenir regardant, quitter cet Orient mythifié par Pierre Loti, Flaubert, Guy de Maupassant, Nerval, Chateaubriand… Un écrivain du sud a-t-il un nord ? Qu’est-ce qui fait qu’un écrivain, comme le Suédois, Gunnar Ekelöf (1907-1968) puisse écrire sa trilogie poétique Diwan, notamment, son volume III (La légende de Fatumeh, Gallimard, 1979), s’inspirer du soufisme et de la mystique musulmane, alors qu’un écrivain du sud n’a de regard que pour son propre sud ? Qu’est-ce qui fait que Goethe (1749-1832) se soit intéressé à l’islam perse dans son Diwan Occidental-Oriental (18919) sans qu’un écrivain du sud trouve cela étonnant ou remarquable ? L’œuvre littéraire doit-elle être limitée à nos propres préoccupations, nos territoires et régions?
J’admets que notre Sud (mais où commence-t-il ?) soit encombré par tant de heurs et malheurs et que le Nord puisse à loisir porter son regard vers d’autres cieux, en faire ses sources d’inspirations littéraires plus légères. Cependant, cette relation déséquilibrée m’est intolérable et je la considère comme négative, car elle m’enferme dans l’immobilité et me condamne à la sclérose. Qu’est-ce qui m’empêche donc d’inverser la relation, afin qu’elle devienne sud-nord ? Dans sa crainte de l’Autre, l’identité stagne, se meurt, quand elle ne devient pas, tout simplement, dangereuse et meurtrière, pour reprendre l’écrivain libanais, Amin Maâlouf (Les identités meurtrières, 1998).
Or, il n’en fut pas toujours ainsi dans la littérature arabe, notamment, dans la littérature de voyage et ce, tout le long de l’âge médiéval : la relation de voyage d’Ibn Fadhlan, Voyage chez les Bulgares de la Volga, (921) où il décrit « الروسLes Russ » les Slaves, les Vikings, les peuples de la Volga…Tant d’auteurs voyageurs, écrivains géographes, sont allés à la découverte de l’Autre, décrire sa culture, sa religion dans un souci de curiosité et de connaissance : Le Marocain, Al Idrissi ( Ceuta 1099-Sicile 1161) qui fut au service de Roger II à Palerme et qui nous laisse son ouvrage (Le Livre du divertissement de celui qui veut découvrir le monde), connu sous le nom de Livre de Roger ; Al Mas’ûdi ( Bagdad IX-Fustât Xème s) avec ses Prairies d’or ; Ibn Battûta, (Tanger 1304- Marrakech 1377), contemporain de Marco Polo et qui relate son voyage jusqu’aux confins de la Chine, non sans avoir décrit auparavant Constantinople. Tant d’auteurs découvraient les merveilles du monde, en apportaient un regard sur l’Autre, sans adversité ni violence, même si quelques préjugés étaient relevés, ici ou là. Ces relations obéissaient à l’idée fondamentale en Islam, que la terre dans sa vastitude, appartient à Dieu et qu’il est du devoir du musulman de la connaître.
La relecture de ces auteurs classiques me remplit toujours d’une nostalgie qu’il m’est difficile de repousser, tant cette période me semble lointaine. Et c’est pourquoi je suis allé sur les traces de certains auteurs arabes classiques, afin de réécrire la modernité. Bien modestement, je voulais rejoindre le Mexicain, Octavio Paz, dont j’avais utilisé cette phrase comme exergue pour l’un de mes ouvrages Les Chapelets d’attache (1993) : « Un jour, j’ai découvert que je n’avançais pas, mais que je revenais au point de départ : la quête de la modernité était une descente vers les origines ».
Aussi, suis-je allé sur les traces d’Imru’ul Qays, Al malek ad-dhillil, le roi errant, en Arabie du 6ème siècle pour interroger l’errance moderne ; de même, sur les traces de l’andalou, Ibn Hazm (Jativa 994-1064), auteur du célèbre Collier de la colombe pour interroger l’exil, l’amour, la montée de l’intolérance religieuse et la chute des dynasties et enfin sur les traces du Turc anatolien, Yunus Emre, (1240-1321) grand poète de l’amour soufi pour interroger l’islam moderne, entre laïcité et foi religieuse, contexte des révolutions arabes oblige.
L’œuvre littéraire, en ce qui me concerne, ne peut se permettre le luxe d’être légère, surtout dans nos contrées, pour l’ampleur des questions qu’elle se pose. Tant d’événements mondiaux me violentent, dans la souffrance, l’indignation, la stupeur et la frayeur. Par exemple, comment accepter qu’une campagne ait eu lieu pour détruire des pianos et des instruments de musique occidentaux en Lybie, par haine de l’Occident ? Comment accepter qu’on interdise la musique occidentale de la radio et la télévision nationale en Iran ? Un monde où l’on casse des pianos, où l’on interdit Mozart et Beethoven, ne peut laisser un poète indifférent. Cela fut l’origine de l’écriture de mon recueil Si la musique doit mourir (Al Manar, 2006).
Je n’ai que ma plume pour combattre l’obscurité que l’on veut m’imposer. J’essaie de le dire dans deux langues, le français et l’arabe, dans ce bilinguisme appris à l’école tunisienne post-indépendante et qui m’a tant apporté et enrichi. Un bilinguisme assumé et revendiqué comme une possibilité au dialogue, nécessaire entre les textes et les cultures. Et c’est un privilège que de pouvoir le faire, en toute liberté.
Peu importe donc, si je suis francophone ou arabophone ou les deux, l’essentiel est de ne pas être réduit au silence, celui-là auquel on a voulu réduire les voix de : Garcia Lorca, Antonio Machado, Max Jacob, Robert Desnos, Benjamin Fondane, Walter Benjamin, Primo Levi, Pasolini, Nazim Hikmet, Boris Pasternak, Soljenitsyne, Joseph Brodsky, Vaclav Havel, Milosz, Taslima Nasreen, Nejib Mahfouz, Nawal Saâdaoui, Faraj Fouda, Mahmoud Darwich, Tahar Djaout, etc. La liste serait, hélas, trop longue.
Il nous faut ériger la liberté de l’art, face à ses ennemis, face à l’obscurantisme rampant, reconstruire La Tour de Babel, sans orgueil ni hégémonie, consolider l’entente entre les langues et les cultures, échapper à la damnation de la cacophonie. Mais, je ne suis ni optimiste béat, ni naïf, car la littérature a aussi ses failles, ses zones d’ombre, ses préjugés fanatisés, sa lâcheté, son chauvinisme, son racisme : Drieu La Rochelle, Charles Maurras, Céline, devenu antisémite, le Norvégien, Knut Hamsun et sa collaboration avec les Nazis, les soupçons autour de Peter Handke dans la guerre de Serbie, etc. L’œuvre littéraire exige de nous la vigilance permanente, le refus de participer aux cris de la guerre, comme l’ont fait de nombreux écrivains ces dernières années, d’être aux aguets au manquement aux valeurs fondamentales de l’Humanité.
Sa liberté est un rempart contre la destruction et la barbarie, défense de la culture, base de la civilisation humaine. Le chemin est long et ardu, je le sais, mais pour lequel la littérature vaut les grands sacrifices, les convictions courageuses, les difficiles et belles traversées.
Tahar Bekri
*Conférence inaugurale donnée à l’Ecole Doctorale de l’Université de Paris-Nanterre, (nouvelle version.)
- Ecrire un commentaire
- Commenter