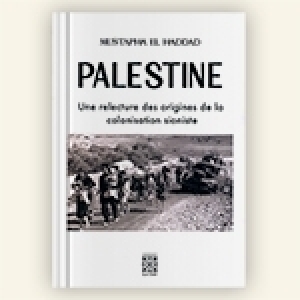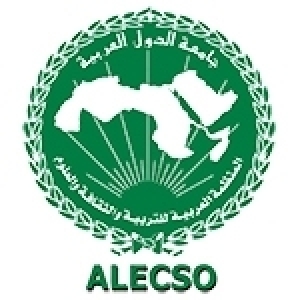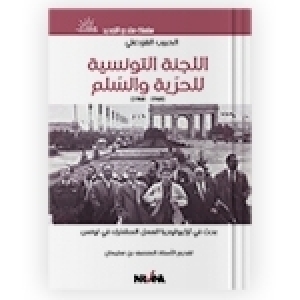Mohamed-El Aziz Ben Achour: La crise de succession au trône beylical (septembre 1814 - janvier 1815)
 Salon dit Bayt-el- billar. Construit sous le règne de Mahmoud Pacha Bey, il abrita jusqu’en 1957 un des trônes du Bardo (sous la république, ce salon devint le bureau du président de l’Assemblée)
Salon dit Bayt-el- billar. Construit sous le règne de Mahmoud Pacha Bey, il abrita jusqu’en 1957 un des trônes du Bardo (sous la république, ce salon devint le bureau du président de l’Assemblée)
.jpg) Nos lecteurs se souviennent (Leaders,63, 2016) que la dynastie husseïnite fondée en 1705 fut, quelques années plus tard, à deux doigts de sa perte lorsqu’Ali Pacha se rebella contre le fondateur, son oncle Husseïn Bey Ben Ali. Cette rébellion consécutive à la mise à l’écart du neveu au profit du prince Mohamed el Rachîd prit, en 1728-29, l’ampleur d’une guerre civile opposant les «pachistes» aux «husseïnistes». Vaincu, Ali Pacha se réfugie à Alger. En 1735, revenu avec les troupes d’invasion algéroises, il reprend le pouvoir, mais les husseïnistes poursuivent la lutte jusqu’en 1740 lorsque Husseïn Bey est tué et ses fils sont contraints à l’exil à Alger et Constantine.
Nos lecteurs se souviennent (Leaders,63, 2016) que la dynastie husseïnite fondée en 1705 fut, quelques années plus tard, à deux doigts de sa perte lorsqu’Ali Pacha se rebella contre le fondateur, son oncle Husseïn Bey Ben Ali. Cette rébellion consécutive à la mise à l’écart du neveu au profit du prince Mohamed el Rachîd prit, en 1728-29, l’ampleur d’une guerre civile opposant les «pachistes» aux «husseïnistes». Vaincu, Ali Pacha se réfugie à Alger. En 1735, revenu avec les troupes d’invasion algéroises, il reprend le pouvoir, mais les husseïnistes poursuivent la lutte jusqu’en 1740 lorsque Husseïn Bey est tué et ses fils sont contraints à l’exil à Alger et Constantine.
Ils ne purent retourner victorieux qu’en 1756, grâce à l’appui d’un corps expéditionnaire constitué par le dey d’Alger, décidément très impliqué dans les affaires tunisiennes, peut-être sur instructions du gouvernement impérial ottoman inquiet de l’instabilité en cours dans le beylik de Tunis. La solidarité sans faille entre les fils de Husseïn, soudée par les circonstances tragiques de la mort de leur père et leur long exil, se traduisit par l’allégeance affectueuse et respectueuse d’Ali à l’égard du nouveau bey, son aîné Mohamed-El Rachid. A la mort de ce dernier survenue en 1759, Ali Bey – qui était déjà une sorte de régent de son frère qui ,diminué par la maladie avait, semble-t-il, peu de goût pour l’exercice du pouvoir, écœuré, à en croire les historiographes, par les massacres et les pillages qui avaient accompagné son retour d’exil - lui succéda. Il accéda au trône sans contestation aucune et obtint aisément du Sultan le titre de pacha. Toutefois, cette succession ne s’appuyait pas sur un principe institutionnalisé. D’ailleurs, d’une manière générale, lorsqu’on parle de la « règle » de primogéniture, il convient de préciser qu’il ne s’agissait guère plus que d’une sorte de convention tacite entre frères et accessoirement entre cousins qui acceptaient avec plus ou moins de bonne volonté que l’aîné accédât au pouvoir. De sorte que c’était un accord institutionnellement fragile. C’est ainsi que l’histoire de la dynastie précédente des beys mouradites (XVIIe siècle) - et hormis le long règne de Hammouda Pacha (1631-1666) - ne fut, en termes de succession, qu’une sanglante querelle opposant durant dix ans, de 1675 à 1686, les deux princes Mhammad et Ali, fils de Mourad II, et eux-mêmes à leur oncle El Hafsi qui revendiquait l’exercice à son profit du droit d’aînesse. Le péril— apparu une nouvelle fois entre 1697 et 1699— était d’autant plus grand que d’autres pouvoirs issus de la conquête ottomane de 1574, ceux du dey et du divan des janissaires, bien que politiquement affaiblis par les beys mouradites, constituaient toujours une menace pour la stabilité d’un Etat encore en gestation.

Au temps des beys husseïnites, le fait que la succession n’était pas précisée par une règle intangible mais par le seul consensus, plus ou moins admis par tous, autour du droit d’aînesse explique – autant que le souci du prince de garder le pouvoir dans sa descendance directe – qu’Ali Pacha Bey décida en 1777 d’investir son fils Hammouda, alors âgé de 18 ans, comme prince héritier au détriment de son cousin germain Mahmoud fils de Mohammed El Rachid, pourtant plus âgé que lui. Le caractère conciliant de Mahmoud, la manière habile avec laquelle Ali et Hammouda se comportèrent à l’égard de sa famille, firent que les choses se passèrent sans fracas. En 1782, Hammouda succéda à son défunt père. Son long règne, prospère certes, ne fit cependant qu’occulter les risques que la mise à l’écart de Mahmoud faisait peser sur la stabilité du trône. De sorte qu’à la mort de ce grand prince, survenue en septembre 1814, la crise affleura de nouveau. En effet, alors même que Mahmoud Bey rappelait haut et fort sa prétention au trône au nom du droit d’aînesse, Youssouf Saheb-Ettabâa, vizir du défunt pacha, forçant la main aux dignitaires du Bardo, plaça sur le trône Othman, frère de Hammouda. Le Saheb-Ettabâa (c’était le titre de sa fonction initiale d’applicateur du sceau beylical mais ses attributions, effectives, quoique non officielles, étaient celles d’un premier vizir), auquel une relation passionnelle liait à Hammouda, était devenu un personnage particulièrement puissant et bientôt à la tête d’une fortune considérable. Archétype du vizir de l’Orient, Youssouf, originaire de Moldavie (El Boghdân), avait été acquis à Istanbul pour le compte du caïd Bakkar Djellouli, élevé à Sfax, au sein de la famille de ce puissant caïd, rompu à la langue, à la culture et aux traditions tunisiennes puis offert à Hammouda à l’occasion de son élévation à la dignité de prince héritier. Une fois Hammouda au pouvoir, Youssouf, dont les qualités politiques et l’aptitude au commandement s’imposèrent à tous, devint son bras droit et le demeura jusqu’à la fin du règne. Comme c’était l’habitude en régime despotique, il mit en coupe réglée le pays, domina l’activité économique, arma en course et accumula une imposante fortune. Cette réussite spectaculaire lui fit des inimitiés tenaces Mais il n’en avait cure et exerçait, avec la bénédiction de son prince, un grand pouvoir qu’il savait faire apprécier par une munificence dont les chroniques autant que l’architecture religieuse gardent encore le témoignage.

 On comprend, dans ces conditions, que son maître disparu, Youssouf Saheb-Ettabâa ait songé à exploiter sa vaste connaissance des affaires et du pays dans son ensemble, confisquer la réalité du pouvoir à son profit en mettant sur le trône un prince dont il se proposait secrètement d’être, en quelque sorte, le régent. Mais si Mahmoud bey avait pris de l’âge (né en 1757, il avait 63 ans en 1814), il n’en réclamait pas moins une légitime réparation de l’injustice dont il estimait avoir été victime auparavant. En outre, ses fils Husseïn et Mustapha (nés respectivement en mars 1784 et en juillet 1787) étaient devenus de solides gaillards peu disposés à rester à l’écart des affaires. Les intrigues ayant fait leur œuvre, Mahmoud Bey décida de passer à l’action. Le 21 décembre 1814, accompagné des princes Husseïn et Mustapha, il pénètre au palais, entre dans la chambre du souverain et fait feu sur le malheureux Othman son cousin et oncle de ses enfants. Il sort, se rend compte que le bey régnant n’est que blessé et ordonne à Mustapha de revenir l’achever. Les fils de l’illustre victime, Salah et Ali, sentant le danger, réussissent à quitter subrepticement Le Bardo, se dirigent vers le faubourg de Bab Souika où résident des officiers du makhzen, tentent sans succès d’obtenir leur soutien, puis arrivent sous les murs de la citadelle de la Kasbah sans parvenir non plus à gagner la sympathie des chefs de la garnison. En désespoir de cause, ils se dirigent vers La Goulette dans la perspective d’embarquer sur un bateau qui les conduirait en un lieu sûr. Arrivés sur place, ils échouent encore à convaincre les autorités militaires et maritimes, sont rattrapés par l’escorte des princes Husseïn et Mustapha et décapités séance tenante. Othman Bey et ses fils assassinés, Mahmoud accéda enfin au trône et ne tarda pas à obtenir l’investiture du sultan et le titre de pacha, bey de Tunis.
On comprend, dans ces conditions, que son maître disparu, Youssouf Saheb-Ettabâa ait songé à exploiter sa vaste connaissance des affaires et du pays dans son ensemble, confisquer la réalité du pouvoir à son profit en mettant sur le trône un prince dont il se proposait secrètement d’être, en quelque sorte, le régent. Mais si Mahmoud bey avait pris de l’âge (né en 1757, il avait 63 ans en 1814), il n’en réclamait pas moins une légitime réparation de l’injustice dont il estimait avoir été victime auparavant. En outre, ses fils Husseïn et Mustapha (nés respectivement en mars 1784 et en juillet 1787) étaient devenus de solides gaillards peu disposés à rester à l’écart des affaires. Les intrigues ayant fait leur œuvre, Mahmoud Bey décida de passer à l’action. Le 21 décembre 1814, accompagné des princes Husseïn et Mustapha, il pénètre au palais, entre dans la chambre du souverain et fait feu sur le malheureux Othman son cousin et oncle de ses enfants. Il sort, se rend compte que le bey régnant n’est que blessé et ordonne à Mustapha de revenir l’achever. Les fils de l’illustre victime, Salah et Ali, sentant le danger, réussissent à quitter subrepticement Le Bardo, se dirigent vers le faubourg de Bab Souika où résident des officiers du makhzen, tentent sans succès d’obtenir leur soutien, puis arrivent sous les murs de la citadelle de la Kasbah sans parvenir non plus à gagner la sympathie des chefs de la garnison. En désespoir de cause, ils se dirigent vers La Goulette dans la perspective d’embarquer sur un bateau qui les conduirait en un lieu sûr. Arrivés sur place, ils échouent encore à convaincre les autorités militaires et maritimes, sont rattrapés par l’escorte des princes Husseïn et Mustapha et décapités séance tenante. Othman Bey et ses fils assassinés, Mahmoud accéda enfin au trône et ne tarda pas à obtenir l’investiture du sultan et le titre de pacha, bey de Tunis.
Dans cette tragique accession au trône, un dignitaire de souche tunisienne dont la famille de Béja revendiquait une ascendance chérifienne, Mohamed-El Arbi Zarrouk, joua un rôle considérable. Dignitaire du premier rang sous le règne de Hammouda Pacha mais rival de Youssouf, il mit à profit sa proximité avec la famille du prince Mahmoud (il était le frère de lait de son épouse, la princesse Emna, sœur de Hammouda) pour œuvrer à l’élimination de l’encombrant et ambitieux Saheb- Ettabâa. Ce dernier, croyant sans doute que le complot qu’il avait ourdi en septembre serait pardonné avec la mort de Othman Bey et de ses fils, prit à la lettre les marques de confiance que lui prodigua habilement Mahmoud. Son mariage annoncé avec une des filles du nouveau pacha acheva de le rassurer quant à son avenir et il crut pouvoir continuer d’agir comme du temps de son défunt maître. En fait, le pacha n’oubliait pas que Othman avait été placé sur le trône par Youssouf malgré les protestations de celui-là même qui aujourd’hui gouvernait l’Etat en monarque absolu. Outre cette pression exercée sur Mahmoud, Youssouf s’attacha à faire naître le doute dans l’esprit des princes Husseïn et Mustapha quant à la loyauté d’El-Arbi Zarrouk. Il ne manqua pas de leur faire miroiter les avantages que leur procurerait la gestion des affaires du pays sous l’égide de leur père, réputé pour sa bonhommie. A ces perspectives politiques, s’ajouteraient – les laissait imaginer Youssouf - les richesses qui proviendraient de la confiscation des biens de Zarrouk, une fois ce dernier éliminé. Mais s’il existe un endroit où les murs ont des oreilles, c’est bien le sérail, et El-Arbi eut vent des dangereuses intrigues qui se tramaient contre lui. Rompu aux arcanes du pouvoir oriental, il ne changea pas d’attitude mais n’en était pas moins sur ses gardes. Youssouf ayant pris à la lettre les propos du bey qui l’engageait à poursuivre son travail comme du temps de son maître eut la maladresse de traiter les princes avec un paternalisme condescendant qui les agaçait d’autant plus que le vizir réfrénait leurs ambitions et les dépenses occasionnées par leur goût du luxe. Par ailleurs, le frère de Mahmoud Pacha, Ismâ’îl Bey, vexé d’avoir été écarté du commandement du Camp sur le conseil de Youssouf, se joignit aux mécontents. Avec une insistance qui dut paraître suspecte, Saheb-Ettabâa, dans son zèle à se maintenir aux affaires en circonvenant le bey, commit l’imprudence de conseiller au pacha de se débarrasser de «ceux qui avaient contribué à son accession au pouvoir. En effet, ajoutait-il, le précieux service rendu naguère [à Mahmoud] donnerait immanquablement naissance à une insolence, certes maîtrisée, mais périlleuse et un inévitable et fâcheux ascendant de ces dignitaires sur le trône». Il faisait ainsi une allusion à peine voilée à El-Arbi Zarrouk. Manœuvrant avec intelligence, ce dernier réussit à retourner la situation au détriment de Youssouf en alimentant contre lui la rancœur des princes qu’il maintenait à l’écart des affaires. Dès qu’ils en firent part à Zarrouk, il mit en œuvre un plan destiné à compromettre Saheb-Ettabâa en l’accusant, sur la base de faux documents, de tramer une conspiration avec les autorités militaires de la capitale et du Bardo pour assassiner le bey et à sa famille et prendre le pouvoir.
On s’arrangea pour faire parvenir les «preuves» de ce complot imaginaire au bey. Pris de panique, Mahmoud demanda conseil. A l’exception d’un dignitaire (Soulaymân Kâhia) qui lui recommanda de s’assurer au préalable du bien-fondé des accusations, tous firent mine d’accuser Youssouf sans détour. Le 29 janvier 1815, on convoqua le malheureux au palais et alors qu’il s’apprêtait à franchir le seuil du salon connu sous le nom de Bayt al Bâchâ, il fut insulté, violemment frappé par le garde qui l’escortait et horriblement blessé au visage d’un coup de poignard. Il s’effondra et aussitôt un militaire le décapita d’un coup d’épée tandis que d’autres hommes en armes s’acharnèrent sur son corps. « Ainsi, écrira plus tard avec amertume l’historien Ben Dhiaf, meurent les vizirs des rois absolus en Islam ». Ce qui est absolument effarant, c’est que le cadavre de Youssouf fut livré dans le faubourg de Bab Souika à la vindicte populaire qui se déchaîna à un point tel que des témoins rapportèrent des cas de cannibalisme. Sa fortune, vite confisquée, profita à l’Etat et surtout au bey et ses fils. Immédiatement, sur ordre du pacha, on s’acharna sur tous ses proches, ses secrétaires et ses agents. Ils furent torturés, emprisonnés, bannis ou tués, et leurs biens saisis. El-Hâj Bel-Dhiâf, secrétaire particulier de Youssouf et père de notre célèbre historien, faillit être décapité. Il ne dut son salut qu’à l’intervention de El-Arbi Zarrouk qui cria au bourreau de l’épargner car il était le régisseur des biens de Saheb-Ettabâa et que sans lui on ne saurait jamais l’étendue réelle de la fortune du défunt. Il fut jeté en prison, torturé et dépouillé de tous ses biens.
Une fois Youssouf et les siens éliminés, El-Arbi Zarrouk pensa, sans doute, qu’il n’y aurait plus d’obstacle à sa confirmation comme nouvel homme fort du règne de Mahmoud. Il ne sut malheureusement pas dissimuler ses ambitions, afficha ostensiblement sa puissance dans ses relations avec les princes et finit par porter ombrage à l’ambitieux Husseïn. C’était d’autant plus imprudent que ce prince énergique s’affirma rapidement comme le vrai maître du pays sous l’autorité d’un père que le long isolement durant le règne de Hammouda Pacha n’avait guère préparé à l’exercice du pouvoir. Husseïn Bey se consacra à son rôle d’héritier présomptif avec une confiance en l’avenir d’autant plus sereine que sa mère, la princesse Emna, avait fait jurer à ses fils sur le Coran qu’ils n’entreraient pas en compétition pour le trône et que le cadet obéirait à l’aîné.

Au lendemain de l’exécution de Saheb-Ettabâa et durant sept ans, le bey et ses fils s’accommodèrent de l’encombrant parent et vizir puis vint le jour de la disgrâce. Le mamelouk Husseïn Khodja (Joseph Certa en chrétienté), futur vizir de Husseïn, fut placé, de manière assez perfide, sous les ordres de Zarrouk par le bey. Ce personnage ne cessa dès lors de comploter, cherchant à venger, dit-on, la mort de son ancien maître Youssouf. Il accusa El- Arbi d’œuvrer à la disparition de la dynastie en coordination avec les janissaires par le truchement de son gendre, un officier supérieur (‘ichî bâchî) du nom de Mustafa Turkî. Lui-même et d’autres intrigants firent tant et si bien que Mahmoud Pacha donna l’ordre de supprimer Zarrouk. Il fut assassiné au Bardo le 29 octobre 1822, sa fortune confisquée, et selon un scénario classique, son fils Mohamed et tous ses gens arrêtés et dépouillés de tous leurs biens.

L’atmosphère très orientale de cette crise laisse à penser qu’elle ne concerna que des princes et des mamelouks s’agitant à l’intérieur des remparts de la cité princière du Bardo. En fait, elle mit en lumière le rôle et le poids de l’élément autochtone au sein de l’appareil étatique. Outre Zarrouk, on trouve parmi les protagonistes les chefs d’une sorte de gendarmerie, le corps des spahis, qui portaient le titre de bâch hânba ‘arab (entendez « tunisiens » pour les distinguer de leur homologue, le bâch hânba turc ). Au moment de la mort de Hammouda Pacha, c’est-à-dire en 1814, le titulaire de cette charge est Ahmed Ben Ammâr avec comme adjoint Abdelwahhâb el Chârnî. Tous deux issus de la tribu des Chârin, apparentée aux beys, ils jouèrent dans la crise un rôle essentiel, bien qu’avec des objectifs opposés. En effet, Ben Ammâr fit acte de loyauté à Othman bey, tandis qu’Abdelwahhâb, ami de longue date de Husseïn, se rangea du côté de Mahmoud Bey. C’est lui qui accompagna les fils du bey à La Goulette, et poussa Husseïn à faire exécuter les frères Salah et Ali séance tenante. Il y gagna ses galons de bâch hânba et une position de choix à la cour. Autre haut personnage autochtone, le chef de la chancellerie, le bâch kâtib Mohamed Lasram qui, devenu le puissant conseiller de Othman, tint, lui aussi, une place importante dans les événements.
Cette crise aura coûté la vie à un bey régnant, aux princes Salah et Ali (les plus jeunes, encore en bas âge au moment des événements, furent épargnés. L’un d’eux restera enfermé au Bardo jusqu’en 1855, c’est-à-dire durant quarante ans). Deux vizirs, Youssouf et Zarrouk, des personnages influents de la cour du bey Hammouda, tel le mamelouk napolitain Mariano Stinca, son homme de confiance, furent emportés dans la tourmente ainsi que leurs proches, sans compter les détentions arbitraires et les confiscations. Pour la dynastie, déjà vieille de plus d’un siècle, le résultat fut que le trône husseïnite passa définitivement entre les mains des descendants de Mohamed-El Rachid Bey, l’aîné des fils du fondateur Husseïn Ben Ali.

Hormis le caractère tragique des événements qui secouèrent le sérail du Bardo, le fait remarquable qu’il convient de souligner est que les circonstances dans lesquelles s’était déroulée la querelle de succession n’ont pas donné lieu à une intervention de la milice des janissaires dans les affaires de l’Etat, alors même que le contexte y était favorable. Dey, Divan des janissaires, gouverneur de la citadelle de la Kasbah et gouverneur de La Goulette firent preuve d’une loyauté remarquable. C’était là la preuve que la dynastie, par la constance de sa politique d’assujettissement des autorités politico-militaires issues de la conquête ottomane longtemps rivales de l’institution beylicale, mais aussi l’impitoyable rigueur avec laquelle les révoltes militaires étaient châtiées – en 1811, cinq cents janissaires insurgés furent décapités en un seul jour– cette dynastie, disons-nous, avait réussi à asseoir sa légitimité de manière définitive jusqu’à l’abolition de la monarchie le 25 juillet 1957.

A partir du règne de Mahmoud Pacha Bey (1814-1824), la succession au trône se fit, sans contestation aucune, par ordre de primogéniture. Husseïn, aîné de la famille succéda à son père, puis en 1835, son frère cadet Mustapha, puis en 1837, son fils Ahmed auquel succéda en 1855 son cousin Mhammad fils de Husseïn, puis, de 1859 à 1902, ses deux frères Sadok et Ali III. Le fils de ce dernier, Mohamed-El Hédi, régna de 1902 à 1906, puis son cousin Nasser, fils de Mhammad suivi en 1922 de Mohamed-El Habib fils du prince Mimoun b. Husseïn Pacha Bey. En 1929, Ahmed II b. Ali III monte sur le trône. Après sa mort survenue en juin 1942, régnèrent successivement Moncef fils de Nasser (déposé puis condamné à l’exil par les Français en mai 1943) et le dernier monarque de Tunisie Mohamed-El Amine b. Moh. El Habib.
Mohamed-El Aziz Ben Achour
- Ecrire un commentaire
- Commenter

excellente leçon d histoire

Bonne leçon d'histoire ô combien compliquée et pleine de tragédies: assassinats et complotisme à satiété