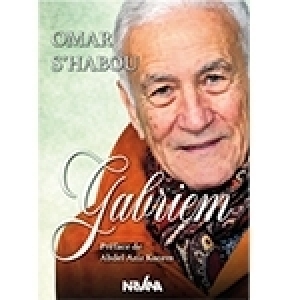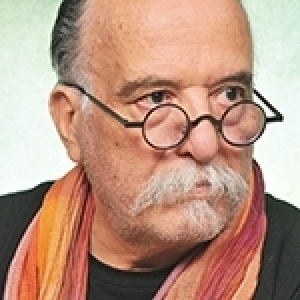Tunisie: L’émigration, une saignée du capital humain national

 Par Riadh Zghal - L'éditorial du dernier numéro de Leaders (N°141, février 2023), signé par Taoufik Habaïeb était titré : «Nous sommes tous des migrants». C’est comme s’il voulait rappeler que notre pays a attisé durant des siècles la convoitise d’envahisseurs de l’Est et du Nord. Tous ne sont pas partis ! Mais aujourd’hui, avec la domination de l’économie de la connaissance et la baisse de la croissance démographique, l’émigration des forces vives de la nation constitue un risque pour le présent et l’avenir. Le capital humain national est face à une double menace : l’émigration clandestine et les défaillances de la gouvernance des ressources humaines. A cause de ces défaillances, le capital humain qui constitue la principale richesse de notre pays est bradé et gaspillé.
Par Riadh Zghal - L'éditorial du dernier numéro de Leaders (N°141, février 2023), signé par Taoufik Habaïeb était titré : «Nous sommes tous des migrants». C’est comme s’il voulait rappeler que notre pays a attisé durant des siècles la convoitise d’envahisseurs de l’Est et du Nord. Tous ne sont pas partis ! Mais aujourd’hui, avec la domination de l’économie de la connaissance et la baisse de la croissance démographique, l’émigration des forces vives de la nation constitue un risque pour le présent et l’avenir. Le capital humain national est face à une double menace : l’émigration clandestine et les défaillances de la gouvernance des ressources humaines. A cause de ces défaillances, le capital humain qui constitue la principale richesse de notre pays est bradé et gaspillé.
En matière de braderie, les cadres supérieurs, les spécialistes, les diplômés formés à coût de milliers de dinars par personne, s’en vont vers des pays plus développés ou, du moins, plus riches. Selon le président du Syndicat tunisien des médecins libéraux, 900 médecins quittent le pays chaque année. Il ajoute que mille médecins obtiennent leurs diplômes chaque année et que le secteur de la santé compte seize mille médecins.
Selon les déclarations d’un membre du Conseil de l’ordre des ingénieurs, entre 2015 et 2021, 6 500 ingénieurs quittent le pays en moyenne par an ; la formation d’un ingénieur coûte en moyenne 100.000 DT.
Parallèlement, nombreuses sont les sources de gaspillage des forces vives de la nation:
a) Le chômage des diplômés ou non : certains se dirigent vers des activités dans le secteur informel souvent associé à la précarité, le sous-emploi, le faible, voire très faible revenu, certains se trouvent poussés vers la délinquance. A cet égard, il faut considérer les effets de ce mix de facteurs sur les taux de suicide et de criminalité.
b) Le gaspillage des intelligences par la dégradation et l’inadaptation du système éducatif depuis le primaire jusqu’au tertiaire, non seulement du point de vue des méthodes pédagogiques, mais aussi du point de vue du contenu et des conditions matérielles. Cela en l’absence d’une veille soutenue sur l’évolution des problématiques actuelles qui aurait mieux préparé les apprenants au monde qui les attend, ainsi que l’absence d’une veille sur les changements de profil des nouvelles générations que le philosophe Edgar Morin a qualifié de «mutants», tellement ils sont différents de leurs aînés.
c) Le gaspillage des intelligences prive le pays des opportunités pour mieux se positionner en matière de production de la connaissance, d’innovation et d’entrepreneuriat technologique. Pourtant, le potentiel est là et en progression Mahmoud Sami Nabi cite dans son livre «Que la Tunisie brille à nouveau» (لتعش تونس من جديد محمود سامي نابي): la Tunisie est classée 46e sur 120 pays en matière de production de la connaissance entre 2011-2014, alors qu’entre 2000-2005 elle était classée 64e.
Ces défaillances minent la gouvernance du capital humain national et appellent à un effort d’analyse et de compréhension la plus approfondie possible. On peut à cette fin recourir à des études scientifiques basées sur un corps de théories et d’enquêtes de terrain. On peut aussi trouver de précieux indicateurs dans la littérature produite par les romanciers, les hommes et femmes de théâtre qui sont de fins observateurs de la société et qui se répartissent sur tout le territoire. Ils décrivent le vécu de jeunes hantés par le désir d’émigration « suicidaire », le vécu de jeunes qui s’activent en marge de la société, les méthodes des « entrepreneurs » de l’émigration clandestine et leurs alliances outre-mer, la corruption tous azimuts qui alimente leur commerce … Des recherches sociologiques dévoilent les perceptions de la société par les jeunes et les moyens qu’ils adoptent soit pour affirmer leur citoyenneté, soit pour se soustraire aux diverses autorités qui brident leur liberté.
A ce propos, j’évoquerai deux exemples puisés dans des écrits tunisiens récents:
J’ai trouvé dans le roman Watan de Azza Filali une illustration réaliste du vécu de jeunes qui se trouvent dans des endroits perdus, particulièrement minés par la pauvreté, le manque de services publics, la corruption en plus d’un contrôle policier très rapproché. Ce sont des jeunes qui n’ont pas le sentiment de vivre leur vie face à des horizons bouchés. La seule ouverture qui reste à leurs yeux est le départ, l’exode vers les grandes villes ou l’émigration à bord des bateaux de la mort.
Une étude publiée récemment par la Revue tunisienne des sciences sociales, analyse les comportements de jeunes lycéens qui s’adonnent au hip hop et se perçoivent comme citoyens du monde. L’auteur, Taoufik Jemai, présente les résultats d’une enquête auprès de ces jeunes des quartiers pauvres de Sfax qui, en guise d’expression identitaire, pratiquent le hip hop. Né dans les quartiers pauvres du Bronx à NY, le hip hop s’est imposé comme expression de contestation d’un ordre social établi. En décryptant les formes et les lieux d’expression de ces jeunes, l’auteur révèle, d’une part, leur effort de fuir la pression qu’exercent sur eux les diverses autorités : celle de la famille, celle du lycée et celle de la police ; d’autre part il montre l’inscription de leurs activités dans un contexte mondialisé et pluriculturel de par :
• La langue (arabe avec parfois des connotations algériennes et marocaines, français, anglais, italien),
• Le rythme (rap à l’américaine, à l’orientale parfois avec une touche qui s’apparente à l’appel à la prière),
• L’expression corporelle (puisant dans des sources américaines, européennes, asiatiques et une touche de la région d’origine du danseur),
• Les accessoires du paraître et la tenue vestimentaire (blue jeans et jogging, kachabia, kamis afghan, casquettes, chapeaux, bérets, bonnets africains, chéchia, mdhalla (chapeau tissé de feuilles de palmier), toque des pays du Golfe ou keffieh palestinien, collier, bague, bracelet …).
A travers la pratique du hip hop, c’est un cri de révolte poussé par ces lycéens sur un fond de mélange hétérogène de cultures. Ce mélange serait impossible sans une attitude de tolérance mêlée d’une volonté de s’exprimer hors des codes qui gouvernent la société. Cela prélude à la genèse d’une culture nourrie d’hétérogénéité et d’hybridation, qui aura sans doute ses effets sur la culture nationale à plus ou moins long terme. Les opprimés qui se révoltent sont des acteurs sociaux qui initient des changements, fussent-ils incrémentaux et imperceptibles dans l’immédiat.
S’adressant aux opprimés, Bhabha écrivait :
«… je pense que vous ne pouvez pas simplement posséder votre propre histoire d’être opprimé ou souffrir. Bien sûr, cette expérience est spécifique. Bien sûr, elle crée son propre langage et son expérience communautaires. Elle crée sa propre capacité de construire une histoire. Mais elle doit être vue en termes relationnaires, d’une histoire d’interactions dynamiques.»(1)
Riadh Zghal
(1) Bhabha, H. K. (1986). “The Other Question: Difference, Discrimination and the Discourse of Colonialism”, In F. Parker, P. Hulme, & M. Iverson (Eds.), Literature, Politics, and Theory: Papers from the Essex Conference 1976–1984. London: Methuen
- Ecrire un commentaire
- Commenter