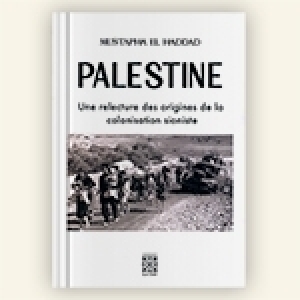Ridha Kéfi *: L’enfance d’Abdelwahhab Najjar
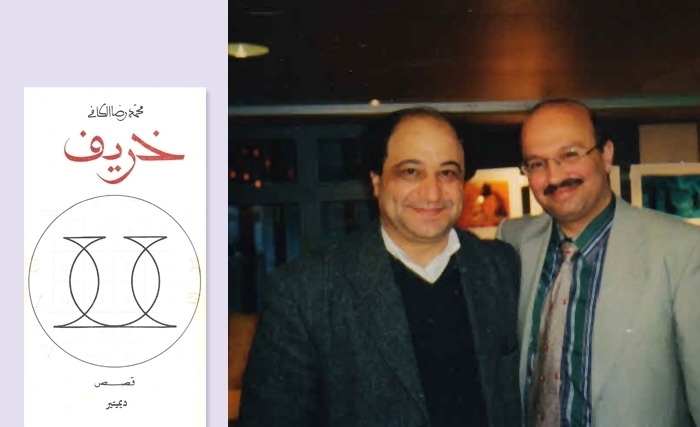
Trad. de l’arabe par Tahar Bekri - Je sais que beaucoup de choses s’effacent de la mémoire, qu’il n’est pas possible à l’homme de retrouver tous les détails de sa vie passée, avec clarté et précision, même si elles sont relatives. Les jours, sont comme la lumière du soleil, arrivent avec des couleurs vives, palissent peu à peu, puis s’évanouissent et il n’en reste qu’un souffle feutré qui annonce la disparition toute proche. Ce dont nous nous souvenons est ce qui pèse lourd comme joie ou tristesse ancrées, ce qui a été gravé par les événements du côté du cœur, ce qui est resté battant avec le sang dans les veines, et qui nous ramène régulièrement à nous-mêmes, chaque fois que nous avons voulu nous en éloigner ou jouer au plaisir dangereux de l’oubli. Ce dont nous nous souvenons le plus, de notre vie passée, n’est pas de moindre importance de ce qui est attaché à notre esprit comme une tache d’encre bleue sur le col d’une chemise propre, mais nos facultés humaines sont incapables de tout enregistrer, plutôt, elles interviennent parfois pour trier les événements, les positions et les sentiments passagers, elles enterrent d’autres dans les obscurités de l’oubli, qui sont celles du désir et de l’inconscient.
J’écris aujourd’hui, -moi- Abdelwahhab Najjar, zoologiste, soixante ans, trois mois et deux jours; 4 Av. de la liberté, 1er étage…Car je sens un besoin insistant pour écrire quelque chose sur ma vie, n’importe quoi qui me prouve que je ne l’ai pas passée comme une série de pages jaunes, similaires et tristes, qu’un peu de lumière se faufile sans que je m’en aperçoive vers le ciel de mon enfance qui n’était pas aussi grise que je l’imaginais, à cause du narcissisme de mon père, son égo démesuré et son indifférence à mon égard et à l’égard de ma mère, atteinte de différentes maladies, envers mon frère Hamed, qui ne quittait la prison le matin que pour y revenir le soir, envers ma sœur Samia, qui ne cessait de pleurer pour elle-même, pour nous et pour tous les misérables…Oui, mon enfance n’était pas aussi misérable, au point que je l’ai imaginée, elle n’était nullement misérable, car j’ai su, tout le long de ces années éloignées que j’ai failli oublier, comment transformer la tristesse qui m’entourait à la maison en une condition de la joie. C’est pourquoi je ressens encore, alors que je suis à cet âge avancé, le cœur de l’enfant que j’étais, battre dans ma poitrine, son sang courir dans mes veines fatiguées, sa grande imagination ouvrant devant moi les portails de la joie secrète. La perplexité me saisit, l’étonnement me submerge, je l’admire et m’admire, avant de me noyer dans la mer de ses images et de me perdre dans les forêts de ses rêves et errer dans le tourbillon de ses visions qui transpirent de légendes et de poésie…
J’écris donc sur mon enfance comme celui que taraude la nostalgie d’une patrie perdue dans la cohue des jours et disparut, et dont il ne reste dans les rides de la mémoire, que des ruines vagues, où dans ses recoins, les hiboux hululent, où les corbeaux planent dans leur ciel, où s’enveloppe la brume de poussière, où une étoile triste brille de sa lumière pâle chétive, derrière des nuages lourds comme des tas de plomb,.. J’écris sur mon enfance, sur une seule page lumineuse du livre de mon enfance, comme celui qui se prépare à un voyage décisif et espère, à son étape ultime, pour révéler aux autres, des balises d’un chemin possible parmi ceux de la forêt vaste et dangereuse…
Quand j’étais enfant, le monde me paraissait étroit et étouffant jusqu’à un point insupportable. Je connaissais tous les pays, je dessinais des cartes, après cartes sans me lasser, je ressentais un grand plaisir en passant mes crayons de couleurs sur des surfaces blanches, en remplissant les vides de lignes, de formes et d’images, tantôt droites, tantôt courbées, penchant à droite ou à gauche, je choisissais les couleurs harmonieuses pour dessiner cette chaîne de montagnes ou ce lac, cette ville industrielle ou ce port, ces forêts tropicales, ces fleuves, ces archipels gelés, ces petites îles parsemées à travers les vagues de l’océan comme des cailloux éparpillés dans les places abandonnées. Entre une ligne et une autre, entre une couleur et une autre, entre une carte et une autre, je levais ma tête du papier, pour savourer une citronnade que ma mère ramenait de la boutique de l’oncle Ali, le vendeur de pâtisseries, mitoyen à notre maison. Je m’interrogeais sur les lignes qui séparaient les pays, qui les a ordonnées, sur quelle logique elles ont été tracées ainsi, peut-on les déplacer un peu, en haut ou en bas, à droite ou à gauche …Jusqu’à me lasser du globe terrestre et ce qu’il contient comme villes et océans, îles et forêts, fleuves et cascades, icebergs flottant, de fermes de coton, de maïs et de figues, de ports de plaisance et d’usines de voitures…
Je me suis mis à dessiner sur le papier de nouvelles cartes pour de nouveaux pays que j’inventais, je leur donnais des noms étranges qui ne manquaient pas de poésie enfantine, j’y voyageais de longues heures, je découvrais ce qu’ils cachaient comme merveilles - des animaux invertébrés aux têtes humaines, des lacs roses aux eaux de miel, leurs rivages des bijoux en or et en argent, des forêts de corail blanc, des villes en verre, habitées par des oiseaux et de petits poissons, leurs rues en velours doux, leurs places en satin, des montagnes, de coquillages et d’émeraude, de turquoise et de pierres précieuses, des bibliothèque gigantesques comme des aéroports dont je remplissais les étagères de livres d’animaux, de plantes, d’oiseaux, de poissons et de petites histoires, des jardins d’orangers et de cognassiers, habités par des tribus de petites filles qui viennent au monde avec les premières pluies d’automne, qui atterrissent comme des papillons sur les branches où elles construisent des maison en papier et passent le reste des saisons à danser et chanter comme si elles fêtaient les mariages du soleil de la lune et du printemps… J’étais à cette époque drogué de lecture de littérature de voyage et dévorais les ouvrages d’Ibn Battuta, Marco Polo, Christophe Colomb, Bartholomée de Las Casas, Hernan Cortes, James Cook, Charles Darwin…
Je ressentais une grande tristesse car le monde était devenu une grande ville et il n’y a plus dans ses recoins ce que l’homme aventurier pourrait découvrir. Je suis resté travailler de longs mois, je ne sortais presque pas de la maison, sauf pour aller à l’école et finalement, j’ai découvert que j’ai réalisé un grand travail : j’ai réalisé à partir du néant un autre monde différent, beau, étendu, vaste, sans limite, plein de surprises, avec les couleurs de l’arc-en-ciel et d’autres couleurs étonnantes, la couleur des sèves, la couleur du crépuscule, la couleur de feu du désir, J’étais heureux de mon travail mais j’ai refusé de le montrer à mon père, de peur qu’il ne se révolte contre moi et dans un coup de colère, que seul Dieu est en mesure de limiter, il déchire ce dont j’ai mis plusieurs heures à réaliser.
Il était capable de ces scènes théâtrales sombres, plutôt même, il les cherchait afin de satisfaire son vil plaisir, oui, j’étais heureux de mon travail, mais je l’ai interrompu et s’il avait été possible de le poursuivre, j’aurais accumulé des milliers de cartes pour des milliers de pays et de villes qui n’existent que sur le papier, les crayons de couleurs et mon imagination effrénée. Cette réalisation enfantine me paraît aujourd’hui l’œuvre la plus importante dans ma longue vie. C’est pourquoi je ressens de la fierté en feuilletant les vieilles pages et fixe les cartes qui ressemblent dans leur surréalisme à l’inconscient des œuvres d’art rares, Je ressens la tristesse des années de l’enfance revenir et je me demande de nouveau: Et si le monde était comme je l’avais dessiné, qu’est-ce qui l’empêche d’être ainsi ? La fatalité de la nature et de l’Histoire, naturellement. Cette réponse rapide sûre d’elle-même ne traversait pas l’esprit du petit enfant que j’étais dans ces années éloignées, où j’ai arrêté l’espace et le temps à mon désir d’enfant, en passant de longs mois, le dos courbé sur les papiers, sur lesquels je dessinais de belles formes à un monde que je voulais plus beau que la beauté.
Je me demandais pourquoi la carte de l’Amérique était allongée, pourquoi ne serait-elle pas triangulaire ou circulaire, pourquoi existait-elle, ne disparait-elle pas une fois pour toute, qu’aurait été le monde si la carte de l’Amérique était circulaire par exemple, comment aurait été t-il s’il n’avait jamais existé. Ces questions me troublaient, je ne leur trouvais pas de réponses, je n’osais pas les poser en classe de peur de provoquer la colère de M. Fontaine qui m’aimait bien et qui insistait sur le fait que la science est une chose et l’art, une autre, que la connaissance et le mythe ne se rencontrent que dans les cerveaux malades, c’est pourquoi je me suis libéré de mon trouble en ordonnant le monde selon mon goût propre et j’ai réussi en cela jusqu’à un certain point, où je ressens aujourd’hui l’impuissance et le découragement, face à ma grande réalisation enfantine, j’espère qu’elle sera mise avec moi dans la tombe, c’est une partie de moi-même, un morceau de ma chair et mon sang, mon enfant dont les conditions de ma vie triste n’ont permis que j’enfante…
Kharif, (Automne), Déméter, 1984.
Trad. de l’arabe par Tahar Bekri
*) Ridha Kéfi né en 1955 à Tunis. Etudes de philosophie. Auteur bilingue. Poète, romancier, essayiste, journaliste A publié de nombreux ouvrages en arabe et en français, depuis 1981.
- Ecrire un commentaire
- Commenter