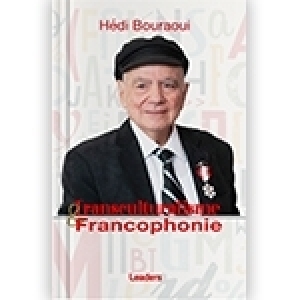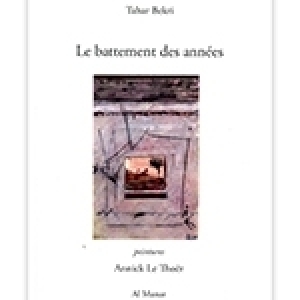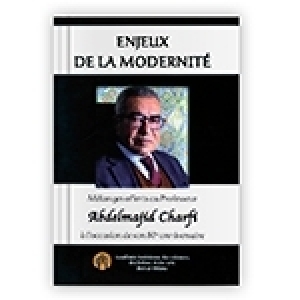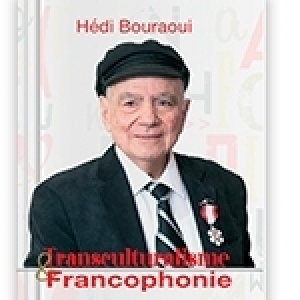La malédiction
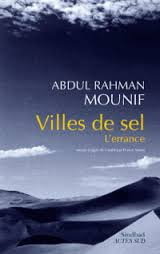 C’est dans Wadi al-Ouyoun, une oasis verdoyante, au milieu d’un immense désert, à l’est de l’Arabie Saoudite, que débute l’action de Villes de sel d’Abdul Rahman Mounif (1933-2004). Elle évoluera par la suite longuement à Harran, une petite bourgade côtière. Cette œuvre, parue en 1984, simultanément à Beyrouth et à Amman, sous le titre original ‘Mudun al-Milh’, vient d’être publiée par les Editions Actes Sud dans une traduction limpide de France Meyer.
C’est dans Wadi al-Ouyoun, une oasis verdoyante, au milieu d’un immense désert, à l’est de l’Arabie Saoudite, que débute l’action de Villes de sel d’Abdul Rahman Mounif (1933-2004). Elle évoluera par la suite longuement à Harran, une petite bourgade côtière. Cette œuvre, parue en 1984, simultanément à Beyrouth et à Amman, sous le titre original ‘Mudun al-Milh’, vient d’être publiée par les Editions Actes Sud dans une traduction limpide de France Meyer.
Le titre et la localisation spatiale de cette œuvre volumineuse— elle totalise 650 pages -- ne sont pas tout à fait anodins. Né et élevé en Jordanie, de parents saoudiens, et d’une grand-mère irakienne, l’auteur sait de quoi il parle. Après des études supérieures de droit à Bagdad, au Caire et à Paris, il s’est installé un temps à Belgrade. Là, à l’université, il côtoie la jeunesse communiste et obtient un doctorat en sciences économiques (option pétrole). Muni de ce diplôme, il retourne de nouveau à Bagdad et intégre le ministère du Pétrole. Mais vite happé par les démons de la politique, il s’inscrit au parti Ba’ath pour se retrouver finalement dans les geôles de Saddam Hussein. Libéré, il s’installe à Damas et commence à écrire des brûlots, dont Villes de sel est l’un des plus percutants. Quatre ouvrages aussi volumineux le suivront pour constituer une longue saga: Al-ukhdud (1985), Taqasim al-layl wa-al-nahar (1989), Al-munbatt (1989) et Badiyat al zulumat (1989). Des écrits au vitriol qui ne tardèrent pas à le porter aux nues dans le monde arabe mais qui lui valurent, comme on le devine, l’ire et la censure des autorités saoudiennes, et la perte de sa nationalité.
En effet, à lire ce beau roman on se rend vite compte que «La malédiction du pétrole» ne date pas de 1973, à la suite de la flambée des prix enregistrés cette année-là, comme on le croit communément. Elle s’est abattue en Arabie Saoudite bien avant, insidieusement, avec d’abord la prospection puis le forage des premiers puits de pétrole.
Pour ceux qui y sont nés et qui l’habitent, le désert a un charme particulier. Il peut incarner l’emblème du monde par excellence tant la vie, au rythme des caravanes qui le sillonnent, y est indolente et tranquille, même si cette vie peut aujourd’hui sembler proche de l’ascèse. Mut’ib al-Hadhal est l’un de ces habitants du désert, un bédouin respecté et influent de Wadi al-Ouyoun qui, seul, s’insurge contre la destruction systématique de l’oasis par les Américains à la recherche du pétrole. Lorsque, avec la bénédiction et le ferme soutien des autorités locales, les premiers signes du forage résonnèrent dans la paisible oasis, semant l’effroi dans les cœurs des habitants, Mut’ib prit sa chamelle et son fusil et disparut, laissant derrière lui femme et enfants, mais créant du coup le mythe de la résistance:
«Les oasiens étaient persuadés que Mut’ib n’abandonnerait pas le ‘wadi’- il n’était pas de ceux qui pouvaient faire leur balluchon et s’en aller. S’il s’était jeté dans le désert, furieux et farouche, comme son père et son grand-père avant lui, c’était pour suivre leur exemple. Ils avaient été les plus féroces ennemis des Turcs. Ils ne dormaient jamais deux fois au même endroit, et avaient transformé la route des Sultans en un véritable enfer…» (p.118)
Et effectivement, Mut’ib fut aperçu quelque temps plus tard, par ses deux fils, d’abord par Sha’lan, aux abords du campement américain, puis par Fawaz, un jour d’orage, en train de haranguer les habitants de Mashta, une oasis voisine de Wadi al-Ouyoun. Il n’empêche cependant que les Américains finirent par détruire l’oasis et chasser tous ses habitants. Laissant Sha’lan derrière elle, à Wadi al-Ouyoun, la famille de Mut’ib plia alors bagage et partit chercher refuge chez des parents à Al Hadra, une autre oasis. Désoeuvrés, Fawaz et son cousin Swaylih décident de retourner à Wadi al-Ouyoun dans l’espoir de travailler avec les Américains, comme Sha’lan, mais en chemin, ils rencontrent al-Rashid, le chef de leur tribu, qui les emmène à Harran, pour travailler avec les Américains :
«Après avoir passé quelques jours à Oujra et une fois qu’Ibn al-Rashid eut réuni les hommes dont il avait besoin, ils repartirent ensemble vers Harran, ce lieu étranger dont peu avaient entendu parler et où aucun d’entre eux n’était allé. Ils s’arrêtèrent plusieurs fois en chemin… et cinq jours plus tard, ils découvrirent la mer. Ils se figèrent et ouvrirent grands leurs yeux, ébahis, incrédules: de l’eau… à l’infini… de l’eau à perte de vue … C’était la mer! La mer, aussi vaste et étendue que le désert !» (pp.189-90)
La suite du roman est consacrée entièrement au rapide développement de ce petit port sur fond d’un puissant sentiment de frustration aussi bien des habitants que des ouvriers. En un clin d’œil, deux cités finirent par jaillir et s’étaler dans le désert, côte à côte, Harran l’américaine et Harran l’arabe. Deux microcosmes différents et un choc des civilisations des plus frappants, qui seraient en fin de compte décrits avec humour et dérision sans la vie de plus en plus pénible des ouvriers et la mort accidentelle, en mer, de l’un d’entre eux, aux conséquences funestes:
«Ce fut un jour noir et sinistre que celui où on ramena son cadavre à terre. La nouvelle se répandit rapidement, du campement des ouvriers à la Harran américaine et à la Harran arabe. Ce même après-midi, on l’enterra dans le chagrin et la colère. Pas un homme qui ne participât aux funérailles et ne partageât le chagrin des autres…». (p.309)
Et tout au long du livre, derrière cette nouvelle forme de colonisation, qui n’est pas sans rappeler certaines oeuvres célèbres comme celles de Faulkner en Amérique et de Chinua Achebe en Afrique, ce déni des valeurs ancestrales, la souffrance, le déchirement identitaire, enfin derrière ce désir de résistance, se profile la vraie tragédie de ces bédouins, la perte de leur terre et, partant, la perte de l’épanouissement humain, une vie frappée par la malédiction, constamment en porte-à-faux, toujours sur la corde raide.
Tissant sans discontinuer des détails révélateurs, l’auteur met à nu, peu à peu, les états d’âme et les ressorts du comportement humain et si, parfois, la surprise des personnages devant les objets insolites comme la voiture, le téléphone ou encore la radio, tourne bien vite à la réprobation et à l’indignation, à aucun moment Mounif ne verse dans la banalité. Les valeurs sacrées, comme l’attachement à la terre et à la tradition, ne basculent jamais dans la démystification. Au contraire, en contraste avec les nouveaux symboles de la modernité, les avidités, les désillusions et les renoncements suscités par cette manne du pétrole, elles constituent la référence suprême.
D’où ce souci de la vérité historique qui court en filigrane et qui impose forcément des servitudes et des stéréotypes, mais aussi ce ressentiment légitime éprouvé par l’auteur contre la société, résultant probablement de sa propre expérience dans les champs pétrolifères.
Rafik Darragi
- Ecrire un commentaire
- Commenter