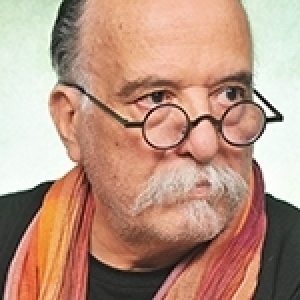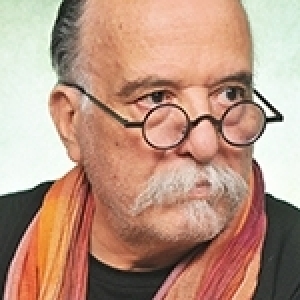La microphysique du pouvoir : l’historien tunisien et la politique

À la mémoire du Professeur Claude Lepelley (1934-2015)
À quoi pensent les historiens tunisiens, aujourd’hui ? Comment, sous la pesée d’une société en train de se faire et de se défaire, ont-ils renégocié leurs approches du fait politique ? Et qu'est-ce qui motive l’historien tunisien lorsqu'il agit sur l’Agora ? Voilà les questions qui méritent d’être posées à l’heure où le duo « mémoire-histoire » s’impose presque dans tous les débats politiques qui circulent sur le forum publique. Depuis la chute de l’Ancien Régime en 2011, certains historiens tunisiens commencent à s’attacher au contenu conceptuel des débats et des conflits sur la nature de la souveraineté ; d’autres aux normes juridiques qui les encadrent ; d’autre enfin à la genèse de l’État tunisien. L’importance de hâter le retour de la réflexion historique au politique peut même conduire les meilleurs esprits à se rallier aux structures les plus contestables d’une histoire réglée par l’événementiel du jeu politique. Faut-il donc confondre l’histoire de la politique tunisienne avec l’histoire l’État tunisien ? Nul ne songerait à sous estimer le rôle de l’État dans le destin de la société et la structuration des habitudes collectives. Mais jusqu’à quel point ? L’une des tâches des nouvelles recherches sur la genèse de l’État tunisien est justement d’évaluer son emprise et de faire ressortir l’évolution de sa capacité à agir sur la société. Quelle que soit cette emprise, la sphère de l’État ne peut espérer absorber complètement la sphère du politique qui a été, pendant longtemps, délaissé par les historiens, du moins pendant les 20 dernières années. Ainsi, les hésitations du vocabulaire, « le » ou « la » politique, traduisent un inconfort intellectuel permanent au regard de la spécificité et de la complexité des phénomènes qui sont réputés « politiques ».
Le danger, en effet, est de fixer une essence ou une substance du politique, alors que ce terme ne devrait servir à spécifier qu’un aspect de la vie sociale, construit, comme tous les autres aspects, par l’interaction des acteurs et des facteurs qui constituent la société tunisienne. Mais que désigner sous cet « aspect » ? Des formes et des fonctionnements institutionnels aussi bien que des activités des acteurs sociaux qui touchent à l’être ensemble en même temps qu’à la défense et à la promotion d’intérêts non représentatifs de cet ensemble, des régulations symboliques et normatives aussi bien que des institutions et de l’action sociale, du discours en tant que paroles qui sont des actes autant que de la réflexion sur l’action et de la programmation de l’action. Bref, nous ne sommes pas loin de la mise en forme, de la mise en scène et de la mise en mot du social qu’un Abdelmajid Témimi déchiffre non dans quelque réalité métaphysique du politique, mais dans la politique telle qu’elle s’invente au quotidien, à condition de relier ce quotidien à une trajectoire historique qui en fait apparaître les régularités en même temps que les aléas et les aspérités. Néanmoins, cette manière d’envisager le politique conduit à un paradoxe, car si les acteurs du politique veulent faire de leur sphère d’action le domaine par excellence de l’action réfléchie et/ou voulue, cette réflexivité et cette volonté n’échappent pas aux régularités sous-jacentes qui structurent la société tunisienne et qui peuvent échapper à la conscience des acteurs individuels, fussent-ils ceux du politique.
Le politique en Tunisie, comme beaucoup d’autres pays arabes d’ailleurs, n’est pas une science, même lorsqu’il prétend s’appuyer sur une science politique qui, de son côté, apprend à le considérer non pas comme une chose, mais comme un ensemble de relations. Il y a des lois du politique et des trajectoires historiques du politique différentes de ce que veulent et pensent ses acteurs ; en dépit du caractère spécifique des effets de pouvoir et de l’action collective sous l’emprise de ces effets, cet écart ne suffit pas à poser pour le politique un être plus caché ou transcendant que ce ne serait le cas de la société en général et de ses autres formes ou domaines d’activité sous le regard des historiens. Sans doute cette manière de poser la question renvoie t elle à une prise de position dans un débat inhérent aux sciences de l’homme et de la société. Le fait de « faire société » comporte t il une part d’impensé, de non voulu ? Le développement historique de la Tunisie postrévolutionnaire résorbe t il cette part ? Depuis plus de trois ans maintenant, le discours savant qui porte sur le politique, mais aussi sur l’économique ou le social, s’est référé à cet axiome selon lequel le politique est apparu comme l’activité organisée grâce à laquelle les tunisiennes et les tunisiens pouvaient non seulement s’organiser sans arbitraire ni injustice, mais résorber par là même la part obscure de leur être collectif en lui imprimant un sens déterminé par la collectivité elle même. C’est là sans doute que réside l’unité profonde du politique et sa différence avec les autres activités humaines productrices de sens, même lorsque la prétention postrévolutionnaire du politique à épuiser le sens de l’histoire. Mais cette approche ne saurait, de toute évidence, épuiser la question du rapport du l’historien à la politique. Elle est en elle-même un objet d’étude pour l’historien des mentalités.
Mohamed Arbi Nsiri
(Doctorant)
- Ecrire un commentaire
- Commenter