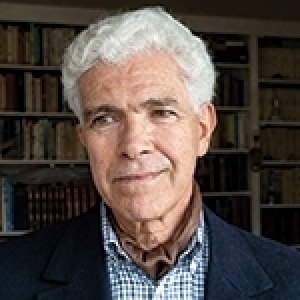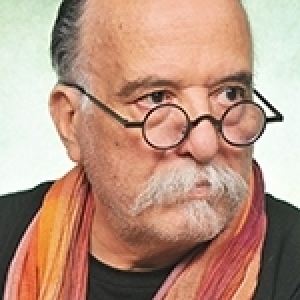L’ambassadeur Béchir Hantous: comment j'ai vécu la guerre du Golfe - Vidéo

Béchir Hantous fait partie de cette génération de diplomates tunisiens qui a eu la chance d’avoir été formée à bonne école, celle de Mongi Slim, Taïeb Sahbani, Taïeb Slim, Mohamed Masmoudi, qui avait donné tout son éclat à la diplomatie tunisienne. Etudiant, il avait fréquenté dans les années 57-58 l’université du Caire où il avait entamé des études de journalisme. En raison des relations tendues entre l’Egypte et la Tunisie et le retrait de notre pays de la Ligue arabe, il a dû quitter Le Caire pour Beyrouth où il s’est inscrit à l’Université américaine de Beyrouth dans la section sciences politiques et finance. Il décrochera sa licence en1963.
Le hasard a voulu que le fondateur et P.D.G. de la STB, Abdelaziz Mathari, se soit trouvé à la même période à Beyrouth pour préparer l’ouverture d’une agence dans la capitale libanaise qui était la principale place financière du Moyen-Orient. Ayant appris qu’un Tunisien venait de décrocher un diplôme supérieur en finance à Beyrouth, il le contacte aussitôt. Tunisien, issu d’une université prestigieuse, trilingue et connaissant bien le pays pour y avoir séjourné pendant quatre ans: c’était le profil recherché par Abdelaziz Mathari. Béchir Hantous se voit offrir, illico presto, le poste de directeur de l’agence.
Il se trouve qu’au même moment, le ministère tunisien des Affaires étrangères recrutait des diplomates (c’était l’époque où les diplômés du supérieur étaient littéralement happés par le marché de l’emploi dès leur sortie). Notre futur ambassadeur, qui était très politisé comme tous les jeunes de sa génération, ne fut pas long à se décider. Il sera diplomate. Quelques mois à peine après son recrutement, il est nommé à Stockholm, puis à Washington, Jeddah et Rabat.
En août 1988, la fin de la guerre irano-irakienne coïncidera avec son arrivée à Bagdad où il vient d’être nommé ambassadeur. Sa première impression: «J’ai été frappé par l’ampleur des destructions. Immeubles éventrés, ponts détruits. Mais je me suis dit qu’avec la manne pétrolière, le pays se relèverait. Seulement voilà, le pays était exsangue. Surendetté, il n’avait pas les moyens de se redresser d’autant plus que le prix du brut était au plus bas. Pour Saddam, le responsable, c’était le Koweït, l’allié d’hier. Il n’aurait pas respecté les quotas établis par l’Opep. Il ne décolérait pas contre le petit émirat d’autant plus que ce dernier voulait recouvrer ses créances vis-à-vis de l’Irak. Dans ses discours, il critiquait vivement les Koweïtiens qui auraient tout manigancé pour imposer leur paix dans la région. Recevant le 25 juillet 1990 l’ambassadrice des Etats-Unis, April Glaspie, il s’est plaint de l’attitude du Koweït qu’il considérait comme un casus belli. La diplomate américaine se contentera de répondre que son pays n’avait aucune idée sur la question, mais qu’il n’y avait non plus aucun traité de défense commune entre son pays et le Koweït».

Le lendemain, il rencontre la diplomate américaine. il lui demande si elle était satisfaite de son entrevue. Elle la résume en une phrase: «All I want is peace». C’est la phrase qui est revenue dans la bouche de Saddam comme un leitmotiv pendant l’entrevue. Rappelée par son pays pour consultations, elle quittera l’Irak deux jours après pour ne plus y revenir. Le 2 août, il apprend avec stupeur que l’armée irakienne a envahi le Koweït sans rencontrer la moindre résistance. « ma première pensée a été pour notre petite colonie au Koweït. C’était pour la plupart des cadres et des enseignants recrutés dans le cadre de la coopération technique, note Béchir Hantous. Quelques-uns, pressentant le danger, ont pu quitter l’Emirat par le premier avion, d’autres ont été exfiltrés par nos soins puis dirigés vers la Jordanie où ils ont été pris en charge par notre ambassade à Amman»
Pourquoi cette invasion a-t-elle pris de court tout le monde, y compris les ambassadeurs en poste à Bagdad et les pays étrangers alors que Saddam avait multiplié les menaces à l’adresse du Koweït et massé des troupes sur les frontières avec ce pays?
Tout simplement parce que personne ne croyait que le président irakien allait passer à l’action. On pensait que le temps était révolu où on pouvait rayer de la carte un Etat. C’était un acte suicidaire.
Il y a eu beaucoup de missions de médiation. Pourquoi ont-elles toutes échoué?
Saddam cherchait une sortie honorable. On ne lui en a pas donné l’occasion. Rappelez-vous la rencontre entre James Baker et Tarek Aziz à Genève. Ils commençaient à discuter lorsque le secrétaire d’Etat américain sortit de sa poche un document et le tendit à son interlocuteur: «Signez au bas de la page. Vous n’avez pas d’alternative». Ce que les Américains demandaient: une soumission à leurs conditions. Tarek Aziz a bien sûr refusé.
Le soutien de Ben Ali à Saddam dans cette crise a beaucoup surpris. Comment l’expliquez-vous?
Je crois que Ben Ali vouait une grande admiration à Saddam. Il l’a soutenu pendant cette crise. Je ne sais pas si la présence à ses côtés d’un homme comme Habib Boularès, dont on connaît les sentiments proarabes, y était pour quelque chose.
Dès le début de la crise, il a nommé Boularès aux Affaires étrangères à la place d’Ismaïl Khélil, beaucoup plus réservé à l’égard du président irakien et qui n’appréciait pas du tout l’alignement de la Tunisie sur l’Irak dans cette crise.
Vous avez vécu l’offensive de la coalition internationale. Comment expliquez-vous la débâcle rapide de ce qu’on appelait la cinquième armée du monde?
C’est ce que les Américains voulaient faire accroire. L’armée irakienne était épuisée par les huit ans de guerre avec l’Iran. Et puis, il y avait en face toute la puissance de feu de l’armée américaine et l’appui d’une trentaine de pays.
Comment jugez-vous Saddam Hussein?
C’était un dictateur doublé d’un mégalomane. Après la guerre irako-iranienne, il ambitionnait de devenir un nouveau Nasser. Il nourrissait également de grandes ambitions pour son pays dont il voulait faire une puissance régionale. Ce n’était l’avis ni des pays du Golfe, ni des Etats-Unis. Avec le recul, on doit reprocher à ces pays leur manque de clairvoyance. Choisir la guerre, c’était ouvrir la boîte de Pandore, c’était se priver d’un contrepoids face à la puissance montante de l’Iran. On le constate aujourd’hui.
Lire aussi
2 août 1990 Invasion du Koweït, Le déclencheur?
Chedli Klibi: Saddam sous l’emprise d’une logique d’un autre âge
L’ambassadeur Ahmed Ounaïes: J’étais à Moscou
L’ambassadeur Habib Kaabachi: L’invasion du Koweït...les prémices de la catastrophe
.jpg)
- Ecrire un commentaire
- Commenter

"C’était un acte suicidaire." : cette phrase suffit à qualifier Saddam, que de trop nombreux ilotes persistent à considérer comme un héros irakien, le héraut de la liberté et de la bravoure du monde arabe ! Un acte suicidaire pour lui, pour son pays, ce valeureux Irak qui ne se relèvera pas de sitôt de cet acte, et pour l'ensemble du monde arabe, qui 'en finit pas d'en payer le prix !!!