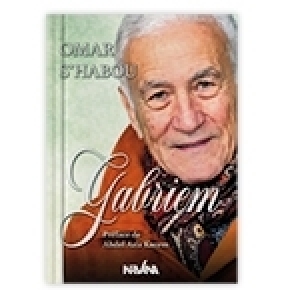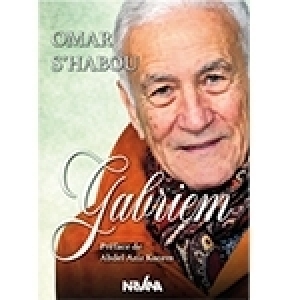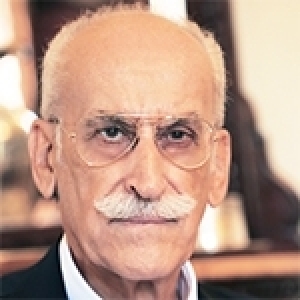Survivance du latin et de la culture antique au Maghreb

La latinité du Maghreb a été, certes, éradiquée ; mais, à l’évidence, elle n’a pu disparaître de façon subite. Elle n’a pu disparaître, non plus, sans laisser quelques traces. En Europe, dans les provinces latines de la rive opposée, on a pu suivre les évolutions décisives que le latin avait subies entre le VIIIe et le XIe siècle. Des textes, qui avaient enregistré ces évolutions, ont permis de retracer, plus ou moins partiellement, le processus de formation des diverses langues romanes, à l’instar du document célèbre des Serments de Strasbourg, prononcés en 842 et ponctuant une étape importante dans la construction, au nord de la France, de la langue d’oïl. Malheureusement, on n’a découvert jusqu’ici au Maghreb aucun document de ce genre, aucun écrit révélateur daté des trois premiers siècles qui ont suivi les premières incursions arabes, entre le milieu du VIIe et le milieu Xe siècle.
.jpg) Comme on n’a pu cesser, pendant ces siècles, de graver en latin ne serait-ce que des épitaphes, on peut conjecturer que cette lacune est peut-être due au hasard des découvertes, comme l’avait déjà suggéré S. Lancel ; d’autant que dans nombre de sites archéologiques, les fouilleurs de l’époque coloniale s’étaient longtemps intéressés presque exclusivement aux niveaux qui documentent l’époque romaine, dédaignant ou même détruisant, pour y accéder, les niveaux supérieurs correspondants à l’antiquité tardive et au Haut Moyen Age.
Comme on n’a pu cesser, pendant ces siècles, de graver en latin ne serait-ce que des épitaphes, on peut conjecturer que cette lacune est peut-être due au hasard des découvertes, comme l’avait déjà suggéré S. Lancel ; d’autant que dans nombre de sites archéologiques, les fouilleurs de l’époque coloniale s’étaient longtemps intéressés presque exclusivement aux niveaux qui documentent l’époque romaine, dédaignant ou même détruisant, pour y accéder, les niveaux supérieurs correspondants à l’antiquité tardive et au Haut Moyen Age.
On sait, cependant, qu’au moins jusqu’au milieu du VIIIe siècle, on continua dans l’Ifriqiya arabe de frapper des monnaies à légendes latines. Et on sait aussi que des historiens et chroniqueurs arabes, al-Bakri, al-Mâliki et al-Idrîsi en particulier, ont projeté quelques lueurs sur ces siècles de transition et, sans doute, de coexistence entre deux cultures. Jusqu’aux XIe et XIIe siècles, attestent-ils, des communautés chrétiennes continuaient à vivre normalement dans plusieurs villes du Sud, à Tripoli, Gabès, Gafsa, Tozeur et dans toute la région du Jérid actuel, ainsi qu’en Algérie à Tlemcen, Tiaret et la Qala’a des Beni Hammad. Ils disposaient, dans ces villes, d’une organisation religieuse particulière toujours active. Des lettres du pape Grégoire VII, datées entre 1073 et 1076, indiquent qu’il y avait encore, à son époque, des évêques à Carthage et à Bougie. Auparavant sous Léon IX, en 1053, l’évêque de Gummi (identifié, semble-t-il à Mahdîya), avait disputé la primauté à celui de Carthage, se prévalant sans doute de la promotion de Mahdîya, sous les Fatimides, au rang de capitale.
A cette date, le Maghreb comptait encore cinq évêchés sur la quarantaine qui, au VIIIe siècle, avaient survécu à la fin de l’époque byzantine. Nombreuses étaient aussi les communautés sans évêques, quatre siècles après la conquête arabe. Les descendants des Romano-Africains qui les constituaient étaient appelés les Afarik et vivaient dans les grandes villes. D’après al-Idrîsî, Gabès avait même la réputation d’être «la ville des Afarik», dont beaucoup peuplaient également la région du Jérid, la Kastilia des textes arabes, c’est-à-dire la région des «châteaux», qui rappelle sans doute des castella, nombreux au sud-ouest de la province à l’époque romaine. On ne dispose malheureusement pas d’indications sur la langue que parlaient tous les jours les membres de ces communautés. Seul al-Idrîsi, qui avait passé au XIIe siècle de longues années à la cour de Roger II de Sicile et y avait donc connu des parlers romans, appelle cette langue parlée des chrétiens, à Gafsa en particulier, al-latinial ifrîki (le latin africain). Ce «latin africain» de tous les jours était sans doute différent du latin d’église, formellement correct, des épitaphes chrétiennes gravées par des lettrés et découvertes en Tunisie et en Tripolitaine. Un premier texte avait été exhumé à Kairouan en 1928. Publié à cette date par Ch. Saumagne1, W. Seston en avait repris la publication en 1936, en incluant celle d’un fragment d’inscription provenant probablement du même endroit2. Pour que la date qu’il avait cru lire sur la pierre concorde avec celle de l’indiction, mentionnée également, il avait eu recours pour dater l’inscription à l’ère mondiale d’Alexandrie. En 1961, nous avions nous-même recueilli et publié un nouveau texte3, sorti fortuitement d’un puits creusé au même endroit. Grâce à une datation double, dionysienne et hégirienne, ainsi qu’une concordance parfaite avec l’indiction, ce texte daté de 1007 nous avait permis d’apporter corrections et compléments à la publication des deux inscriptions précédentes. Nous avions pu établir que la datation couramment utilisée par la communauté chrétienne, qui vivait au XIe siècle à Kairouan, n’était point celle d’un comput oriental alexandrin de l’ère chrétienne, mais bien celle du comput chrétien usuel, fixé au début du VIe siècle par Denys le Petit. D’autant que cette date dionysienne était corroborée par sa concordance avec l’année hégirienne, librement et licitement désignée dans la communauté des chrétiens de la capitale musulmane par l’expression annorum infidelium (datation des infidèles). Nous avons pu donc établir que des deux textes complets exhumés jusqu’ici à Kairouan, l’un est daté avec certitude et sans difficulté de l’année 1007 et l’autre probablement de l’année 1019. Quant au fragment d’épitaphe, provenant du même endroit, nous avions réussi à le dater de l’année 1046, qui correspond à l’année hégirienne 438, tout en le complétant et en corrigeant la première lecture.
Une fouille systématique aurait peut-être permis de dégager à Kairouan, au moment de la découverte des premières inscriptions, un ensemble cultuel chrétien, comme l’indique la mention d’un lector dans l’une des épitaphes, même si l’institution épiscopale n’est pas attestée. Mais en 1961, ces vestiges étaient enfouis sous les bâtiments d’une propriété privée, à sept mètres de profondeur. A Aïn Zara et En-Ngila, par contre, en Tripolitaine, on avait pu fouiller en 1927 des aires cimetériales comprenant plusieurs tombes dont les épitaphes, gravées ou peintes sur des caissons semi-cylindriques, s’échelonnent entre 945 et 1021 de l’ère chrétienne. Comme à Kairouan, la mention à En-Ngila d’un abba, qui était sans doute le chef de la communauté, montre l’existence d’une organisation religieuse toujours active. Tant en Tunisie qu’en Tripolitaine, ces épitaphes indiquent qu’à l’image des communautés mozarabes de l’Espagne, des communautés chrétiennes, urbaine à Kairouan et rurale à Ain Zara et En-Ngila, vivaient toujours au XIe siècle selon leurs traditions ; avec sans doute une organisation civile propre - comme le suggère la mention d’un senior (donc d’une magistrature) dans l’un des textes de Kairouan et
d’un iudex (d’un juge) à En-Ngila - et peut- être même une certaine autonomie La datation, par les anni domini de l’ère dionysienne à Kairouan et en Tripolitaine, en concordance avec les anni infidelium de l’ère hégirienne ajoutés dans l’inscription de Kairouan, implique pour la communauté chrétienne de la capitale musulmane une condition qui dépasse le cadre de la coexistence et renvoie à la bienveillance des souverains à l’égard de leurs sujets chrétiens, comme l’avaient indiqué d’ailleurs nombre d’auteurs arabes, qui avaient noté l’influence considérable de certains chrétiens à la cour des Fatimides.

Indépendamment de ce « latin d’église », on a aussi relevé quelques survivances du langage courant des Afarik dans l’ensemble des pays musulmans du Maghreb. Il ne s’agit cependant que d’allusions incidentes à des noms de lieux ou de personnes dans des textes de géographes et de chroniqueurs arabes. On dispose, de même, du témoignage persistant de la toponymie actuelle et du souvenir de mots latins ou protoromans que les dialectes berbères et l’arabe dialectal maghrébin continuent de véhiculer4. A titre d’exemple, rappelons que le nom de la Mitidja dérive, semble-t-il, de celui de Matidia4, la nièce de l’Empereur Trajan, par l’intermédiaire d’un Matidja, cité par al-Bakrî. Le même auteur, ainsi qu’al-Idrîsi, signale Medjana, un lieu-dit qui rappelle le toponyme latin Medianae (ou Medianum). L’héritage toponymique proprement latin est à vrai dire assez rare, car l’usage immémorial des noms de lieux libyco-berbères avait déjà résisté à la diffusion de la langue punique et avait aussi résisté par la suite à la romanisation de la province africaine. Quelques toponymes latins avaient cependant fini par s’imposer, comme le lieu-dit actuel de Fossato, dans le Jebel Nefoussa, qui garde le souvenir du Fossatum, dans le territoire militaire du limes romain ; ou l’appellation actuelle de K’frida, en souvenir du centenarium d’Aqua Frigida, ou encore la dénomination de Hergla qui rappelle, après une série de déformations, les Horrea Caelia de l’époque romaine (les silos à grains appartenant à la famille Caelia). Le toponyme actuel de Zana, déformation de Diana, et celui de Henchir Balliš, dérivé de Vallis, la ville romano-africaine qui en occupait le site, sont aussi d’origine latine; alors que le toponyme de Monastir, issu du vocabulaire chrétien, est très proche du catalan monastiri, de l’italien monastero et de l’espagnol monasterio, sans compter bien entendu le français «monastère». Dans ce cas, la graphie des textes arabes paraît reproduire fidèlement le latin africain, que le dialecte tunisien a, par la suite, altéré avec la dénomination actuelle de Mistîr.
Mais, de façon générale, la romanisation n’avait fait que «latiniser» les toponymes de la province africaine qui étaient, dans une très large mesure, d’origine libyco-berbère et, à un moindre degré, d’ascendance punique. A leur tour, les dialectes maghrébins n’avaient fait que les « arabiser ». Ainsi, en est-il, par exemple, pour Tûnis (Tunes), Haîdra (Ammaedara) et Oudhna (Uthina) dans le nord, Kesra, (Chusira), Ksar Lemsa (Limisa) et Henchir Meded (Mididi) dans le centre et Nefta (Nepte), Tozeur (Tusuros) et Zarzis (Gergis), dans le sud. Pour les villes portuaires d’origine punique, citons, à titre d’exemple, Benzart (dont le toponyme punique, devenu Hippo Diarrhytus à l’époque romaine, a été encore transformé à l’époque byzantine en Ippone Zarito), Carthage (Kart Hadacht à l’époque punique, puis Karthago à l’époque romaine) et les deux Leptis, magna et minor, devenues Lebda en Tripolitaine et Lamta dans le Sahel tunisien. Le nom même du Boukornine, la montagne omniprésente dans le paysage de Tunis, constitue une survivance du passé préromain; car cette dénomination, qui n’est pas arabe, conserve le souvenir de l’ancien temple du grand dieu carthaginois de l’Afrique romaine, Saturnus Balcaranensis, qui couronnait la crête. Parmi les mots latins véhiculés par les parlers maghrébins, ce sont naturellement les vocabulaires agraires et ceux du monde rural qui occupent une large place. On sait par exemple que le calendrier agraire, toujours en usage dans les campagnes du Maghreb, avait hérité de l’époque romaine, avec des variantes plus ou moins nombreuses, les mois du calendrier julien qui, contrairement aux mois lunaires de l’ère hégirienne, indiquent des repères stables pour les travaux des champs. Dans les campagnes tunisiennes, les paysans conservent encore le souvenir des mois de Yunnar (januarius mensis), Furar (fabruarius), Mars, Ybrir (aprilis), Maiou (maius), Yuniou (junius), Yuliz (julius), Aghusht ou Awûssou (augustus), Shtamber (september), Ktûber (october), Wamber (november ou novembris) et Djamber (december). Mais beaucoup plus que dans les dialectes arabes, c’est surtout dans le langage berbère qu’on a recueilli un certain nombre de mots d’origine latine. A l’exemple de la dénomination de l’âne par « asnus » (latin asinus), de l’oiseau de proie par « afalku » (latin falco), ainsi que la désignation du jardin par «urtu», qui dérive de hortus, et celle de l’orme par «ulmu» qui provient de ulmus. On doit cependant reconnaître, avec S. Lancel, que «ce que l’on peut appréhender ce sont au mieux des mots isolés, pris dans la gangue d’un autre langage, qui n’a pas manqué de les altérer en les fossilisant».5

Mais le monde antique ne survit pas seulement dans ces mots isolés du langage actuel, ou dans les toponymes et le calendrier agraire. Nombre de traditions, de coutumes et de techniques en conservent encore l’empreinte. Dans un passé récent, celle-ci était encore nette dans le drapé généralisé des villageoises et paysannes du Sahel et du Sud tunisiens qu’on appelle el mélia. Elle était constituée, comme à l’époque romaine, d’une pièce d’étoffe de couleur vive, avec une dominante de bleus, de rouges et, dans une moindre mesure, de jaunes et de verts. On en agrafait les deux pans sur la poitrine, au bas des épaules, à l’aide de deux fibules d’argent, les khlels. Une ceinture de laine, serrée à la taille, faisait blouser le drapé sur le buste. Un autre vêtement, masculin cette fois et caractéristique du costume maghrébin, pourrait être lui aussi d’origine antique, vraisemblablement romaine. Il s’agit du «burnous » dont le nom pourrait dériver du latin birrus ou burrhus, sorte de pèlerine munie d’un capuchon, qui ressemble effectivement au burnous. Dans un autre domaine, celui de l’architecture, et parmi les techniques du bâtiment léguées par l’antiquité, la plus remarquable est sans doute cette maçonnerie qualifiée à l’époque romaine d’opus africanum. Elle est caractérisée par des chaînages verticaux de pierres de taille, qui soutiennent et renforcent les assises de moellons, à l’instar des poutres bétonnées des constructions modernes. Généralisée dans les édifices de la province romaine, elle était cependant antérieure à cette époque, puisque déjà présente dans la cité punique de Kerkouane. Après la conquête arabe, elle était restée longtemps en usage, comme en témoignent encore, par exemple, les murailles du ribat de Monastir, construites et restaurées à plusieurs reprises aux VIIIe et IXe siècles, depuis les débuts du pouvoir arabe jusqu’à l’époque de l’émirat aghlabide.
On a aussi constaté que dans les régions où la pierre est rare, comme Thysdrus (El Jem) ou Acholla (Henchir Botria), au nord de Sfax, des maisons pourtant ornées d’un décor de mosaïques des plus somptueux, avaient des murs construits en briques crues, sur une base de maçonnerie: cette technique, elle aussi, était de tradition punique ; de même que le système de mesure en usage dans beaucoup de monuments de la province romaine. En effet, les ouvriers qui travaillaient à l’époque romaine dans les carrières, découvertes pour la plupart et mises en exploitation au temps de la Carthage punique, continuaient à tailler les blocs de pierre selon le système de mesure de la coudée phénicienne de 0.52m ; si bien que cet étalon, qui était souvent utilisé dans les constructions d’époque impériale concurremment avec le pied romain de 0.296m, n’a cessé de l’être encore à l’époque contemporaine, notamment dans les campagnes, où la coudée () concurrença longtemps le système métrique.
Ajoutons enfin dans l’architecture domestique une dernière tradition orientale, qui a connu une longévité exceptionnelle. Depuis l’époque punique, en effet, la maison s’ordonne au Maghreb autour d’une cour intérieure. A Kerkouane, aucune demeure ou presque ne déroge à cette règle, alors que la maison dite « aux colonnes » présente une cour cernée par la colonnade d’un portique, selon un modèle répandu dans le bassin oriental de la Méditerranée à l’époque hellénistique. La conquête romaine ne fit que renforcer les liens du pays avec cette civilisation commune aux deux rives, que Carthage avait largement accueillie. Ce modèle architectural a, depuis, traversé les âges et sa présence, renouvelée des siècles durant, n’a amorcé un repli décisif qu’à partir de la fin des années cinquante du siècle dernier, devant la progression dans les nouveaux quartiers des villes tunisiennes d’un habitat d’immeubles et de villas particulières, qui était réservé à l’époque coloniale aux quartiers des résidents d’origine européenne.
La latinité et ses survivances, c’est bien le titre de cet article ; oui mais une latinité particulière, pleinement acquise un temps donné, mais persistante seulement par quelques rémanences, dans un pays dont la personnalité culturelle était déjà faite. Une personnalité qui s’était dotée, avant sa romanisation, d’une langue et d’une civilisation marquées d’une empreinte orientale indélébile. Une personnalité dont la conquête arabe, en rattachant le pays à l’empire méditerranéen le plus avancé de l’époque médiévale, avait scellé le sort, lui traçant dès lors une voie distincte de celle des autres provinces latines.
Ammar Mahjoubi
Professeur émérite,
Université de Tunis
2-W. Seston, Sur les derniers temps du christianisme en Afrique, dans les Mélanges de l’Ecole Française de Rome, (M.E.F.R), L III, 1936, p 689-713.
5-S. Lancel, La fin et la survie de la latinité en Afrique du Nord. Etat des questions, Revue des Etudes Latines, LIX, 1981,p 297.
- Ecrire un commentaire
- Commenter