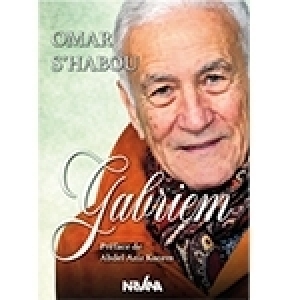L’économisme, le solutionnisme technologique et la pensée en silo cadenassent les réflexions sur la transition

Par Pr Samir Allal
Symptôme d’une pensée verrouillée
Cet article propose une réflexion sur les raisons qui font que depuis plus de cinquante ans toutes les propositions faites pour lutter contre le changement climatique n’ont réussi à déboucher que sur une augmentation des émissions.
Les analyses qui suivent sont tirées de l’excellent ouvrage collectif (sous la direction d’Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure Teulière), Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public (Ed Seuil 2022. Dans ce manuel Trente -cinq scientifiques apportent un regard critique sur nos trajectoires insoutenables et nous fournissent des outils essentiels pour ouvrir des voies à la transition écologique et énergétique.
Pourquoi la moindre idée écologique donne-t-elle immédiatement prise dans l’espace public à un foisonnement de discours et de pratiques dont le caractère fumeux ne peut que frapper les esprits lucides?
Une première piste de réponse se situe du côté de la sociologie de la culture et de l’histoire des idées. En effet, ces disciplines nous enseignent que chaque moment socio-historique connaît une sorte de canalisation des pensées et des discours dans des bornes qu’il est intellectuellement difficile, et socialement risqué, d’outrepasser.
Chaque époque, chaque société possède ses évidences et ses impensés, ses valeurs et ses manières de mener des raisonnements qui lui semblent valides. Ce cadrage culturel rend difficilement audibles les pensées qui sortent des sentiers battus, mais tend aussi et surtout à orienter les réflexions dans des directions reformatées.
C’est ainsi qu’à notre époque et sur la thématique climatique, il est terriblement difficile, y compris pour des esprits sincères, de s’extirper de certaines catégories héritées et de ne pas reproduire les mêmes impasses sous des prétentions d’innovation. Sur des thématiques aussi variées que l’énergie, l’agriculture, les transports ou encore la «transition», on retrouve toujours les mêmes manières de (mal) penser les problèmes écologiques.
Une deuxième piste de réponse se situe du côté du débat sur la croissance dans un monde fini: cinquante ans après la publication du rapport Meadows, la question des limites à la croissance reste impensée politiquement. La thèse des limites à la croissance mériterait d’être mieux articulée avec la question des inégalités – car ce sont d’abord et surtout les plus riches qui doivent réduire leur train de vie et leurs aspirations matérielles. (André Gorz, René Dumont).
Malgré, le rapport du GIEC plus alarmant que jamais, la guerre en Ukraine qui fait craindre pour la sûreté des centrales nucléaires, une hausse des prix de l’énergie comparable à un choc pétrolier et gazier, la crise sanitaire, etc.… le monde politique et économique est vent debout contre toute remise en cause de la croissance et de l’expansion.
Depuis cinquante ans, la promesse de solutions techniques reste un argument récurrent de relativisation des limites écologiques, qui transcende les différences partisanes et prétend que nous n’aurions pas à choisir entre transition écologique/énergétique et abondance matérielle. La simple idée qu’il puisse exister des limites écologiques à la croissance et à l’expansion reste dissonante, minoritaire dans l’opinion publique, et carrément hérétique parmi les décideurs.
L’idée de décroissance y est aux mieux ignorés, aux pires utilisés comme une invective facile pour disqualifier l’ensemble des approches alternatives aux productivistes. Le rejet est si fort que, même parmi les partisans de la décroissance, beaucoup préfèrent s’autocensurer – «attention, ne nous enfermons pas dans la radicalité et la marginalité, tentons plutôt de rassembler autour de termes et de projets moins clivant, etc.»
Le problème est que la situation climatique et écologique est telle qu’il faudrait aborder de front la question des limites. Le dernier rapport du GIEC montre que les réductions des émissions de gaz à effet de serre, et donc les réductions de consommation d’énergies fossiles, devraient être massives et rapides, voire fulgurantes.
La question des limites à la croissance reste un immense impensé politique, consciencieusement confiné hors du champ du pensable par une écrasante majorité des décideurs, dans un monde néolibéral autoritaire. Quelques brèches apparaissent parfois ici ou là, mais sans durablement faire émerger un projet politique en rupture avec la croissance et son monde.
Notre difficulté à nous passer des hydrocarbures révèle crûment notre dépendance aux énergies fossiles qui demeure, et la vulnérabilité qui en découle. La sobriété, une «évidence» devenue un angle mort de la société de consommation, et un enjeu de justice et de solidarité.
Cinquante ans de déni, de tergiversation, de procrastination ont conduit à une situation inextricable, où les questions du pouvoir d’achat et du prix à la pompe continuent à reléguer toute autre préoccupation au second plan. Lentement, le piège énergétique et climatique se referme.
Il revient à la pensée alternative la tâche ingrate de se réinventer dans un contexte d’assombrissement des horizons politiques et climatiques. Elle pourrait être porteuse d’un projet assumé de réduction massive des surconsommations des plus riches, de protection des plus vulnérables, de partage des richesses, d’un ordre mondial plus juste et de répartition équitable des efforts de sobriété, dans le cadre d’une décroissance en urgence des flux de matière et d’énergie.
Trois biais caractéristiques de la pensée dominante nous semblent cadenasser la réflexion: l’économisme, le solutionnisme technologique et la pensée en silo.
L’économisme désigne la tendance à n’imaginer la conduite des affaires humaines qu’au travers des mécanismes de marché. La gestion des communs, l’auto-organisation, la coopération internationale et bien d’autres propositionssont ainsi laissées dans l’ombre. L’obsession de la «croissance verte» est représentative de ce phénomène d’invisibilisation des alternatives par l’entêtement marchand.
Plus problématique encore, inscrire des dispositifs à prétention écologique dans les logiques du marché revient à les soumettre à un certain nombre d’impératifs (rentabilité, compétitivité, croissance, etc.) et de travers (aveuglement aux externalités négatives, quête obsessionnelle de profit pouvant conduire à des pratiques malhonnêtes, influence des lobbies, etc.) qui font justement partie des moteurs de la catastrophe climatique actuelle.
L’économisme consiste en une simplification radicale des problématiques humaines et écologiques. Il réduit la complexité de la vie à des indicateurs chiffrés (le PIB, le chiffre d’affaires, la valeur financière, etc.) afin de pouvoir en assurer la gestion via des instruments économiques universels. L’absurdité de cette approche ressort nettement des processus de «compensation écologique» qui sont au cœur de la «finance verte» et de la gestion de la biodiversité.
La marchandisation de la nature qui les sous-tend conduit à une négation de la profondeur qualitative du monde et à des mises en équivalence sidérantes entre par exemple la disparition d’une espèce animale et le fait d’investir dans des ateliers de réparation de vélos ou entre la lutte contre les inégalités et le toujours plus.
Le solutionnisme technologique désigne la confiance dans l’innovation technoscientifique pour régler tous les problèmes. Face à la crise climatique, énergétique et écologique, il constitue à la fois un pari risqué et un puissant gardien de l’ordre établi : au vu de l’urgence et de la gravité des menaces, croire qu’une technologie miraculeusement propre nous sortira d’affaire est particulièrement risquée mais alimenter cet espoir a l’avantage, pour les partisans du statu quo, d’exclure du champ de la réflexion tout un ensemble de propositions politiques alternatives.
L’idée de « sauver la planète » (ou plutôt le système) par la technologie pose par ailleurs divers problèmes écologiques, connus et reconnus : déplacement et/ ou transformation des pollutions, effet rebond, épuisement des ressources (minières ou foncières), équité etc. En outre, elle nous enferre encore et toujours dans l’aveuglement aux alternatives et le retardement de l’action.
La pensée en silo, enfin, consiste à considérer les éléments indépendamment du tout et entretient ainsi l’aveuglement aux phénomènes systémiques. Cette rationalité à œillères s’exprime par exemple dans la recherche de solutions «individualistes» ou «par secteur» aux problèmes climatiques.
Les limites de l’individualisme sont pourtant connues : comment faire reposer sur les personnes isolément la charge d’une crise globale dont elles sont par ailleurs les premières victimes ? Si l’articulation de l’individu et du collectif est sans doute un enjeu politique majeur, l’effacement du second derrière le premier est à coup sûr une impasse absolue.
L’autre aspect de la pensée en silo est manifeste lorsqu’on se met à considérer la transition écologique de secteurs spécifiques. Est-il pertinent par exemple de penser la décarbonations de l’aviation indépendamment de l’écologisation générale de nos sociétés, comme on le fait si souvent ? Cela conduit pourtant à des écueils largement documentés: déplacement des pollutions (l’avion à hydrogène implique de… produire de l’hydrogène), conflits d’usages (l’aviation revendique un pourcentage colossal du potentiel total de production d’agro carburants, oubliant que les autres secteurs aussi devront en utiliser), ou encore accaparement des terres (pour « compenser » leurs émissions, les compagnies aériennes plantent des arbres sur des zones confisquées aux populations locales).
Ce greenwashing généralisé dans lequel nous baignons n’est donc pas seulement le produit de tactiques d’enfumage. Ou plutôt, celles-ci ne fonctionnent que parce qu’il est aussi le fruit d’un «air du temps»: celui d’une modernité économiciste, techno-solutionniste et aveugle aux phénomènes globaux, incapable de dévier du tunnel qu’elle ne cesse de creuser.
Une demande sociale pour rester en zone de confort
La bataille culturelle qui permettrait de dépasser ces biais constitue l’un des enjeux majeurs de la lutte contre le changement climatique. Si beaucoup de gens sont désormais conscients et inquiets de l’ampleur de notre destructivité, les remises en cause de nos modes de vie (voire des privilèges des plus nantis) qui seraient nécessaires pour y faire face semblent tellement énormes que tout ce qui permet de les ajourner est facilement accueilli sans recul critique.
Mais il est clair qu’espérer limiter les bouleversements écologiques en cours, à commencer par le réchauffement climatique, implique de renoncer à certaines de ces possibilités, du moins sous leur forme actuelle. Or, cette perspective semble inenvisageable, même pour certains partisans déclarés de la transition écologique.
Si ces idées semblent inaudibles dans l’espace public, c’est qu’elles ne bousculent pas simplement des habitudes isolées mais toute une vision du monde centrée sur le «progrès», vu comme un processus linéaire qu’il faudrait accepter ou rejeter en bloc.
Un constat s’impose d’une accélération dans la « grande accélération » en cours depuis la seconde partie du XXe siècle. La moitié du CO2 émis depuis plus de deux cents ans l’a été après le premier rapport du GIEC (1990), tandis que s’amplifiaient tous les bouleversements globaux, et ce malgré des améliorations technologiques considérables et la mise en œuvre de politiques se disant soucieuses d’environnement.
Autrement dit, l’inexorable aggravation de la situation atteste de l’impuissance à réorienter la trajectoire collective. Face à de telles constatations, le greenwashing fonctionne comme un dernier rempart illusoire et pervers contre la panique.
Que l’on vive toute remise en cause des retombées de l’abondance énergétique comme une insupportable castration, que l’on soit enclin à se précipiter sur la première solution apparente pour ne pas sombrer dans l’éco-anxiété, ou que l’on se débatte simplement dans l’obscurité du présent et l’incertitude sur la voie à prendre, le greenwashing offre des solutions psychologiquement acceptables. Bref, les stratégies illusionnistes marchent parce que le monde tel qu’il est devenu pousse à se bercer d’illusions.
Pr Samir Allal
Université de Versailles/Paris-Saclay
- Ecrire un commentaire
- Commenter