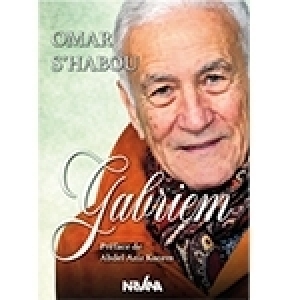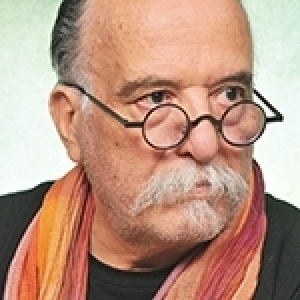Ammar Mahjoubi: Le gouvernement de l’oligarchie

.jpg) A la différence des Etats modernes, la cité-Etat antique ne se définissait pas à partir d’un territoire, mais d’un ensemble de personnes, les citoyens, qui prenaient part aux décisions et aux tâches communes. Les citoyens obéissaient aux lois votées par l’Assemblée du peuple, et à des magistrats élus par elle. Dotés de l’«imperium», le droit de commander, ces derniers pouvaient néanmoins être convoqués par l’Assemblée pour lui rendre des comptes. On constate toutefois qu’à Rome, à l’époque républicaine, cet équilibre était altéré par l’existence d’une oligarchie dominante, qui siégeait au Sénat ; une contradiction permanente opposait ainsi la souveraineté formelle du peuple à la souveraineté de fait de l’oligarchie sénatoriale.
A la différence des Etats modernes, la cité-Etat antique ne se définissait pas à partir d’un territoire, mais d’un ensemble de personnes, les citoyens, qui prenaient part aux décisions et aux tâches communes. Les citoyens obéissaient aux lois votées par l’Assemblée du peuple, et à des magistrats élus par elle. Dotés de l’«imperium», le droit de commander, ces derniers pouvaient néanmoins être convoqués par l’Assemblée pour lui rendre des comptes. On constate toutefois qu’à Rome, à l’époque républicaine, cet équilibre était altéré par l’existence d’une oligarchie dominante, qui siégeait au Sénat ; une contradiction permanente opposait ainsi la souveraineté formelle du peuple à la souveraineté de fait de l’oligarchie sénatoriale.
Le principe de la souveraineté dévolue au peuple, cependant, ne fut jamais mis en cause. Même si elle n’était que théorique, et même si l’imperium des magistrats n’émanait que théoriquement de cette souveraineté, les juristes l’observèrent assidûment et l’appliquèrent même au détenteur du pouvoir impérial, lorsqu’il succéda à l’autorité de la République. Et c’est à ce gouvernement de l’oligarchie romaine et à sa domination que Paul Veyne - auquel cet article est largement redevable - consacre un long paragraphe dans Le pain et le cirque, son grand-livre traitant de l’évergétisme, des dons à la collectivité, qui innervaient la conduite du pouvoir politique à Rome, de la République à l’Empire.
A Rome, la réalité du pouvoir républicain et l’attitude du peuple envers les magistrats les incitaient à se considérer non pas comme des fonctionnaires, mandatés par lui, mais comme des décideurs qui avaient exclusivement le droit de disposer des affaires communes. L’Assemblée du peuple ne pouvait qu’accepter ou refuser leurs décisions, et seulement s’ils l’en informaient et lui demandaient son avis. De fait, à l’inverse du peuple athénien, le peuple à Rome ne venait pas à l’Assemblée pour délibérer, mais seulement pour écouter, debout, ses magistrats qui, assis, présidaient les séances. Ces derniers, à part entière membres du Sénat, disposaient seuls du droit de parler au peuple, de fixer l’ordre du jour de la session et de proposer au vote les projets de loi. En droit, le peuple avait décidé, en les élisant, de leur donner l’imperium, sans le déléguer cependant, et avec la possibilité de le retirer. Mais, de toute façon, l’élu revêtu de la magistrature en devenait le propriétaire, et une fois investi, il devenait le chef et on lui devait obéissance. Car la société romaine était différente de la société athénienne. Dans la démocratie grecque, les citoyens étaient égaux, des marques d’honneur ne distinguaient pas les magistrats et ne les plaçaient pas au-dessus de leurs concitoyens. La société romaine était au contraire divisée, le peuple était constitué d’ordres inégaux devant la loi ; inégaux en dignité étaient les sénateurs, les chevaliers, les décurions et les plébéiens. Cicéron pouvait donc écrire : «L’égalité est injuste, puisqu’elle ne comporte pas de différences de dignité.» (République, I, 43). Supérieure ainsi en dignité et en richesse, une oligarchie constituée par les membres des ordres dominants – les deux ordres nobiliaires à l’échelle de l’Etat et les notables des cités à l’échelle locale– avait, quasi moralement, le droit de gouverner. Plus qu’un état de fait, c’était une réalité admise par l’opinion populaire, car le service de l’Etat n’était pas rémunéré. Sans salaire, seuls les rentiers du sol pouvaient accéder aux magistratures et aux deux ordres sénatorial et équestre. Au IIe siècle avant le Christ, la concentration du pouvoir était devenue telle qu’une vingtaine de familles avait pu accaparer le champ politique. Alors qu’au temps de la démocratie athénienne, la classe gouvernante n’avait aucune existence, elle était effective et agissante à Rome et elle dirigeait de fait la république romaine.
Les magistratures, au IIe siècle av. J.-C., étaient en petit nombre et celui qui y accédait s’en faisait une gloire. Chaque année on élisait trente magistrats dont une douzaine commandait les armées et gouvernait les provinces, alors que les autres restaient à Rome. Mais aussi bien dans la métropole qu’aux armées et dans les provinces, chaque magistrat avait son domaine propre, dont il était pratiquement le maître et où il se comportait en souverain. Autant l’accès aux magistratures que l’appartenance aux ordres supérieurs étaient réservés à une oligarchie de riches «optimates»; c’était aussi parmi elle que se recrutaient les leaders des «populares», ces oligarques généreux ou ambitieux qui, bien que sénateurs, recouraient à l’Assemblée du peuple contre le Sénat. Revêtir une magistrature, pour les membres de cette oligarchie, n’était pas considéré comme une mission au service de l’Etat, mais comme une distinction de rang, de prestige et de dignité, dont ils se flattaient avec ostentation dans leurs inscriptions, et dans leurs dons à la collectivité, fil directeur de l’ouvrage de P. Veyne. Le point d’honneur de chaque famille était d’accéder aux magistratures les plus élevées, de compter le plus grand nombre de consuls et de préteurs. S’évertuant à illustrer sa maison, le gouvernant se couvrait de gloire en estimant, comme le vieux Caton, que la politique a pour enjeu la «gloria» et l’«honor» des hommes politiques.
Veyne en arrive à comparer le comportement de l’oligarchie romaine à celui des entrepreneurs capitalistes. De nos jours, ces derniers ne se proposent guère d’accroître le bien-être de la population, mais de gagner le maximum d’argent. Mais, ce faisant, ils favorisent l’élévation du niveau de vie et du bien-être de la société. De même, les oligarques romains cherchaient exclusivement l’illustration de leur maison et, ce faisant, ils agrandissaient sans cesse l’Empire et la domination romaine dans le monde antique. Constamment déchirés par des rivalités de personnes, ils étaient persuadés que leur maintien au pouvoir était lié à l’intérêt de l’Etat, dont l’impérialisme intériorisé correspondait à leurs appétences guerrières. Car tout comme les Etats-Unis d’Amérique à notre époque, Rome, Etat impérialiste, ne tolérait pas l’existence, dans le monde antique autour de la Méditerranée, de la moindre présence hostile à ses intérêts ; quand bien même cette présence, impuissante, aurait été incapable de constituer une menace.
En matière de finances publiques, les oligarques romains, qui avaient le sens de l’Etat, considéraient que le Trésor public, l’ «aerarium», dont la création datait du milieu du Ve siècle av. J.-C., n’appartenait ni aux citoyens, ni aux magistrats, mais était à la disposition d’une entité, la «Res Publica», dont l’oligarchie dirigeante avait la tutelle. Et de la même manière qu’un tuteur ne devait ni faire des libéralités ni, à plus forte raison, dilapider des fortunes aux dépens du patrimoine de son pupille, ni les magistrats, ni le Sénat ne devaient dépenser les deniers du Trésor public en donations et autres largesses, considérées comme des générosités démagogiques. Cette attitude, qui devint un sujet de friction récurrent entre les «optimates» et les «y populares», s’aggrava surtout à propos du blé public, distribué gratuitement à la plèbe de Rome.
Le pouvoir du Sénat, avec un bien-fondé solide, interdisait aux magistrats toute dépense du Trésor démunie d’une autorisation préalable. L’argent mis par le Sénat à la disposition des magistrats restait la propriété de l’Etat, nonobstant une ou deux exceptions: les sommes destinées aux jeux célébrés en l’honneur des dieux devenaient la propriété du magistrat qui les recevait, et ne donnaient pas lieu à une reddition des comptes. Exception pleinement justifiée, car pour remplir leur devoir, les édiles et les préteurs recevaient des montants nettement insuffisants, et ils devaient payer de leurs propres deniers la plus grande partie des frais. Toute dépense publique, par ailleurs, était défrayée par le Trésor. Lorsqu’un magistrat devait faire une dépense au service de la République, le Trésor commençait par lui verser la somme correspondante et lui en confier la gestion en tant que questeur. Et les sommes non dépensées devaient revenir au Trésor.
Composé des anciens magistrats et de tous les magistrats annuels en exercice, maître de l’Etat à l’époque républicaine, le Sénat contrôlait toutes les magistratures ; obligation était faite à leurs détenteurs de lui demander son avis, qu’ils ne pouvaient se permettre de négliger. Les sénateurs, grands oligarques de Rome, constituaient ainsi une caste gouvernante de quelques centaines de personnes : un corps dirigeant qui, à la fin de la République, était devenu pratiquement héréditaire. Les réformes du début de l’Empire créèrent les conditions pour une stabilité durable et la transmission de la dignité sénatoriale sur trois générations ; car priorité était accordée aux fils des sénateurs pour accéder à cette haute Assemblée où un nom illustre assurait, sauf disgrâce brutale, une carrière brillante. Mais à côté des lignées qui, parfois, se maintenaient durablement pendant plusieurs siècles, nombreux étaient cependant les sénateurs sans descendance connue et les familles sénatoriales attestées seulement sur deux.
Ammar Mahjoubi
- Ecrire un commentaire
- Commenter