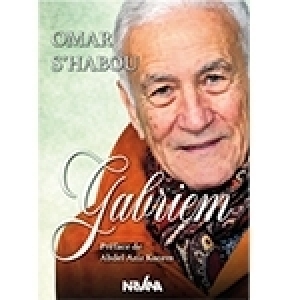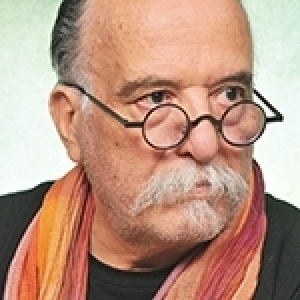Une nouvelle de Habib Selmi, traduite de l’arabe par Tahar Bekri

Né en 1951 à El-Alâa (Kairouan), Habib Selmi est romancier et nouvelliste. Vit à Paris. A été journaliste et enseignant. Son œuvre romanesque est couronnée de nombreux succès, prix et distinctions. Elle figure parmi les voix importantes de la narration arabe actuelle. Traduite en français aux Ed. Actes Sud, elle l’est aussi, dans d’autres langues européennes. Ci-après une nouvelle traduite de l’arabe par Tahar Bekri.
La nouvelle
Je me préparais à quitter la ville vers l’un des villages à la campagne, quand la nouvelle me parvint. Sur le moment, je suis resté tranquille, regarder autour de moi, sans rien voir, puis je me suis abattu sur le nouveau divan que j’ai acheté, il y a deux jours, avec la somme que j’ai gagnée au Loto et me suis mis à pleurer. Quelques minutes après, j’ai essuyé mes larmes avec mon mouchoir blanc que j’aime beaucoup. J’ai pensé, pendant que je le mettais dans la poche de mon pantalon, que je n’ai pas pleuré avec une telle peine, depuis des années et plus précisément, depuis la mort de ma mère. J’ai examiné la valise que j’ai posée depuis peu devant la porte, puis je me suis levé, l’ai remise à sa place, sur l’armoire, sans la vider de son contenu, me suis rassis sur le divan.
J’étais heureux avant que la nouvelle ne me parvienne. Je me suis réveillé tôt, pas comme à mon habitude, j’ai pris un bain longuement, fredonnant l’air de la seule chanson que j’apprends, puis j’ai mis mon costume bleu, me suis peigné les cheveux, j’ai regardé de longs moments mon visage dans le miroir, comme je fais quand je suis heureux. J’ai fixé mon regard sur mes lèvres, mon nez et mon menton, centré mon regard sur mes deux yeux noirs larges, me suis convaincu davantage qu’ils sont ce qu’il y a de plus beau dans mon visage. Après avoir rangé les affaires de bain, nettoyé la baignoire, je me suis assis à la table ronde et pris mon petit déjeuner lentement : deux œufs durs et un café sans sucre que j’ai bu à petits coups en regardant un chat noir qui tentait de grimper à un cyprès dans le jardin.
Pendant que je baissais le rideau de la fenêtre, la dernière chose que je fais avant de quitter la maison (après avoir vérifié que toutes les cigarettes sont éteintes dans le cendrier) le téléphone sonna. C’était la première fois dans laquelle le téléphone sonne à une telle heure, depuis que j’ai déménagé dans cette maison. J’ai cessé de baisser le rideau et suis resté debout, pensant à ce que je devais faire. Dans un regard fortuit vers le cyprès que le chat tentait de grimper, j’ai décidé de ne pas soulever le combiné. J’ai baissé le rideau rapidement, j’ai porté ma valise qui m’a paru à ce moment-là, lourde, j’ai avancé en espérant que le téléphone s’arrêtera de sonner. Je détestais de recevoir une communication téléphonique quand je suis sur le point de voyager, mais la sonnerie ne s’est pas arrêtée. Elle s’est poursuivie avec insistance, comme si la personne qui téléphonait était sûre que j’étais à la maison. J’étais dérangé par cette idée, me suis arrêté près de la porte et j’ai déposé la valise. Et, de peur de ce qui pourrait surgir en moi comme sentiments douloureux, pour avoir ignoré la communication, j’ai décidé, enfin, de régler cela et me laisser aller avec ma grande curiosité pour découvrir cette personne têtue qui s’est introduite dans mon monde ce beau matin-là. Je me suis dépêché vers le téléphone et j’ai pris le combiné, me parvint la nouvelle de la mort. Tandis que mon interlocuteur parlait avec une voix enrouée de ce qui s’est passé, je me suis abattu, silencieux, sur le lit près du téléphone, me sont apparus, le petit chemin qui sépare la forêt des champs de blé, le hall de la petite gare du train, les maisons des paysans parsemées autour du fleuve. Pendant que j’écoutais mon interlocuteur, qui m’interpellait de temps à autre, si je l’entendais parfaitement, j’ai ressenti un grand regret d’avoir soulevé le combiné. Quand la communication fut terminée, j’ai regardé autour de moi, distrait, puis j’ai entraîné mon corps lourd et me suis allongé sur le divan. J’ai entremêlé mes doigts et j’ai fermé les yeux, me suis mis à penser au défunt.
Au début, ma mémoire a retrouvé facilement les traits de son visage, de son corps et de ses petites choses : son menton pointu, ses yeux étroits, son grand nez avec ses larges narines, la coupe de ses cheveux qui n’allait pas avec son long visage, ses deux bras couverts de poils abondants, ses orteils dans les sandales, son long manteau qu’il enlevait et pliait soigneusement, chaque fois qu’il s’apprêtait à s’asseoir, son cartable en cuir rempli régulièrement, la montre de main qu’il mettait toujours dans sa poche. Peu à peu, ces traits se mirent à s’évanouir de la mémoire, l’étrange est que, chaque fois, que j’essayais de m’y accrocher, ils échappaient davantage, résistaient. A un certain moment, je me suis rendu compte, que je n’étais plus en mesure de me souvenir, même de la couleur de ses yeux.
Après hésitation, je suis allé vers la table, ouvert le tiroir, me suis mis fiévreusement à chercher la seule photo que j’avais essayé de la lui arracher. Quand je l’ai trouvée, je suis revenu au divan, l’ai posée sur mes genoux et me suis mis à la fixer. Le visage m’a paru, clairement, bien différent de celui que retrouvait la mémoire, il y a un instant. Quelques instants après, je me suis aperçu que le défunt était, contrairement à ce que je croyais, laid, il m’a paru plutôt pendant que je regardais la photo de loin, qu’il y avait une similitude entre lui et le singe. Je fus troublé par cette découverte et s’est créé en moi un sentiment de mépris pour moi-même, mêlé de regret. De peur de m’embourber dans ces sentiments douloureux, j’ai posé la photo sur le divan, à côté de moi puis l’ai retournée.
La chaleur augmenta autour de moi, j’ai ouvert la fenêtre, j’ai enlevé ma veste et mes chaussures, puis me suis allongé sur le divan. Si j’avais quitté la maison avant la sonnerie du téléphone, je serais arrivé à la gare depuis longtemps, serais en train, comme d’habitude, d’observer les voyageurs, les accueillants et les accompagnateurs… A chaque voyage, j’arrive à la gare longtemps en avance, avant l’heure du départ, afin d’observer avec un plaisir obscur, les spectacles des aux-revoir et des accueils, écouter la voix féminine paresseuse qui annonce l’arrivée des trains et leurs départs. J’ai approché ma main de mon visage et j’ai regardé ma montre. Quand l’heure du départ du train arriva, j’ai pris la photo lentement, sans la retourner, j’ai lu la date écrite sur son envers, la mémoire retrouva soudainement les traits du visage que j’ai perdus, il y a un instant. J’ai ressenti une joie légère dissipant mon trouble, un désir fort m’envahit de voir le visage du défunt, mais je ne m’y suis pas plié, de peur d’être envahi par ces sentiments désagréables.
J’ai posé la photo sur ma poitrine, me suis mis à scruter le plafond en essayant d’imaginer ce qu’allait produire la nouvelle de la mort, comme transformations dans ma vie. Le café où nous nous assoyions chaque soir, je n’y entrerai plus à l’avenir, le projet que nous nous apprêtions à réaliser, ne se fera pas, le lieu de plaisir secret, que nous fréquentions, je vais le déserter, à tout jamais, les soucis de la vie quotidienne et ses fatigues, je vais les affronter seul.
Ces imaginations ont perturbé mon esprit et la mélancolie m’a assailli. Je me suis souvenu que pleurer est la meilleure manière de se débarrasser de cela, j’ai décidé de pleurer de nouveau. J’ai levé ma tête, centrant tout mon effort pour me souvenir de notre dernière rencontre, j’étais persuadé que se remémorer cette rencontre avec tous ses détails, allait aviver mes sentiments et me permettre d’exécuter ma décision. Peu après, il s’est produit ce que je souhaitais, une larme coula de l’un de mes yeux, suivie d’une autre de mon autre œil. Puis les larmes se sont succédées à une vitesse que je ne soupçonnais pas. Elles glissaient sur ma joue, quand elles arrivaient à mon menton, elles se mélangeaient avec la morve qui coulait de mon nez et tombaient sur le divan.
Quand la crise de larmes fut finie, j’ai baillé, remué ma main puis je me suis levé et suis entré dans la salle de bain. Je me suis approché de la glace, j’ai regardé mon visage, me demandant si mes amis allaient oublier mes traits après ma mort, comme il m’est arrivé avec le visage de mon ami disparu. La raie droite que j’ai tracée dans mes cheveux après mon bain a disparu, quant à mes yeux que je croyais, ce qu’il y avait de plus beau dans mon visage, m’ont paru effrayants, de ce qu’ils ont subi de gonflement. J’en ai conclu, relevant ma tête en arrière, que la beauté et la laideur sont, en fin de compte, la même chose, la différence entre elles vient de la création de nos imaginations, de nos sentiments et de nos impressions.
Pendant que j’ouvrais le robinet et me penchais pour laver mon visage de ce qui s’est accumulé comme traces de larmes et de morve, le téléphone sonna de nouveau. Je fus secoué, apeuré, je courus vers la salle de bain, j’ai allongé mon cou et j’ai vu le téléphone avec de larges yeux, comme si je voulais être sûr que la sonnerie que j’ai entendue, a bien eu lieu. Contrairement à la première fois, je n’ai pas pensé à ignorer la communication. J’ai fermé le robinet et j’ai quitté la salle de bain, à pas lents. Quand je me suis approché du téléphone, le cyprès m’est apparu. A ce moment-là, je me suis demandé si ma vue du chat noir qui essayait de le grimper, n’était pas de mauvais augure. Mais je ne suis pas allé loin dans mes interrogations. J’ai tendu ma main vers le combiné et d’un mouvement sûr, je l’ai approché de mon oreille.
J’ai ressenti une joie quand j’ai découvert que mon interlocuteur était la personne qui m’avait appris la nouvelle. Mais je n‘avais aucune envie d’écouter les détails de la mort et de ses conditions qu’il racontait avec une sorte de plaisir. J’ai fixé le combiné entre mon épaule et ma tête, j’ai posé mes pieds sur une chaise tout près, puis j’ai enlevé mes chaussettes et me suis mis à jouer avec mes orteils, me souvenant de temps à autre, de la forêt, des champs de blé, des maisons des paysans parsemées autour du fleuve dont j’avais été privé de leur vue ce jour-là, peut-être à cause d’un chat noir qui tentait de grimer le cyprès.
Revue Al-Karmal, n°34, 1989.
© Trad. de l’arabe par Tahar Bekri
- Ecrire un commentaire
- Commenter