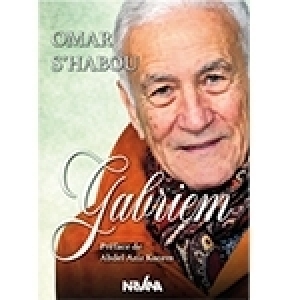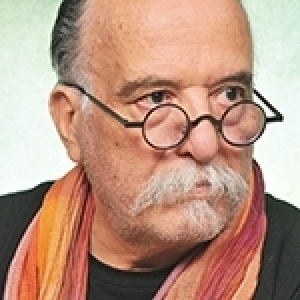Ammar Mahjoubi: Les pouvoirs de l’Empereur romain

.jpg) A Rome, dès l’avènement du régime naissant, Auguste, «primus inter pares», le premier des pairs, avait largement agrandi la base sociologique de son pouvoir. Aux citoyens liés à la famille des «Julii» (qu’il avait héritée de son père adoptif Jules César) dans la métropole, dans les cités italiennes et dans les colonies qu’il avait fondées, il ajouta les soldats qui avaient servi sous ses ordres et les clients des grandes familles sénatoriales. Pour tirer davantage profit des échanges traditionnels de services qu’offrait ce système romain de protection et d’assistance, le clientélisme impérial ne tarda pas à s’étendre à toutes les cités provinciales ; mais avec de nouveaux «patroni», qui jouèrent un rôle de médiateurs entre le «princeps» et ses protégés. Par la suite, le poids de cette clientèle s’affaiblit peu à peu, et devenue indirecte, elle ne fut plus sensible et importante qu’à certaines occasions, surtout au moment des investitures, lorsque le nouveau maître de l’Empire avait, dans les premières semaines, le plus grand besoin d’obtenir la fidélité des masses.
A Rome, dès l’avènement du régime naissant, Auguste, «primus inter pares», le premier des pairs, avait largement agrandi la base sociologique de son pouvoir. Aux citoyens liés à la famille des «Julii» (qu’il avait héritée de son père adoptif Jules César) dans la métropole, dans les cités italiennes et dans les colonies qu’il avait fondées, il ajouta les soldats qui avaient servi sous ses ordres et les clients des grandes familles sénatoriales. Pour tirer davantage profit des échanges traditionnels de services qu’offrait ce système romain de protection et d’assistance, le clientélisme impérial ne tarda pas à s’étendre à toutes les cités provinciales ; mais avec de nouveaux «patroni», qui jouèrent un rôle de médiateurs entre le «princeps» et ses protégés. Par la suite, le poids de cette clientèle s’affaiblit peu à peu, et devenue indirecte, elle ne fut plus sensible et importante qu’à certaines occasions, surtout au moment des investitures, lorsque le nouveau maître de l’Empire avait, dans les premières semaines, le plus grand besoin d’obtenir la fidélité des masses.
Aces liens vagues et incertains du système clientéliste et de la clientèle familiale traditionnelle, ne tarda pas alors à se substituer, puis à se généraliser, le serment militaire d’allégeance «pro salute Caesaris», qui liait fortement à l’Empereur et à ses descendants magistrats, sénateurs, citoyens et cités. A partir du règne de Tibère, le successeur d’Auguste, ce vœu pour le salut de l’Empereur fut annuellement renouvelé, au Sénat d’abord et lors du serment prêté par les magistrats, puis dans toutes les cités de l’Empire. Mais plus tard, aux IIe et IIIe siècles, les sources le mentionnent surtout à l’occasion des avènements et des usurpations.
.jpg) Pour tenir ses obligations envers ses clients, à Rome et dans les cités de l’Empire, l’Empereur disposait d’une immense fortune qu’Auguste, le premier, n’avait cessé d’agrandir ; aux biens déjà considérables des «Julii», il avait ajouté les revenus de l’Egypte, rattachée à son patrimoine, ainsi que les biens issus des héritages, des confiscations et des butins tirés des conquêtes. Auguste eut ainsi les moyens de procurer au nouveau régime la possibilité et le mérite de donner à Rome l’allure d’une capitale mondiale ; ce que n’avait pu faire, faute de ressources financières, l’administration de l’époque républicaine. Dans les «Res gestae», l’éloge de lui-même qu’il avait fait graver sur son tombeau, il dressa une liste impressionnante des monuments publics qu’il avait fait construire ou restaurer sur ses revenus personnels. A Rome et, aussi, en Italie et dans les cités de l’Empire, temples, thermes et lieux de spectacles furent érigés, et des divertissements onéreux furent organisés sur les scènes des théâtres, les arènes des amphithéâtres et des cirques. Après Auguste, une règle sera absolue sous le Haut-empire : les empereurs construiront partout des édifices publics, mais se réserveront le monopole de cet évergétisme à Rome, leur capitale.
Pour tenir ses obligations envers ses clients, à Rome et dans les cités de l’Empire, l’Empereur disposait d’une immense fortune qu’Auguste, le premier, n’avait cessé d’agrandir ; aux biens déjà considérables des «Julii», il avait ajouté les revenus de l’Egypte, rattachée à son patrimoine, ainsi que les biens issus des héritages, des confiscations et des butins tirés des conquêtes. Auguste eut ainsi les moyens de procurer au nouveau régime la possibilité et le mérite de donner à Rome l’allure d’une capitale mondiale ; ce que n’avait pu faire, faute de ressources financières, l’administration de l’époque républicaine. Dans les «Res gestae», l’éloge de lui-même qu’il avait fait graver sur son tombeau, il dressa une liste impressionnante des monuments publics qu’il avait fait construire ou restaurer sur ses revenus personnels. A Rome et, aussi, en Italie et dans les cités de l’Empire, temples, thermes et lieux de spectacles furent érigés, et des divertissements onéreux furent organisés sur les scènes des théâtres, les arènes des amphithéâtres et des cirques. Après Auguste, une règle sera absolue sous le Haut-empire : les empereurs construiront partout des édifices publics, mais se réserveront le monopole de cet évergétisme à Rome, leur capitale.
Ces liens noués entre le «princeps» et des communautés entières participaient efficacement à la stabilité du régime ; et l’ampleur des biens impériaux ainsi que les innombrables esclaves de la «familia» impériale rendaient effective la gestion des relations clientélaires et facilitaient d’autant l’exercice des pouvoirs publics. Ainsi s’affirmait l’«auctoritas», reconnue à l’empereur grâce à ses vertus, à ses succès militaires et à l’éminence de ses ancêtres ; autorité qui dressait un obstacle insurmontable face à tout adversaire, à toute opposition. Le seul moyen pour évincer le détenteur du pouvoir était le soulèvement des troupes, surtout celles des prétoriens de la garde impériale.
L’empereur romain, toutefois, n’était pas un monarque absolu, dont la volonté avait force de loi ; ses décisions procédaient d’une législation, et il gouvernait dans le respect de toutes les magistratures traditionnelles. En temps normal, il usait de son «auctoritas» et de ses privilèges, dans une entente plus ou moins confiante et mesurée, tout en exerçant sur le Sénat, au besoin, une pression discrète. Les «tyranniques» parmi les empereurs étaient ceux qui avaient recours à la force et exerçaient de fortes pressions, tant sur l’Assemblée que sur les magistrats ; mais en se gardant toujours de porter atteinte aux rouages traditionnels de la «Res publica», de suspendre les mécanismes habituels du gouvernement.
Devenu «imperator» par la proclamation de l’armée, suivie de l’approbation du Sénat, l’empereur était apte à recevoir du peuple, sur proposition de l’Assemblée, ses pouvoirs publics. Deux d’entre eux étaient essentiels, l’«imperium» proconsulaire et la puissance tribunicienne ; s’y ajoutaient éventuellement des magistratures, des privilèges institutionnels et des pouvoirs religieux. Cet «imperium» impliquait, traditionnellement, le commandement de l’armée ; revêtu par les proconsuls en exercice à la tête des provinces, il était nécessairement provisoire et momentané ; mais celui qui était accordé à l’empereur lui était conféré à titre viager, même s’il fut, sous Auguste, périodiquement renouvelé. Il était aussi illimité, c’est-à-dire étendu à toutes les provinces de l’empire et dégagé des règles contraignantes qui, par exemple, empêchaient de franchir en armes le «pomerium», l’espace consacré, en dedans et en dehors des murailles, autour de Rome.
Partout, même dans les provinces «sénatoriales», placées sous l’autorité du Sénat, l’empereur pouvait, en vertu de cet «imperium», lever des troupes, donner ses instructions aux gouverneurs. A Rome cependant, et dans toute l’Italie, les légions ne pouvaient pénétrer que pour célébrer des triomphes. Le commandement maritime et celui du littoral italien avaient toutefois conduit Auguste à aménager des ports de guerre permanents à Ravenne, puis à Misène ; tandis que la nécessité de disposer d’une garde du corps avait entraîné l’introduction à Rome et en Italie des troupes chargées d’assurer la sécurité de l’empereur et de l’Urbs, la Ville par excellence.
Cette garde prétorienne restait cependant inférieure, numériquement, à une légion ; jusqu’au règne de Septime Sévère, qui remplaça les cohortes de la garde par la Deuxième légion parthique, installée à Albano.
L’»imperium» proconsulaire était aussi un pouvoir civil, impliquant l’administration des territoires de l’empire par des gouverneurs de rang sénatorial ou équestre, ainsi que l’exercice d’une juridiction civile et criminelle, en première instance et en appel ; mais les interventions de l’empereur dans les affaires judiciaires n’étaient pas fréquentes, limitées aux procès les plus importants, tels ceux qui concernaient des accusés de haut rang. Un autre pouvoir viager était également détenu par l’empereur : la puissance tribunicienne, renouvelée chaque année, immanquablement à une date fixe, qui finit par être arrêtée au 10 décembre. Et c’est grâce à ces années de «puissance tribunicienne» qu’on a toujours continué à compter les années de règne.
La puissance tribunicienne ne faisait pas de l’empereur un tribun de la plèbe, exerçant cette magistrature traditionnelle, mais elle lui conférait ses pouvoirs redoutables avec, en premier lieu, une sacro-sainteté qui garantissait l’inviolabilité absolue de sa personne et de ses décisions. Les empereurs usèrent de la puissance tribunicienne pour abroger les senatus-consultes et les décisions hostiles ou inopportunes des magistrats, surtout en matière judiciaire. Ils s’en servaient aussi pour réprimer les abus, pour protéger la plèbe et pour convoquer le sénat ou l’Assemblée du peuple et leur soumettre des propositions de loi. Auguste, par exemple, proposa au peuple, en vertu de cette puissance, des lois contre la brigue, le célibat et la stérilité ; et c’est aussi grâce à elle que l’intercession des tribuns de la plèbe, pour bloquer les décisions des autres magistrats, perdit sa force contraignante, puisque cette intercession ne pouvait aller à l’encontre de la puissance tribunicienne éminente de l’Empereur.
Quoique maître de l’Empire, celui-ci ne bénéficiait que des vertus de cette puissance à Rome même, alors qu’en Italie et dans les provinces, il jouissait d’un pouvoir inégalé ; à moins de revêtir le consulat, ce qui n’était pas forcément le cas. Si bien que toute une série de pouvoirs lui échappaient, ceux notamment qui étaient exercés par le sénat, par l’Assemblée du peuple et par les magistrats civils. Aussi était-ce pour combler d’éventuelles lacunes de son pouvoir que des privilèges lui furent accordés par une loi dite «de imperio Vespasiani», qui énuméra les dispenses et les concessions faites aux empereurs pour accroître considérablement la portée de leur ascendant. Des privilèges successifs furent ainsi accordés à l’empereur, pour élargir et compléter ses pouvoirs civils dans la métropole de l’empire. Il reçut le droit, en convoquant sans restriction le Sénat, de le présider, ainsi que le pouvoir d’élargir la limite pomériale, c’est-à-dire l’espace libre réservé au culte, qui était ménagé autour des villes romaines. Une clause célèbre, considérée par les historiens comme une mesure discrétionnaire, lui donna aussi le droit d’entreprendre tout ce qu’il jugeait utile, tant dans l’intérêt des particuliers que dans celui de la Res publica ; et pour compléter son droit de décider la guerre et de signer la paix, un texte mutilé, appelé «de imperio» par les historiens, lui accorda la faculté de conclure les traités ; ce qui relevait en principe du pouvoir sénatorial. Privilèges conférés successivement avec d’autres, peut-être, mentionnés probablement dans la partie mutilée de ce texte.
Comme l’ensemble des magistrats et des détenteurs d’autorité, l’empereur possédait, enfin, des pouvoirs religieux. Depuis Auguste, il était constamment élu et coopté par tous les collèges sacerdotaux publics, dès son avènement ; en particulier par ceux qui étaient chargés de gérer et de dire le droit sacré. Et depuis le 6 mars 12 av. J.-C., lorsqu’Auguste avait été élu grand pontife, cette dignité conféra aux empereurs, qui la recevaient aussi dès leur avènement, le pouvoir de contrôler toute la vie religieuse. En tant que source de légitimité sacrée, ces pouvoirs religieux étaient devenus les auxiliaires redoutables des détenteurs de l’imperium.
Une conduite typiquement romaine empêchait l’empereur, aussi bien que le Sénat et les gouverneurs des provinces, de déléguer leurs pouvoirs. Mais dès le début du règne de Tibère un «Conseil du prince» (Concilium principis) entra en fonction. Il était constitué de conseillers et d’un groupe informel d’amis, choisis par l’empereur (amici, comites). Depuis le règne de Marc Aurèle, des juristes (consiliarii) y furent introduits. Marc rompit même l’ancien équilibre politico-social en introduisant, dans la classe dirigeante, des membres du second ordre nobiliaire, avec des responsabilités et un pouvoir comparables à ceux des sénateurs. En 177, le conseil impérial était ainsi composé pour moitié seulement de sénateurs, l’autre moitié était réservée aux chevaliers.
Ammar Mahjoubi
- Ecrire un commentaire
- Commenter