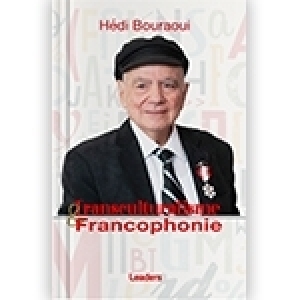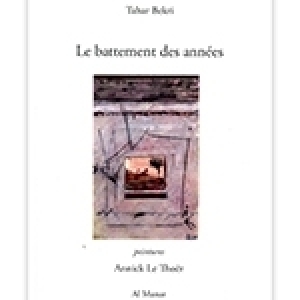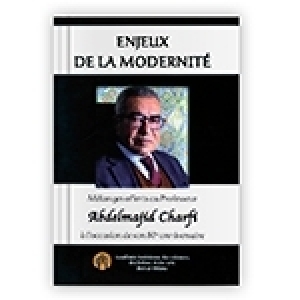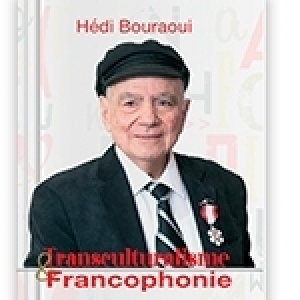Les nouveaux «bien-pensants» de Michel Maffesoli
Le plus éminent théoricien de la postmodernité salue la nouvelle année en s’associant à sa femme pour publier, le 16 janvier aux éditions du Moment, un nouveau pamphlet prolongeant l’esprit de ses écrits de combat ayant déjà fait l’objet de La République des bons sentiments.
Maffesoli est l’inventeur de notions devenues incontournables, développant une pensée révolutionnaire iconoclaste. Il est le théoricien génial de l’actuel et du quotidien, de la connaissance ordinaire et de l’imaginaire, de la socialité émotionnelle et affective des tribus et leurs réseaux, de la personne plurielle nomade et hédoniste au vagabondage initiatique, de la raison sensible et de la revanche des valeurs du Sud dans le cadre de l’écosophie et du réenchantement du monde, du retour du fait religieux dans l’orgasme dionysiaque de l’homme postmoderne qualifié d’homo eroticus.
En rappelant que Leaders a déjà eu l’honneur d’interviewer M. Maffesoli qui aime notre pays, suivant de près sa révolution, pensant même qu’elle fait de la Tunisie une illustration basique de la postmodernité, nous estimons que son réquisitoire sans concessions du modèle périmé hexagonal et de l’esprit français dépassé s’applique mutatis mutandis à notre pays.
Aussi livrons-nous ici ces quelques bonnes feuilles des cinq chapitres roboratifs de son livre dont la lecture pourrait aider à sortir de notre propre «bienpensance» politico-religieuse. Et comme la lecture de Maffesoli relève de la nourriture céleste dont on ne se lasse point, nous signalons nos autres extraits exclusifs de cette ambroisie déjà sur internet.
Les bonnes feuilles
Le conformisme logique
À l’encontre d’un lieu commun hérité du XIXe siècle faisant de l’infrastructure économique le fondement de toutes choses, il est de plus en plus évident que c’est l’immatériel qui conditionne le lien social. Et donc permet sa survie ou son déclin. N’est-ce point ainsi que l’on peut comprendre la remarque de Milan Kundera : « Il en est des amours comme des empires ; que cesse l’idée sur laquelle ils reposent et ils s’effondrent avec elle »?
Mais il est des moments où cette «idée» perd sa force et sa vigueur spécifiques. Des sociologues, tel P. Sorokin, ont ainsi parlé de « saturation». Par usure, par fatigue, par lassitude aussi, l’idée ne peut plus exercer sa fonction agrégative. Tel un aimant ayant perdu sa faculté d’attraction, il ne lui reste plus, dès lors, qu’une rémanence de peu d’importance qui, avant que naisse un autre champ magnétique, perdure tant bien que mal ; plutôt mal que bien.
Il s’agit là de l’indubitable symptôme de toutes les périodes de décadence. Voilà ce qu’est la crise : un moment où n’ayant plus conscience de ce que l’on est, on n’a plus confiance en ce que l’on est. La crise étant un jugement («crisis») porté par ce qui naît sur ce qui est en train de disparaître. La crise est dans nos têtes ! Pour paraphraser Léonard de Vinci, c’est une « cosa mentale », une chose travaillant l’esprit collectif. Comprendre, c’est autrement plus riche. Car cela prend en compte l’entièreté de l’être individuel et collectif. Au travers de ce que Auguste Comte nommait un « empirisme organisateur », voilà qui permet de saisir le « pays réel », et non cela que l’on aimerait qu’il soit.
***
J’ai commencé ma carrière en faisant une analyse critique du « progrès et du service public ». Je renvoie le lecteur curieux à ces pages intempestives. Je voulais indiquer par là que le progressisme est, potentiellement, destructeur. Seule la « progressivité », celle de l’enracinement dynamique, est à même de nous aider à comprendre ce que l’on vit au présent. Chose fort simple que les «progressistes» de tous poils s’emploient, avec constance, à dénier. La pensée empirique, celle du bon sens, celle de la sagesse populaire, le sait bien : ce qui doit naître, ce qui advient à une époque donnée, mûrit lentement à l’époque précédente. On va parler de modernité seconde, d’hypermodernité, de surmodernité, de modernité avancée et autres fredaines de la même eau. Et ce afin de tenter de sauver un monde déshabité. Car c’est bien de cela dont il s’agit: l’inconscient collectif ne se reconnaît plus dans les grandes valeurs ayant constitué l’époque moderne. Un cycle commencé avec le XVIIème siècle s’achève, et on ne sait pas le reconnaître.
C’est exactement dans cette dénégation que se trouve la source de la bien-pensance contemporaine. Les incantations sur la République, le Progrès, le Contrat Social, le Citoyen, la Démocratie, la Liberté et autres majuscules n’ont d’autre but que de masquer le profond désarroi d’un monde officiel vis-à-vis d’une socialité souterraine dont il ne comprend pas les manifestations. Cette dernière pivote. Elle fait subir une torsion aux valeurs établies. Elle valorise le ludique, le festif, l’onirique, l’imaginaire. Et ainsi, rappelle à sa manière qu’il est un éternel retour du même. N’est-ce point ainsi que dans son œuvre si bien nommée «De Naturarerum», de la nature des choses, Lucrèce rappelait que «eademsuntomnia semper», les choses sont toujours les mêmes ?
C’est cela la progressivité de la postmodernité, contre le progressisme moderne. Ce que ceux qui ont la prétention d’être les tuteurs du peuple ne peuvent pas voir. Durant les périodes de mutation, il est fréquent d’exorciser les peurs plutôt que d’affronter de nouvelles valeurs. C’est ainsi que, d’une manière on ne peut plus rétrograde, on va faire miroiter le retour de l’Etat, le recours à l’Etat, l’idéologie du Service Public, comme étant la panacée universelle. L’histoire de la pensée, tout comme l’Histoire tout court, est ponctuée de longs assoupissements et de réveils non moins brusques. Nous sommes en un de ces moments charnières où la socialité de base retrouve une indéniable effervescence, alors que les élites se réveillent difficilement de leur long sommeil dogmatique. C’est d’ailleurs celui-ci qui est cause et effet de cette mentalité diffuse du ressentiment caractérisant les élites contemporaines.
***
Voilà ce à quoi conduit la somnolence dogmatique, celle du rationalisme moderne déniant le vitalisme quelque peu anomique, refusant la vitalité exubérante, combattant l’effervescence désordonnée au nom d’un puritanisme bien-pensant l’amenant à condamner ce qui est corrompu: attitudes, pensées, situations non conformes, donc anormales. Le refus de ce qui est, au nom de ce qui devrait être, est, à n’en pas douter, la forme constante de l’homme du ressentiment n’arrivant pas à se débarrasser de la hantise du péché adamique.
Il n’est pas nécessaire d’être un grand clerc en psychologie pour rappeler que ce mépris de la vie n’est que la manifestation inversée d’un mépris de soi. Et il est frappant de voir que l’arrogance de ces divers « commissaires » (journalistiques, académiques, politiques) masque mal une profonde misère existentielle. C’est chose connue, le dogmatisme est, toujours, une prothèse pour ceux qui ne sont pas sûrs d’eux. L’agressivité, en quelque domaine que ce soit, est bien une attitude infantile ne pouvant se poser qu’en s’opposant. Les militants de quelque cause que ce soit sont, toujours, des impuissants narcissistes ayant besoin du regard de l’autre pour assurer leur existence. Et c’est parce qu’ils sont centrés sur eux-mêmes que les protagonistes de l’opinion publiée sont bien incapables d’être attentifs aux forces volcaniques souterraines remuant, en profondeur, le corps social, et qui à l’occasion ne manquent pas de percer la croûte terrestre. Pour cela il faut savoir se purger de ses certitudes, s’éveiller à ce qui est Réel ou, pour le dire à la manière imagée de Platon (République, 521, C) : «retourner l’huître». C’est-à-dire faire une révolution du regard sachant repérer le lieu où les mots, les actions et les choses sont en concordance opportune. C’est-à-dire non pas une justice, a priori, quelque peu abstraite et en tout cas moraliste, mais une justesse a posteriori permettant de s’accorder, tant bien que mal, au monde tel qu’il est, et aux autres pour ce qu’ils sont. Le bruit de fond du monde semble dire : «cause toujours, tu m’intéresses»! Ou encore «ça rentre d’un côté et ça sort de l’autre ». En bref, les élites sont déconsidérées, et ce parce qu’elles n’ont pas su exprimer, représenter, cristalliser (ce qui est, pourtant, la vocation première de toute élite) les préoccupations et le souci du tout venant.
C’est en ce sens (ainsi que je l’ai indiqué, ainsi qu’il faudra le redire) que les protagonistes de la bien-pensance contemporaine, les obsédés du «correctness» et du «normal», sont essentiellement les héritiers attardés d’une modernité caduque. Puis-je ici rappeler, avec un brin d’ironie, que ce n’est qu’en 68, en 1868, que le terme de «modernité» s’institutionnalise (une première occurrence apparaissant en 1848).
Le «canada dry» théorique
Edgar Morin se voyait reprocher sa sociologie qualitative par l’école bourdivine qui découvrit les méthodes non quantitatives et notamment les plongées dans le « terrain » vingt ans plus tard. Baudrillard fut longtemps qualifié d’essayiste, même si ses analyses sur la perte de l’échange symbolique sont largement pillées maintenant. Les analyses de la postmodernité, c’est-à-dire celles qui tentent de déchiffrer dans notre société contemporaine le changement de valeurs et donc d’épistémè, n’ont pas été prises en compte à l’époque où J.F. Lyotard écrivit son livre fondateur. Il en fut de même à mon niveau, qui fut plutôt moqué quand je montrais le retour de la société hédoniste (L’ombre de Dionysos, 1982), le phénomène d’une diffraction de la société Nation en tribus et le glissement de l’individu UN (propre à la modernité) vers la personne plurielle (caractéristique de la postmodernité) (Le temps des tribus, 1988), l’émergence d’une Raison sensible (1996). Il en fut de même Du Nomadisme (1997) et autres analyses prospectives que ceux qui m’en firent procès à l’époque réescomptent sans vergogne. G. Vico parlait de la «boria dei dotti», que l’on peut traduire ainsi : la morgue des «sachants». C’est-à-dire ceux qui ont oublié que la science est la connaissance des fondements. Un savoir principiel, essentiel. Et qui, du coup, ne sont mus que par leurs convictions, leur «militance», leurs opinions personnelles. Mais la «doxa» est-elle encore une connaissance généralisable?
On voit ainsi resurgir des thèmes des années 60, des revendications égalitaires et laïcardes tout à fait fermées aux mutations sociétales en cours. D’où l’incapacité qu’ont les intellectuels, mais aussi les politiques et les journalistes à voir combien notre modèle national assimilationniste est en difficulté et comment à hurler sans cesse au communautarisme, on laisse aux groupes les plus extrémistes, fondamentalistes religieux ou politiques le soin de proposer ces solidarités de base, ces échanges tribaux qui sont le seul ciment d’une société. Mais, pour cela, et contre les divers conformismes du dogme établi, il faut savoir se démystifier des démystifications on ne peut plus mystifiantes. En effet, les théories de l’émancipation (celles de la « démystification ») sont au fondement même du «modernisme» élaboré tout au long du XIXe siècle. Et c’est cette posture intellectuelle qui constitue la doxa contemporaine. Le «correctness» sous ses diverses manifestations consistant à ne penser le lien social qu’en fonction du paramètre rationnel, voire à partir d’une conception rationaliste. Et c’est être « incorrect » que de rendre attentif à la puissance du mythe, à l’importance de l’imaginaire et au retour, sous ses formes multiples de l’émotionnel comme élément structurel de l’être-ensemble.
L’opéra – bouffe du politique
La dichotomie raison / passion, esprit / vie n’est plus de mise. Mais c’est bien un penser passionné qui tend à prévaloir. D’où la nécessité de mettre en œuvre un agir du même ordre. Il y a, bien sûr, de l’exagération dans les qualificatifs employés, mais l’administration préfectorale en France est, à bien des égards, la quintessence de la providence venue du haut. Son pouvoir, certes, est amoindri, mais dans l’esprit des élus, tous bords politiques confondus, le préfet joue le rôle antique de la «fons perennis», la source éternelle des bienfaits du Dieu tout-puissant. Ce qui suscite fascination et sidération. Vestige des temps anciens en des temps nouveaux, il est un frein inconscient à toute initiative venue du bas. Ce qui correspondrait bien à la «topique» postmoderne par excellence : l’horizontalité. On attribue à A. Gramsci une heureuse formule délimitant bien la double polarité dont il vient d’être question : « pessimisme de l’intelligence et optimisme de la volonté ». Nombreux sont les politiques, de tous bords, qui usèrent et abusèrent de la formule. En comprenaient-ils bien le sens? Homme d’action et de réflexion, Gramsci a illustré, bellement, l’expression « d’intellectuel organique».
Enraciné dans la culture sarde qui était la sienne, notre politique-philosophe voulait ainsi traduire le fait que c’est en étant enraciné dans une manière d’être et de penser (c’est cela la culture) que l’on peut être à même d’en saisir la dynamique, la force interne, la rotation en spirale. Et ce à partir du caprice des vents ; autre manière de rappeler l’importance des atmosphères mentales, celle des imaginaires sociétaux.
A quand des « génies » politiques, dans le sens que j’ai donné à ce terme: ceux qui personnifient une collectivité, qui cristallisent ses aspirations profondes ? C’est à partir de ces aptitudes que le politique, plutôt que de répéter sempiternellement les litanies des valeurs modernes, saura dire l’épopée postmoderne qui, souterrainement, taraude le corps social. Et par là, en phase avec l’atmosphère du moment, pourra rappeler qu’au-dessus d’une réalité rabaissée à la chose économique, il y a le champ des possibles : le «Réel» en son entièreté.
- Ecrire un commentaire
- Commenter