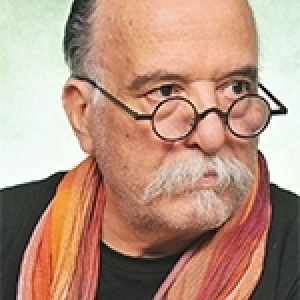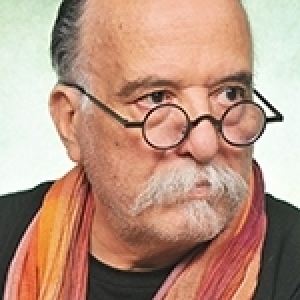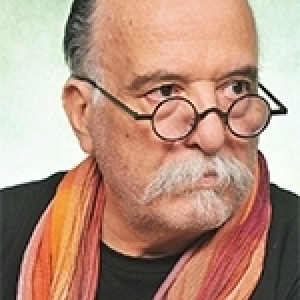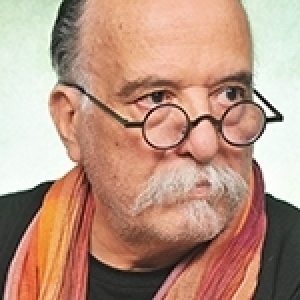Réforme universitaire: pour quand les états généraux?

Une question qui revient toujours en surface chaque fois qu’il s’agit de réforme de l’enseignement supérieur en Tunisie, est celle des raisons qui condamnent nos institutions universitaires à occuper les derniers rangs des classements mondiaux.Les avis fusent à ce propos et les commentaires remplissent les colonnes des journaux et les tribunes de la presse en ligne.Universitaires, journalistes et chroniqueurs rendent souvent des témoignages préoccupants sur l’état et le devenir de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans notre pays. Tous ne tarissent pas non plus sur les propositions et les suggestions d’idées de réformes qui vont de l’autonomisation à la privatisation des universités, de l’intensification de la pédagogie numérique à l’appui à la qualité universitaire par la révision du LMD etl’alignement sur les référentiels internationaux. Leuridée à tous est de contribuer à éclairer les ayant-droits sur des formes de dysfonctionnement observées ou vécues, chacun selon son expérience à l’intérieur ou en rapport avec nos institutions universitaires. Seulement, par les temps qui courent, il y a peu de chance que les ayant-droits puissent avoir une marge de manœuvre confortable pour remettre les pendules à l’heure. Le mal a déjà pris dans nos institutions au point que la volonté politique, les mesures juridiques ou les solutions logistiques ne suffisent plus à elles seules pourapporter une solution rapide et efficace. A mon sens, il faudrait chercher le cœur du problème ailleurs, plus précisément dans le facteur humain, en nous-mêmes, dans notre mentalité collective, émotive,entachée d’un égocentrisme et d’un égoïsme primitif que beaucoup ont du mal à admettre et à contenir, un « mal dominant » qui gangrène notre société et dont l’université comme carrefour social n’est pas épargnée.
Notre société est dangereusement menacée par une mentalité endémique de planque carriériste, de laxisme administratif, de solutions faciles et de profit immédiat, de paresse intellectuelle et de négligence culturelle. Bref, d’une anarchie exubérante quasi institutionnalisée dans certains domaines.Trop sombre le portrait sans doute, mais on en distingue les signes de façon plus perceptible depuis le phénomène de foire politique auquel nous assistonsdepuis cinq ans, à l’absentéismeet le dysfonctionnement administratif que nous observonsdans plusieurs services publics, jusqu’aux feux rouges que nous voyons griller en toute insouciance, auxmégots de cigarettes que nous piétinonssur la voie publique. Ne sont là que quelques indicateurs d’une crise éthique et civiquequi envahit notre espace social, culturel et économique. L’université subit cettecrisesociétale de plein fouet sans trop savoir comment s’en prémunir puisqu’elle porte en son sein la source de ses propres maux.
Les maux de l’université tunisienne
Rappelons de prime abord qu’on évitera dans les propos suivants le piège de la généralisation puisqu’en mettant le doigt sur les maux qui rongent l’université tunisienne, cela n’exclut en rien ses mérites de longue date et sa capacité à se remettre d’aplomb. Nos illustres académiciens, penseurs, intellectuels, scientifiques et artistes sont la preuve tangible de son potentiel ingénieux et créatif. Il n’empêche que c’est dans la critique constructive et la dénonciation des abus, plutôt que dans les éloges et les louanges stériles,que se conduisent les grandes réformes. Aussi, tous les égards sont dus aux forces vives du pays et de l’universitéen particulier, car il en existe encore suffisamment pour avoir de l’espoir dans l’avenir.La situation de l’université n’est pas désespérante à en juger par les performances, les prix et les distinctions par lesquels des chercheurs tunisiens brillants sauvent l’honneur d’une institutionen crise. La maison produitencore son élixir de jouvence mais elle devraits’en servirtrès rapidement pour colmater ses fissures et retrouver son lustre d’antan. Car les exploits exaltants de chercheurs tunisiens, à l’interne comme à l’externe, n’empêchent pas de croire que l’université tunisienne glisse lentement vers un modèle éducatif élitiste et restrictif. Elle devient de plus en plus une fabrique d’individualités et d’exceptionnalités au milieu d’une banalisation massive d’étudiants voués à des métiers de planque et de salaires de fin du mois, sinon à rehausser tout bonnement les chiffres du chômage technique comme nous le voyons en ce moment dans le problèmedes chômeurs diplômés.
Là aussi, beaucoup restent envoutés par le sacre du quantitatif et de l’égo collectif indigné de voir autant de chômeurs diplômés s’installer en marchants de poulets ou en bergers transhumants ur le mont Chaambi. Peu sont ceux qui regardent le fond du problème depuis l’angle des compétences acquises à l’université et des opportunités qu’elles procurent pour un recrutement rentable pour les entreprises et les services publics. Lesréférentiels-métiers et la professionnalisationdes diplômes sont deux sujets critiques pour l’économie du pays. Il faudrait nécessairementles réexamineren profondeur à partir des liens intrinsèques entre l’offre et la demande, la formationet l’employabilité, l’université et le marché de l’emploi. Il faudrait surtout agir avec plus d’audace, de fermeté et de constance pour identifier les défaillances et les réparer. Puisque toute réforme dérange par nature, c’est dans l’audace des décisions et la rigueur de leur mise en applicationqu’une réforme universitaire peut prendre du sens.C’est aussi dans la concertation et le débat avec les acteurs concernés qu’elle peut avoir du succès.
Le présent témoignage s’inscrit à juste titre dans l’optique de soulever quelques formes de défaillance et quelques zones de dysfonctionnement aussi impromptues et fortuites qu’elles puissent paraître. Leur dénonciation empêcherait qu’elles s’amplifient et s’éternisent. On sera doncamené ici à faire plus de critiques que de paroles obligeantes par simple logique de disputation ou de débat contradictoire dans lequel l’impartialité sera certes de rigueur, mais elle n'exclura pasdes fois la fermeté des propos.
L’université dans le virage du renouvellement générationnel
Aujourd’hui, l’université tunisienne est prise en main dans ses deux composantes humaines essentielles (enseignants/étudiants) par le produit d’une période qualifiée d’appauvrissement scolaire et éducatif profond qui a duré les 23 ans de l’ancien régime.Beaucoup d’analyses et de commentaires convergent vers cette observationquasi consensuelle. Quand on sait que la durée moyenne d’une génération humaine correspond régulièrement au cycle de renouvellement d’une population adulte apte à se reproduire, à savoir environ 25 ans, les 23 années de l’ancien régime correspondent parfaitement à la duréenécessaire pour qu’une génération entière évolue d’un âge d’apprentissage à un âge d’enseignement. L’appauvrissement du système éducatif pendant ces 23 ans aurait ainsi touché toute une génération dont la plus ancienne tranche d’âge compose aujourd’hui l’essentiel du corps enseignant et la plus jeune constitue toute la population d’apprenants. Les deux catégories forment aujourd’hui la masse critique de l’effectif éducatif dans les écoles primaires, les lycées et les universités.On l’aurait donc compris : un renouvellement générationnel dans notre système éducatif est en marche et l’on devrait attendre logiquement un autre quart de siècle avant d’avoir de nouveau une qualité viable du potentiel éducatif national. Trop pessimiste ? Peut-être, mais un choix a été fait pour rester du « côté obscur de la force » afin depimenter le débat et lever des lièvres pour mieux les tirer ! Mais au fait, en quoi consiste cet appauvrissement scolaire tant déblatéré et calomnié et comment l’argumenter?
Pour tenter d’y répondre, il faudrait sans doute des heures de diagnostic d’experts sociologues, psychologues, historiens, pédagogues, etc. Mais contentons-nous ici d’aborder juste quelques notes discordantes du paysage universitaire. Rappelons à ce propos qu’il ne s’agira pas de dresser un réquisitoire général quand il s’agit de soulever des abus dans lescomportements ou des incohérences dans les décisions, car l’université tunisienne hérite, redisons-le, d’une élite jeune et efficace, sans oublier les mandarins encore en exercice ou en éméritat, des pointures diplômées de l’école des Chartes, la Sorbonne, Harvard, Berkeley ou Oxford quipréserventà l’université son lustre d’antan. En revanche, il existeraitaussi un malaise partagé à l’intérieur comme à l’extérieur du périmètre universitaire, jeunesse comprise,à propos de la dégénérescence du niveau scientifique, culturelet intellectuel dans les rangs des étudiantsd’aujourd’hui. C’est sans doute à l’image du degré d’acculturation de la société en général si l’on tient compte des derniers sondages réalisés pendant la foire du livre en mars 2016 selon lesquels 75% des sondés ne possèdent pas de livres chez eux et 82% n’ont acheté aucun livre les 12 derniers mois. La culture de l’écran l’aurait emporté sur les méthodes classiques de l’accès à la connaissance, pourraient bien l’expliquer certains. Or, on en douterait si l’on croit lestémoignages qui viennent réfuter cette thèse. Wejdene Khalladi, enseignante à l’ISG de Tunis, a commenté sur les colonnes du journal le Temps du 9 avril 2016 : « le niveau des étudiants sur les plans cognitifs, linguistiques et même en recherche scientifique, a subi une détérioration progressive en plus de leur échec qui a contribué à l’émergence d’un grand nombre de cas de tricherie, ceci a comme conséquence une baisse du niveau scientifique, culturel et social ». Ce témoignage accablantqui provient de l’intérieur du système n’est malheureusement pas le seul à nous mettre à mal par rapport à notre idéal de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique !
L’université en perte de repères
En effet, il est regrettable de constater que nous nous éloignons d’une université tunisienne d’avant les années 90 quand des étudiants se déplaçaient volontairement et en nombre,d’une faculté à une autre,attirés par des cours magistraux d’un Sassi Ben Hlima, d’un Mohamed Yaalaoui, d’un Khalifa Chater ou d’un Abdelwahab Bouhdiba, pour ne parler que des sciences humaines et sociales. Pour dire les choses plus âprement, c’est devenu la « foire aux cancres », par emprunt du titre du pamphlet qu’a écrit Jean-Charles en 1962 sur l'Éducation en France. A l’université, les impairs de tout genre sont désormais monnaie courante : des perles en langue à en perdre son latin, des bourdes en connaissances rudimentaires à s’en tirer les cheveux, des comportements immatures à se croire en crèche…Sans vouloir généraliser (on ne cessera de le rappeler), il s’agit bien d’étudiants sur les bancs de nos universités ou de jeunes enseignants affectés dans nos lycées sans parler des cas d’enseignants-chercheurs revenus à l’université après avoir bâclé une thèse (ou promis d’en soutenir une), sans aucune qualification pédagogique pour enseigner ni même un passage professionnel minimum pour assurer des travaux dirigés adaptés. A ce sujet, il est un point que même le ministère de l’enseignement supérieur reconnait, celui du manque important d’enseignants-chercheurs dans certaines disciplines au point de continuer à recruter des assistants (corps pourtant voué à disparaître)sur de simples promesses de soutenance de thèses. Une attestation d’avancement de travaux,au risque d’être fictive,pourrait parfois suffire !L’université continuerait aussi à accueillir à bras ouverts des thésards rentrés de l’étranger (notamment de France) sans que les comités de sélection soient très regardants sur la qualité scientifique ni les mentions obtenues. En Europe, la compétition aux postes à l’université est très rude. En France, il faudrait décrocher au moins une mention « Très honorable » et une qualification nationale pour prétendre au poste de maître de conférences (équivalent au maître-assistant en Tunisie). On sait très bien aussi qu’ungrand nombre de thésard sà l’étranger ont comme priorité de devenir des enseignants-chercheurs dans leurs pays d’accueil. Les comités de sélection dans les universités européennes le savent aussi et,dans un non-dit malicieux mais pourtant légitime, appliquent une règle de vigilance aux mentions qualifiantes pour éviter le recrutement de candidats ordinaires sans potentiel académique viable.
En revanche, l’université tunisienne lesrécupères ans vérifier leurs réelles qualifications au métier de l’enseignement et de la recherche.Des thésards de gamme moyenne, sans réels projets scientifiques ni visions de recherche,parviennent ainsi à s’incruster, voire à occuper des postes de responsabilité au risque de constituer au fil du temps une « armée mexicaine » de chefs de départements, directeurs d’études, chefs de laboratoires et directeurs/présidents d’établissements.Qu’on ne s’étonne pas alors que la fonction d’enseignant-chercheurdevienne la belle au bois dormant, convoitée non pas pour ses charmes scientifiques ni sa beauté intellectuelle et culturelle,mais plutôt pour sa conquête facile (complaisance, copinage et clanisme entrant de plus en plus dans les critères de sélection), pour sa douillette planque dorée (vacances, image sociale),pour ses faveurs (parmi les meilleurs émoluments de la fonction publique), pour ses jardins secrets (ses revenus para-professionnelsnon déclarés), etc.Il y aurait donc une hypothèse largement partagée que le profil,disons ordinaire,de beaucoup d’enseignants universitairesserait devenu au fil du temps l’un des facteurs de l’appauvrissement du niveau pédagogique et de la recherche scientifique au sein de l’université tunisienne.Ce n’est pourtant pas l’unique hypothèse, puisque le problème linguistique par exemple est lui-aussi très désigné !
L’appauvrissement linguistique et l’échec de l’arabisation
Le problème linguistique prend ses sources dans l'arabisation hâtive qui a atteint son apogée dans les années 1980avec Mohamed Mzalialors ministre à l'éducation nationale. Trente années plus tard, nous en vivons encoreles séquelles : sans une bonne maîtrise du français comme langue d’enseignement des sciences et des techniques, beaucoup parmi ceux qui ont vécu cette arabisation massive, n’ont pas pucompenser dans la langue arabe.Du coup, ils se sonttrouvés doublement handicapés. Il suffit juste d’entendre parler français un universitaire ou un haut cadre de la génération dont-on a parlé précédemment, ou d’écouter un politicien de la même génération bégayer un arabe littéraire approximatif sur un plateau de télévision pour se rendre compte du profond déficit linguistique qui a marqué à un moment donné la jeune histoire de notre système éducatif. L’explication est toute triviale : dans le glissement générationnel évoqué précédemment, les élèves qui ont vécu cette arabisation précipitée, sont devenus les enseignants d’aujourd’hui. Ils forment à leur tour les enseignants de demain. Le déficit linguistique se retransmet ainsi de façon cyclique. Il nécessiteraitau moins une génération entière pour être corrigé. Avec un anglais envahissant le monde des affaires, des sciences et des techniques, très peu d’enseignants-chercheurs à l’université se repositionnent par rapport à cette nouvelle donne linguistique. Mais qu’à cela ne tienne, diraient certains ! Pourquoi perdre du temps à apprendre d’autres languesalors qu’on a encore du mal avec celles qu’on utilise déjà ? Autrement, pourquoi le faire tant qu’on n’y est pas obligé ? Vivement la planque et l’avancement systématique des échelons dans l’attente d’une opportunité meilleure pour sauter de grade ! Rappelons à ce titre que l’Algérie a connu, elle-aussi,les revers d’une arabisation précipitée et massive depuis les années 70. Au Maroc, « Le roi siffle la fin de l’arabisation de l’enseignement et réhabilite le français » lit-on sur les colonnes de l’African Manager du 26 février 2016. « Les autorités marocaines ont décidé de renouer avec le français, notamment pour les mathématiques, les sciences naturelles et les sciences physiques. Une position dictée par le pragmatisme au regard de l’impasse dans laquelle a mené l’arabisation de l’enseignement ».
On a souvent entendu des voix contestataires traiter« d’orphelins de la Francophonie » les partisans de la pluralité linguistique. Pourtant, c’est inévitablementdans l’ouverture aux langues et aux cultures du monde que l’on pourrait inscrire l’université tunisienne dans le courant de la modernité scientifique et culturelle et en faire un partenaire actif dans la migration vers une société du savoir et des connaissances partagées. C’est par un travail préalable de modernisation de la langue arabe et de sa réadaptation aux sciences et aux technologies modernes qu’on pourrait prétendre à un enseignement scientifique et technique en langue arabesans écueils. Le contraire serait du pur populisme et d’un nationalisme absurde et dépassé, car comment y parvenir alors que la langue arabe n’est pas encore fonctionnelle dans de nombreux champs de recherche comme la médecine, la physique, l’informatique et les maths ? Comment s’y prendre lorsque des concepts scientifiques et techniques modernes n’ont comme termes d’usage que des formes arabes translitérés ? Comment s’y prendre alors qu’entre Maghreb et Machreq, les divergences terminologiques et sémantiques en langue arabe littéraire sont profondes et qu’au lieu d’une seule académie de langue arabe, il en existe plusieurs ? Problème épineux et complexe ! J’en témoigne compte tenu de mon expérience de coordinateur d’un groupe de travail sur l’harmonisation de la sémantique des technologies éducatives au sein de l’Organisation internationale de normalisation.
L’abaissement du niveau scientifique
Le bouleversement linguistique qu’ont vécu la grande majorité d’étudiants qui ont passé d’une scolarité exclusivement en arabe littéral jusqu’à l’obtention du baccalauréat, à des études supérieures principalement en français, comme le système éducatif tunisien l’autorisait, n’est pas sans avoir des conséquences sur le niveau scientifique et intellectuel général de l’université. Cet état de fait justifierait du niveau médiocre de beaucoup de thèses et de publications scientifiques qui, exceptions faites, pourraient à peine compter dans la production scientifique de leurs propres institutions. Ils sont des cas où les performances d’étudiants brillantsmettent à nu l’incompétence deleurspropres enseignants. Ils sont des cas où des énoncés desujets d’examenssont remplis de fautes. Beaucoup ontsans doute connu des collègues qui enseignent faux ! Oui, qui transmettentdu scientifiquement incorrect. Il est très commun que des enseignants font de leurs propres thèsesleursuniques manuelsde cours ou qui campent sur des supports de formation jamais mis à jour. Ne parlons pas de ceux qui ne produisent plus rien dès qu’ils sont titularisés (planque oblige !) ni des contractuels de l’amiable qui honorent à peine leurs dus horaires.
Le vrai problème de l’université c’est quand des formes de dysfonctionnementse perpétuent et que des aspects de dérive s’institutionnalisent peu à peu sur un fond de clientélisme clanique dans lequel on recrute selon des alliances et des critères qui ont très peu à voir avec les compétences et les profils recherchés. L’université tunisienne,reconnaissons-le sans avoir froid aux yeux, couve des incompétences qui s’installent dans le confort de la planque dorée, et donc ne se risqueraientà aller nulle part ailleurs.Sans mécanismes d’incitation à la productivité, à la qualité scientifique et à l’évaluation par les paires, on peut s’imaginerle résidu improductif qui s’accumulerait au fil des années. On s’interroge parfois à ce sujet sur l’absurdité de la lourdeur administrative et de la dictature des diplômes qui permettent d’avoir des incompétences à l’université (juste pour avoir eu la chance d’entamer une thèse) alors que de hautes compétences stagnenttoute leur vie dans l’enseignement secondaire bloquées par une règlementation prohibitive qui les empêchent de progresser.
Comme un mal ne vient jamais seul, le recrutement et la titularisation en masse d’enseignants du supérieur réalisés sur les deux années 2012 et 2013, ont porté le coup de grâce à une université déjà en mal de productivité. Cela n’a fait qu’accroitre les rangs des chasseurs de planques et mettre en difficulté toute intention de rénovation pédagogique et de recherche,déjà mise à mal parune attitudedevenue dicton : « je fais mes heures et je me casse ». A quoi bon perdre son temps à faire de la recherche ou à se recycler en pédagogie universitaire lorsque d’une part on n’y est pas obligé, et d’autre part il est plus payantd’être un chasseur de primes en accumulant les heures supplémentaires, en passant des contrats de consulting avec les entreprises(tant que la loi le permet sans filtrer les abus) ou en assurant assurer des formations avec des bureaux d’études et être payé au comptant? Pourtant, il suffirait de revoir le statut d’enseignant-chercheur pour y introduire de façon rigoureuse les quotas des trois tiers entre enseignement, recherche et administration. Ce serait une moindre mesure pour faire la chasse aux « planquistes » et prévoir, en l’absence d’inspection pédagogique, des méthodes d’incitation à la révision des modèles didactiques.
L’obsolescence du modèle pédagogique
L’un des paradoxes de l’université (non seulement tunisiennefaut-il le reconnaitre) est le passage direct d’un primo-impétrant aux tâches d’enseignement sans jamais avoir reçu de formation sur la pédagogie universitaire. Il est déjà antinomique que le recrutement pour enseigner au supérieur soit souvent mesuré à l’aune de critères de la recherche scientifique (thèse, colloques & articles publiés). Il est encore plus grave que la pédagogie à l’université demeure arbitraire, conduite au pif, à l’humeur et au choix improviséde l’enseignant. C’est souvent dans une reproduction spontanée, basée fondamentalement sur son expérience scolaire du secondaire et à l’université,que le primo-enseignant va chercher son modèle pédagogique pour enseigner. Et c’est justement là que la dérive pédagogique devient dangereuse. Car d’un enseignement secondaire généralement transmissif (qu’il faudrait également réviser), l’université,naturellement supposée approfondir l’esprit critique, l’autonomie réflexive et la logique de la controverse, se trouve en train de reproduire le même modèle passifque transmet une génération à une autre. Dans certains milieux de l’université tunisienne, on parle encore de polycopiés, d’emprunt et de reproduction de support de cours, de plagiat en masse de l’Internet... On imaginerait mal la réaction d’un enseignant ou d’un étudiant à qui on demanderait d’appliquer et de suivre lemodèle de disputatioet de lectio, des méthodes d'enseignement et de rechercheainsi qu'une technique d'examen omniprésentes dans les universités depuis le début du XIIIe siècle.Les étudiants, et aussi une bonne part des enseignants-chercheurs, ont besoin plus que jamais de développer un esprit rationnel critique et un sens plus aigu de l’argumentaire et de la rigueurscientifique auxquels très peu auraient éventuellement été formés.Dans un rapport des Nations Uniesintitulé ArabHumanDevelopment,publié en 2003, on insiste sur le fait que « les curricula enseignés dans les pays Arabes semblent encourager la soumission, l’obéissance et la subordination plutôt que la pensée critique libre»(PNUD, p. 53, 2003). Dans une étude sur l’éducation et l’enseignement dans les pays en voie de développement DavidKember (Ed. Abingdon 2007)souligne le fait que les étudiants de ces pays sont mal préparés à un mode d’apprentissage qui exige un haut niveau d’autonomie et la capacité d’apprendre sans la présence de l’enseignant ou d’autres apprenants. Nos universités fonctionneraient encore au rythmed’une pédagogie obsolète etanti-productive.
Appel à des états généraux pour transgresser les blocages et sortir de la crise
En somme, dans le flou d’une vision stratégique globale sur le long terme pour un enseignement supérieur compétitif, de qualité et de compétences innovées, l’université resteral ivrée à elle-même, aux rivalités claniques, aux individualités et à l’incohérence des décisions.La démocratisation de l’université passe aussi par l’écoute aux objections et aux contre-arguments de sorte qu'il pouvait s'établir un véritable débat d’idées et de méthodes. L’université a aussi besoin de faire sa propre introspection, de revoir et évaluer ses propres processus de fonctionnement et d’aller en profondeur dans ses analyses de qualité.Car, aujourd’hui encore, les jolis graphes et tableaux qui agrémentent les rapports et études sur l’état de l’enseignement supérieur en Tunisie restent essentiellement quantitatifs et vont rarement à la recherche de critères d’originalité, d’inventivité, d’innovation, d’employabilité, de rentabilité, d’excellence scientifique et de modernisation pédagogique. Des projets d’appui à la qualité (PAQ) sans valeurs-ajoutées d’envergure, un programme de réforme LMD sans moyens de mobilité régionale, de nouvelles filières sans fort impact d’employabilité, de nouvelles institutions universitaires dans les régions sans réelle décentralisation… Voilà en gros le bilan d’innombrables réformettes (ainsi les désigne Rafâa Ben Achour dans Leaders.com le 28.1.2016) qui ne découlent d’aucune vue globale fondée sur une réelle démarche qualité et une refonte totale des paradigmes de la gouvernance universitaire, mais plutôt d’une agrégation de points de vues et de propositions aléatoires,fortuites,captées dans des réseaux d’influence, alors que les vrais enjeux sont à débattre publiquement dans de véritables assises démocratiques d’états généraux universitaires. Or, vue les divergences historiques entre les syndicats d’étudiants tiraillés dans des guerres de chapelles politiques, le syndicat de l’enseignement supérieur braqué sur les revendications sociales et professionnelles, les groupes communautaires et les organisations de la société civile très peu familiarisés à ce type de procédures, on voit mal de quelle partie prenante partirait un appel ferme et irrévocable pour organiser ces états généraux tant attendus!A bon entendeur bon suivi!
Mokhtar Ben Henda
- Ecrire un commentaire
- Commenter

Très pertinente analyse de la situation de notre université. Pour le tunisien la faute est toujours à l'autre, à l'étudiant pour l'enseignant et à ce dernier pour l'étudiant et aux deux pour l'administration (aucune autocritique ni remise en cause de soi même).

Cet article soulève des questions pertinentes et souligne la nécessité d’une auto-évaluation que doit effectuer l’Université tunisienne pour sortir de sa léthargie et améliorer son rendement et son image à l’échelle internationale. Certes des facteurs exogènes (arabisation, carcan administratif, instauration du système LMD etc.) ont contribué à la dégradation du niveau, mais, comme l’a souligné l’auteur, le facteur humain reste « le mal dominant ». Ce mal a vu le jour dès les premières années de tunisification du cadre enseignant à l’Université (milieu des années 70) et a bénéficié de l’absence de contrôle héritée de l’Ecole française. En effet le niveau actuel des étudiants et des jeunes enseignants est le résultat de la formation dispensée par la première génération d’enseignants qui ont envahi les estrades des amphis pour participer à la tunisification des cadres enseignants. Cette génération, dont je fais partie, n’a pas été recrutée sur les critères de compétence scientifique et/ou pédagogique, mais sur simple diplôme, en l’occurrence le Doctorat d’Etat. Certains collègues en chimie par exemple ont même commencé à enseigner en amphi avant de soutenir leur Doctorat. Ce manque d’expérience de la première génération d’enseignants a donné lieu à toute sorte de comportements. Il y a eu ceux qui se sont battus pour construire les bases scientifiques de l’Université, et ont essayé cahin-caha de former les premiers noyaux qui sont devenus ensuite des Unités ou des Laboratoires de recherche ayant pignon sur rue dans leur spécialité. Mais il y a eu aussi des opportunistes et des « plaisantins ». Par exemple certaines nouvelles recrues se sont agitées au début pour faire soutenir une thèse ou quelques DEA, nécessaire(s) pour passer au grade supérieur, puis, profitant de l’absence de suivi et d’évaluation, ont adopté une « attitude de planque », se contentant d’assurer les cours sans se soucier de l’avenir de l’Université c-à-dire sans se donner la peine de former du personnel susceptible d’assurer la pérennité de la spécialité, c’est le cas des spécialistes de chimie théorique à la FST, par exemple. Sur le plan pédagogique, on apprend de plus belles à partir de témoignages d’anciens étudiants. Le cas frappant est celui d’un enseignant qui a toujours traité les étudiants de cancres et leur collait des notes ne dépassant pas 8/20, et cela a duré pendant des décennies sans que personne ne lève le petit doigt et sans que l’intéressé ne se soit posé la question sur la pertinence de ses méthodes d’enseignement. Un autre cas qui mérite d’être relaté est celui d’un professeur de chimie qui se croyait au dessus du commun des mortels et dispensait ses cours en dictant des phrases traduites sur le volet à partir de documents anglais qu’il étalait sur le pupitre dès le début de la séance, ce faisant il était incapable de se remémorer le contenu des précédentes séances. Et gare à l’ étudiant(e) qui ose demander une explication. D’autres encore se contentaient d’enseigner les banalités de la discipline et se rattrapaient en gonflant les notes pour étouffer toute contestation de la part de étudiants. Face à l’absence de contrôle, bien d’autres dérives ont perduré pendant des décennies et ont contribué à l’abaissement du niveau de générations d’apprenants dont la plupart ont été appelés après la maitrise à enseigner au Secondaire. Certes après la vague de recrutement à tour de bras, des critères de sélection des Maitres de Conférences se sont installés progressivement, mais, comme l’a souligné l’auteur de l’article, basés principalement sur la production scientifique, d’où la course aux articles dont certains résultent de stages de courte durée effectués dans des laboratoires étrangers sans souci de formation. Une nouvelle vague de ‘délivrance’ d’habilitations a vu le jour, se réduisant à une opération d’arithmétique qui consiste à décompter le nombre d’articles publiés par le candidat, sans considération du projet de recherche, ni de la manière dont ces articles ont été obtenus ou de la valeur scientifique du candidat et de sa capacité à encadrer des jeunes. Cette tendance, défendue par les syndicats, s’est accentuée sous le règne de la troïka et conduira bientôt à un corps enseignant formé quasi-exclusivement de généraux dont la plupart n’auront de compte à rendre à personne. Dans ces conditions, le redressement de la barre ne me semble pas une chose facile.