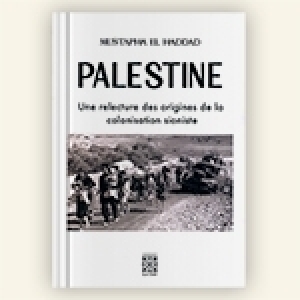Ammar Mahjoubi: Le caractère fondamentalement inégalitaire de la société romaine*

.jpg) La société romaine était constituée d’un ensemble de groupes sociaux distincts, séparés par une ligne de démarcation à dominante juridique, économique ou sociale. Chaque individu, dans la cité comme dans l’Empire, appartenait à un groupe dont les droits et les devoirs, dans la hiérarchie sociale, étaient strictement codifiés. De même, chaque groupe situait ses membres selon une hiérarchie qui tenait compte de la naissance, de la fonction et de la richesse. Pline le Jeune (Epistulae, IX, 5), à l’instar des élites politiques et intellectuelles, défend et justifie ce caractère inégalitaire, dans ces conseils à un proconsul, parmi ses amis: «En obligeant les plus honorables, tu seras aimé des petits et, en même temps, estimé des premiers (de la société)… Maintiens les discriminations liées aux ordres et aux dignités : rien n’est plus inégal que cette égalité même, qui prétend confondre, bouleverser, mélanger ces différences.»
La société romaine était constituée d’un ensemble de groupes sociaux distincts, séparés par une ligne de démarcation à dominante juridique, économique ou sociale. Chaque individu, dans la cité comme dans l’Empire, appartenait à un groupe dont les droits et les devoirs, dans la hiérarchie sociale, étaient strictement codifiés. De même, chaque groupe situait ses membres selon une hiérarchie qui tenait compte de la naissance, de la fonction et de la richesse. Pline le Jeune (Epistulae, IX, 5), à l’instar des élites politiques et intellectuelles, défend et justifie ce caractère inégalitaire, dans ces conseils à un proconsul, parmi ses amis: «En obligeant les plus honorables, tu seras aimé des petits et, en même temps, estimé des premiers (de la société)… Maintiens les discriminations liées aux ordres et aux dignités : rien n’est plus inégal que cette égalité même, qui prétend confondre, bouleverser, mélanger ces différences.»
Les plus nettes, parmi ces discriminations, étaient sans doute dues aux ségrégations juridiques. Dans un article paru en 1961 (Vie de Trimalcion, Annales ESC, 213-247), Paul Veyne avait montré que deux sociétés, juridiquement distinctes, cohabitaient dans le monde romain: d’une part celle des ingénus, c’est-à-dire des individus de naissance libre et, de l’autre, celle des esclaves et des affranchis. Une coupure profonde séparait ces deux sociétés qui, en vertu du statut juridique, n’étaient pas superposées, mais vivaient parallèlement ; chacune avait sa propre hiérarchie, la seconde copiant les classements hiérarchiques de la première, avec cependant un décalage dû à la servitude. Alors que nombre d’affranchis, ou même d’esclaves, jouaient un rôle économique, social ou administratif important, la tare servile, que n’effaçait point l’affranchissement, leur interdisait l’accès à l’honorabilité et les maintenait en marge du corps social. Par contre, bien des ingénus n’avaient guère un niveau de vie supérieur à celui de beaucoup d’esclaves ou d’affranchis, et leur poids social était inexistant, mais même classés parmi les «humiliores», ils étaient partie intégrante du corps civique, en raison de leur condition juridique.
Dans la société des affranchis et des esclaves, ces derniers étaient, selon le droit, à la fois des personnes et des objets. En tant que personnes, ils avaient un statut, mais en qualité d’outil parlant (instrumentum vocale), ils n’étaient que des biens, objets de cessions, conformément aux mêmes procédures juridiques que les immeubles et les biens-fonds. Ils faisaient partie de la «familia», terme qui signifiait aussi bien le groupe familial que l’ensemble des biens de la famille. L’affranchissement n’effaçait nullement cette appartenance, car une fois libérés de la servitude, on leur donnait le nom de famille de leurs anciens maîtres devenus leurs patrons. Le code de la morale sociale, garanti par la loi, imposait à l’affranchi un ensemble d’obligations, depuis la déférence (reverentia) due aux patrons, jusqu’aux prestations de services pendant quelques journées de travail (operae). La coutume sociale maintenait les enfants de l’affranchi dans l’orbite familiale du maître ancestral, et seul le décès du patron et de ses descendants rendait l’affranchi et sa descendance véritablement indépendants.
Dans les villes, les esclaves partageaient d’ordinaire la vie quotidienne de la plèbe urbaine ; mais leur intégration dans les groupes civiques était très restreinte, limitée à quelques collèges ; et ils pouvaient aussi bénéficier de certaines largesses, de certaines distributions collectives. Mais même affranchis, l’ordre décurional, celui des notables de la cité, leur était totalement fermé, car l’affranchissement ne leur donnait accès ni aux élections du sénat local, ni à celles des magistratures. Tout au plus pouvaient-ils bénéficier d’un décurionat honoraire (ornamenta), qui leur permettait de partager les signes extérieurs de dignité avec les «honestiores». Pour autant, certains affranchis pouvaient acquérir ascendant et influence, tel ce L. Licinius Secundus, l’affranchi d’un ami de l’empereur Trajan, auquel avaient été dédiées pas moins de vingt-et-une bases de statues. Mais nonobstant cette débauche d’honneurs, preuve de son poids social, la seule dignité qui lui était permise était celle de «sévir augustal», membre de l’ordre des «augustales», chargés du culte impérial, seule et unique voie ouverte aux affranchis pour jouer un rôle officiel dans la cité.

Seul l’empereur pouvait effacer juridiquement la tâche d’une extraction servile. Il pouvait, en effet, concéder aux affranchis les anneaux d’or, symboles de l’ordre équestre, qui leur permettaient d’être classés juridiquement parmi les ingénus, mais sans une intégration effective dans l’ordre des chevaliers, ni une abolition totale du statut d’affranchi. Les plus favorisés pouvaient aussi bénéficier de la «restitutio natalium» qui, exceptionnellement, accordait à l’affranchi une naissance libre et effaçait toute trace de son extraction servile, lui permettant ainsi de devenir, à part entière, membre de l’ordre équestre. Seuls quelques proches de la cour impériale avaient été en mesure de profiter de ce règlement occasionnel.
Quelques témoignages, parmi les plus optimistes, considèrent que l’esclavage n’était qu’une condition transitoire, dont on pouvait se libérer par l’affranchissement, au prix d’une bonne conduite. Cicéron, par exemple, écrivait: «Nous avons attendu six ans la liberté, plus longtemps que ne le font les captifs actifs et honnêtes» (Philippiques, VIII, 32). Mais à l’inverse, nous savons que l’esclavage pouvait aussi résulter, juridiquement, de la condamnation d’un ingénu ; la forme d’aliénation la plus connue, dans ces conditions, était la servitude pour dettes, «l’additio» qui était une adjudication proche de la servitude. En recevant les différents types de travailleurs agricoles, au milieu du Ier siècle avant le Christ, le rhéteur Varron cite « ceux que nous appelons «insolvables» et qui, actuellement, sont nombreux en Asie, ainsi qu’en Egypte et en Illyricum» (Varron, I, 17,2). Et même si, un siècle plus tard, l’esclavage pour dettes n’existait plus, Columelle mentionne néanmoins des citoyens «liés», travaillant avec des esclaves dans les grands domaines; offrir sa force de travail continuait donc à être le seul moyen de rembourser un prêt.
De façon générale, l’affranchissement des esclaves était plus facile dans les villes. Les textes anciens et les inscriptions montrent que la majorité des affranchis étaient des artisans, des employés de commerce ou des domestiques de la «familia urbana». Plus difficile était l’émancipation des ruraux car, pour la plupart, ils n’avaient ni culture, ni spécialisation et se trouvaient, de surcroît, dans l’impossibilité d’épargner pour se racheter. Juridiquement existaient trois formes d’affranchissement : par le cens, lorsque le maître autorisait son esclave à s’inscrire sur les listes des censeurs, les magistrats chargés des recensements; une fois inscrit, l’esclave était en passe de devenir citoyen. L’esclave pouvait aussi accéder à l’ingénuité par la procédure de la vindicte, lorsqu’il était «revendiqué en liberté» par une tierce personne et que son maître renonçait à le retenir. La troisième forme et la plus fréquente était l’affranchissement par testament du maître défunt, qui pouvait aussi, de son vivant, libérer son esclave grâce à une «manumission informelle».
Habituellement, les Romains avaient une représentation binaire de la société; et à la dichotomie entre esclaves et ingénus, s’ajoute la partition de ces derniers entre «honestiores» (les «honnêtes gens») et «humiliores» (les humbles). Par leur naissance et leur fortune, par leurs mœurs, leurs vertus et leurs caractères, les premiers remplissaient, pensait-on, les conditions pour diriger. Par contre, les humbles, appelés aussi «plebei», «tenuiores» étaient considérés, par leur naissance et leurs activités, inaptes aux responsabilités ; légitime était donc leur dépendance, tant sociale que politique. Cette vision ne pouvait induire que le mépris et la méfiance; justifier la répression la plus dure en cas de troubles et, à l’inverse, entraîner parfois un comportement paternaliste. Deux types de peines étaient prévus, à partir du IIe siècle, pour un même crime, selon le rang social des coupables : l’exil ou la relégation remplaçaient les travaux forcés pour les «honestiores», qui échappaient aussi à la torture et aux peines infamantes comme la flagellation, la mise en croix ou la gladiature. Mais alors que sous la République, ces peines étaient réservées aux esclaves et aux non-citoyens, elles furent infligées aux citoyens humbles dès l’avènement de l’Empire et, surtout, à partir du IIe siècle; irrévocablement et jamais les citoyens romains ne furent traités sur un pied d’égalité.
Deux ordres nobiliaires étaient au faîte de la hiérarchie sociale: les clarissimes, membres de l’ordre sénatorial, et les chevaliers, membres de l’ordre équestre. Les notables des cités, membres de l’ordre décurional, étaient aussi classés parmi les «honestiores», ainsi que les vétérans des légions et, à un moindre degré, les militaires. Ces ordres romains, à la différence des classes sociales, étaient des divisions définies par l’Etat et dotées, chacune, d’un statut spécifique. La participation à la vie publique était une obligation, au moins potentielle, pour leurs membres, avec une contrepartie constituée par des honneurs, des marques de dignité officiellement reconnues.
Seul l’ordre sénatorial bénéficiait d’une transmission héréditaire de son statut. Aux 600 sénateurs s’ajoutaient ainsi leurs femmes et leurs descendants en ligne masculine, sur trois générations, soit en tout, quelques milliers de personnes. Seul l’empereur pouvait donner accès à l’ordre ; mais il ne pouvait assurer l’entrée au Sénat, qui restait subordonnée à l’élection parmi les questeurs, la première parmi les fonctions du cursus sénatorial. Un cens minimum d’un million de sesterces, fixé par Auguste et jamais réévalué, était aussi exigé pour l’intégration à l’ordre, que matérialisait le port d’une tunique ornée d’une large bande pourpre (laticlave). Avec le titre de clarissime, étendu aux femmes et aux enfants des sénateurs, s’ajoutaient des privilèges : jugement par le Sénat, exemption des charges municipales dans les cités d’origine, places d’honneur dans les lieux de spectacle. Des prohibitions étaient aussi censées préserver la dignité de l’ordre, qui interdisait le mariage avec une affranchie ou une comédienne, la participation active aux spectacles…
La structure de l’ordre équestre, second en dignité nobiliaire, était différente. L’anneau d’or distinctif des chevaliers était réservé aux citoyens romains de naissance libre depuis les grands parents, et dont la fortune était supérieure à 400 000 sesterces. Il était réservé aux seuls hommes, y compris parfois des adolescents. Mais la simple possession du cens n’était pas suffisante, car l’entrée dans l’ordre relevait de la seule décision impériale et n’était pas légalement héréditaire. L’empereur pouvait également dégrader le chevalier indigne, et les prohibitions déjà mentionnées concernaient les deux ordres nobiliaires. L’appartenance à l’ordre permettait au chevalier d’orner sa tunique d’une bande de pourpre étroite (angusticlave), de disposer de sièges réservés au théâtre, mais il n’était pas dispensé, comme les sénateurs, de ses devoirs envers sa cité. Malgré les difficultés pour évaluer le nombre des chevaliers, on a proposé, pour le I er siècle, le chiffre de 20000, qui avait sans doute augmenté avec la désignation d’un nombre important de provinciaux.
L’ordre décurional, celui des notables, n’était pas situé, comme les deux ordres nobiliaires, au niveau de l’Empire. La «dignitas» du décurion s’affirmait seulement dans sa cité, et s’étendait à l’ensemble des membres, dans tous les conseils municipaux de l’Empire. L’intervention de l’empereur pouvait intercéder pour la nomination d’un conseiller municipal, qui ne ressortait cependant qu’aux cités, et à elles seules. Les marques extérieures de la dignité des «décurions», de la notabilité des conseillers municipaux, étaient la «toge prétexte», le siège honorifique (bisellium), et, les places réservées au théâtre ; ils pouvaient aussi avoir le droit à une dérivation de la conduite qui, dans la cité, distribuait l’eau publique. Cette honorabilité spécifique était étendue à leurs descendances comme à leurs ascendants, sans que le décurionat fût héréditaire.
La proportion de ces «honetiores» dans les cités était variable. Dans les petites villes, elle pouvait atteindre le 1/10 e du corps civique ; mais dans les villes moyennes, entre 15 et 20 000 habitants, leur pourcentage n’était pas plus de 2 à 3% et ils n’étaient plus qu’une infime minorité dans les grandes villes. Plus la cité était importante, plus ses notables s’apparentaient à une aristocratie locale, proche des deux ordres nobiliaires de l’Empire ; d’autant que la plupart des chevaliers étaient issus du corps décurional de leur cité. Dans leur ensemble, sénateurs, chevaliers et décurions, tous ces «honnêtes gens» étaient, semble-t-il, moins d’un million dans tout l’Empire.
Ammar Mahjoubi
* Source principale : la synthèse de François Jacques dans le manuel de la «Nouvelle Clio» sur «Les structures de l’empire romain».
- Ecrire un commentaire
- Commenter