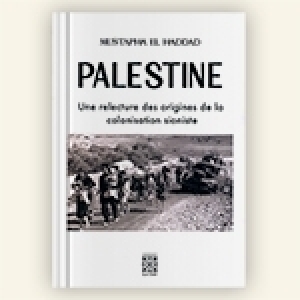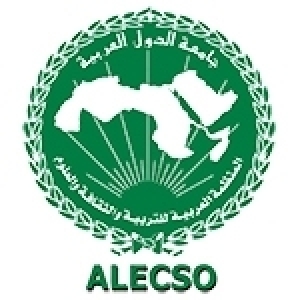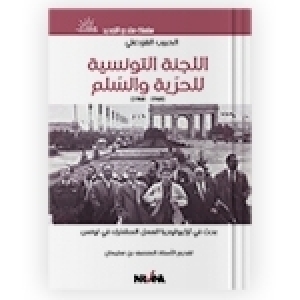Les identités multiples de la Tunisie : enjeux et perspectives

La question des identités multiples en Tunisie est un sujet de réflexion majeur qui est souvent occulté dans les débats sur le choix de type de société dans la Tunisie actuelle. La tâche n’est pas aisée. Aborder cette question culturelle dans un contexte de contestation sociale et de période de transition démocratique est conflictuel. Certes les traditions orales, les sources textuelles, la diversité des sites culturels ainsi que des collections muséales constituent des appuis à une réalité d’une Tunisie à identités multiples. Dépositaires d’une mémoire collective, aussi diverse que riche, ces témoignages nous interpellent à un moment où la Tunisie connaît une période de transition marquée par la difficulté d’opter pour un choix de modèle de développement s’appuyant sur l’égalité des chances, la décentralisation et le rééquilibrage régional.
 Mais il y a plus, le débat enclenché sur le contenu de l’article 1 de la Constitution a mis en exergue l’affrontement entre les diverses tendances marquant la scène politique tunisienne, qu’elles soient de souche traditionaliste ou moderniste.
Mais il y a plus, le débat enclenché sur le contenu de l’article 1 de la Constitution a mis en exergue l’affrontement entre les diverses tendances marquant la scène politique tunisienne, qu’elles soient de souche traditionaliste ou moderniste.
Le parcours historique de la Tunisie est édifiant. Positionnée au centre de la Méditerranée, la Tunisie a été un creuset de civilisations et de cultures, à travers ses trois mille ans d’histoire et son illustre passé préhistorique avec comme principal témoignage l’Hermaion d’El Guettar (Gafsa) considéré comme étant un des premiers sanctuaires de l’humanité . De nos jours, cette multiculturalité n’est pas encore entièrement revendiquée par la plupart des Tunisiens. La quête d’une identité plurielle, assumant à la fois le legs antique et la culture arabo-islamique, nourrit souvent les débats réservés aux cercles intellectuels de diverses tendances mais non ouverts à un large public.
Diversité ethnique et dialogue interculturel caractérisent l’état-nation en Tunisie depuis la promulgation du pacte fondamental (Ahd el Aman) par le bey M’hammed en 1857 . Ce texte novateur, considéré par certains comme une véritable déclaration des droits de l’Homme, tenait compte du brassage des populations et des cultures de la Tunisie du milieu du XIXe s. Il témoigne d’un choix du pouvoir politique de l’époque, d’une modernité de type occidental et de l’abandon de la politique d’alignement sur la Sublime Porte. Le gage donné aux puissances européennes, dites protectrices de la Tunisie, était un retour ‘‘forcé’’ de la politique de coexistence ethnique et religieuse, remise en question depuis l’époque almohade. Il s’agissait en quelque sorte d’une reconnaissance de la diversité ethnique et culturelle des habitants de la Régence de Tunis devenue au fil du temps une terre d’accueil des émigrés européens.
Ce train de mesures concernait l’abolition de l’esclavage, la liberté de la pratique religieuse, l’égalité devant la loi ainsi que l’impôt, la sécurité des minorités et la libre pratique des métiers par les étrangers vivant en Tunisie. Les puissances européennes instigatrices de cet élan moderniste, enclenché depuis le règne d’Ahmed Bey (1837-1855), étaient surtout soucieuses de garantir la libre circulation de ses sujets et de leurs biens. Leur attitude portait en quelque sorte les germes du Protectorat français proclamé en 1881. Une révolte sociale conduite par Ali Ben Ghedhahem de la tribu des Majer en 1864 et la réticence du courant traditionaliste ont entraîné la suspension de cette constitution avant-gardiste qui était en totale rupture avec les règles normatives se référant à la charia et aux coutumes ancestrales.

Toutefois, la tendance réformiste a survécu en Tunisie après cet échec d’adoption de la 1ère constitution tunisienne. Le principal instigateur de la renaissance du courant réformateur moderniste a été le Premier ministre Kheireddine, au pouvoir de 1873 à 1877. Cet homme d’Etat, qui créa plusieurs institutions publiques culturelles dont le collège Sadiki en 1875, a été l’artisan d’une réforme de l’enseignement public tunisien en vue d’une modernisation du savoir et d’une refonte culturelle au profit de la société tunisienne, dans le but déclaré de faire naître une élite tunisienne . Très proche du milieu académicien français, il a été l’initiateur d’une politique de patrimonialisation des biens culturels en Tunisie, y compris ceux de la période préislamique. Sa décision de nationaliser les biens archéologiques convoités par les collectionneurs privés (nationaux et étrangers) a été mise à exécution par l’arrêté du 29 février 1877. Dans ce texte fondamental, Al Wazir Al-Akbar chargea les autorités régionales de l’époque « de rechercher dans leurs caïdats les vestiges anciens où figurent des représentations d’animaux ou d’êtres humains, toutes statues petites ou grandes, les pièces de monnaies anciennes, qu’elles soient en argent ou un autre métal, ainsi que les pierres qui comportent quelque chose de ce genre ou des écritures anciennes ». Dans la marge de ce décret figurait une indication qui fait état de l’obligation de bien attacher à chaque objet une étiquette indiquant le lieu de la découverte . Les objets récoltés, grâce aux informations recueillies auprès des populations locales et des voyageurs européens conformément aux termes de l’arrêté ont été entreposés dans des locaux à la Qasba dépendant du Premier ministère (Dar el Bey).
Cette initiative de Kheireddine témoignant de la prise en compte par l’Etat tunisien du patrimoine culturel national dans sa globalité et sa diversité a été novatrice dans le monde arabo-islamique. Le but du recensement était de constituer des collections nationales muséographiques de différentes périodes de l’histoire du pays en vue de les présenter au public tunisien dans un haut lieu privilégié où les collections archéologiques côtoient les produits de l’artisanat tunisien. Le projet du musée national tunisien de Kheireddine était porteur d’un double message. L’appropriation de l’antiquité était associée à une mise en exergue du caractère ancestral et durable du savoir-faire des artisans tunisiens.
Le décret beylical du 25 mars 1885 a exaucé le vœu de Kheireddine, en ordonnant l’installation d’un musée des antiquités nationales dans l’ancien Palais du harem du bey M’hammed au Bardo (El Qasr Al-badii). Un département des arts et des traditions islamiques appelé musée arabe conçu par Paul Gauckler a été ouvert à la visite en 1899 dans le petit palais dit tunisien . Pendant la période du Protectorat français, le musée Alaoui a joué le rôle de conservatoire des antiquités et de vitrine du patrimoine antique de la Tunisie. La visite du musée était associée à celle de plusieurs sites antiques valorisés dans le cadre de la mise en place d’un tourisme archéologique proposé aux visiteurs de la Tunisie. Pour la plupart des Tunisiens, l’appropriation de ce patrimoine antique n’était pas d’actualité. Le musée Alaoui était qualifié par les Tunisiens de Dar el Ajaib (le lieu des étonnements). Le patrimoine présenté, en majorité antique, était inaccessible à leurs yeux et n’avait pas de lien avec leurs racines culturelles. L’exposition muséographique, proche de l’idéologie de coloration colonialiste, mettait en évidence une cassure entre l’antiquité et la période arabo-islamique. Quant aux sites islamiques bénéficiant d’une protection juridique, ils n’étaient pas valorisés et intégrés dans les circuits de visite.
Au temps du Protectorat français, cette absence de linéarité dans l’analyse du parcours historique de la Tunisie a constitué un frein à une appropriation du patrimoine tunisien dans sa globalité. Certains intellectuels tunisiens de double culture (tunisienne et occidentale) ont contesté cette vision, en mettant en exergue la richesse ethnique et la diversité culturelle de la Tunisie, tout en se réclamant d’une appartenance au monde arabo-islamique .
Après l’indépendance de la Tunisie (1956), la tendance a été renversée, avec l’émergence d’un courant optant pour une lecture rationnelle et synthétique du patrimoine tunisien, porté par une partie de l’élite tunisienne, diplômée et moderniste, en particulier les archéologues tunisiens qui ont œuvré par leurs travaux de recherche et muséographiques pour une reconstruction de l’identité patrimoniale préislamique dès la proclamation de l’indépendance tunisienne. En 1956, le musée national du Bardo (l’ancien musée Alaoui) dirigé par un jeune professeur d’histoire et de géographie, Abdelaziz Driss, a ouvert ses portes à un public tunisien large. En 1957, l’Institut national d’archéologie et d’arts (l’actuel INP) a vu le jour, avec à sa tête l’éminent savant humaniste Hassen Hosni Abdul Wahab. Les prérogatives de cette institution ont été élargies. Elles concernent l’étude, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine archéologique tunisien appartenant à toutes les périodes historiques. La première intervention sur le patrimoine financée par le budget du jeune Etat tunisien a été l’aménagement d’un deuxième étage au musée du Bardo, consacré aux collections de céramique antique et à l’exposition de mosaïques romano-africaines, découvertes dans les années cinquante (XXe s.). Quelques années plus tard, plusieurs chantiers archéologiques ont été installés sur des sites antiques tels que Kerkouane et Dougga, aujourd’hui inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Un débat sur la revendication du patrimoine archéologique dans sa globalité a été animé par plusieurs chercheurs ces dernières années. L’étude du sociologue Driss Abassi sur les discours politiques et les manuels d’histoire scolaires tunisiens pendant l’ère bourguibienne éclaire cette question . L’auteur met en évidence le flou identitaire lié à un processus historique qui remonte à la période du Protectorat français (1881-1955) où la question de l’identité nationale s’est posée avec acuité. En ce temps-là, le Tunisien qui a eu la chance d’être scolarisé était tiraillé entre le modernisme et la culture arabo-islamique. L’attachement à ses valeurs ancestrales constituait le principal outil contre l’intégration voulue par les autorités du Protectorat à travers l’enseignement et la politique de naturalisation. Après l’indépendance, le discours politique nationaliste a mis en exergue une identité tunisienne très marquée par l’idéologie bourguibienne fondée sur la légitimité de la lutte pour l’indépendance sans faire explicitement référence à un processus historique rationnel.
Depuis les années quatre-vingt-dix (XX e s.), un nouveau discours politique a été mis en place dont les principaux axes sont l’ancrage de la Tunisie à la Méditerranée et son appartenance à la culture arabo-islamique. Cette nouvelle orientation s’est développée à travers le contenu des manuels scolaires et la politique de valorisation patrimoniale. L’ambition était de contribuer à ancrer une identité culturelle tunisienne marquée par l’ouverture, l’authenticité et la tolérance. A l’évidence, cette idéologie véhiculée par les médias et les outils de propagande de l’ancien régime était destinée à rassurer les partenaires occidentaux par un affichage d’une modernité non consensuelle et par une opposition aux courants islamistes traditionalistes. Hélas, ce discours était resté théorique en l’absence de débats constructifs et d’une politique culturelle volontariste. Mais il y a plus, ce message n’a pas été assimilé par le milieu scolaire. A l’absence de moyens et d’outils pédagogiques s‘ajoute un fonctionnement tatillonnant d’une administration marquée par une centralisation excessive. Actuellement, une réflexion est engagée sur une révision des programmes scolaires relatifs au patrimoine dans le cadre d’un partenariat entre les ministères de la Culture et de l’Education nationale, dont la coordination est assurée par la commission nationale Unesco-Alecso-Isesco et l’INP.
Après la révolution du 14 janvier 2011, force est de croire que cet enjeu se trouve au cœur d’un balancement identitaire qui caractérise la société actuelle tunisienne, partagée entre le modernisme d’inspiration occidentale et l’authenticité d’essence religieuse. Il s’agit d’un débat d’actualité avec deux visions qui s’opposent. La première est celle qui s’attache à l’identité arabo-islamique de la Tunisie effaçant toute référence à son passé préislamique. La seconde vision voit dans la culture arabo-islamique, actuellement dominante en Tunisie, l’aboutissement d’un long processus historique et de successions de civilisations et d’emprunts culturels. Devant cette situation qui doit se clarifier avec la mise en place d’un régime démocratique, quel rôle doit jouer l’archéologue, l’historien ou l’anthropologue dans sa lecture du patrimoine et des événements historiques à travers sa présentation au public?
Dans ce débat encore ouvert, plusieurs éléments contribuent à la perception d’une diversité évidente du patrimoine archéologique. En premier lieu, les sites et les musées sont les dépositaires de témoignages de civilisations successives. Leurs composantes attestent une linéarité et une continuité historique sans faille avec des emprunts extérieurs assimilés et rapidement intégrés. Le programme muséographique du musée national du Bardo rénové (2009-2012) met en exergue l’identité culturelle plurielle de la Tunisie à travers la présentation des collections des six départements. Ce parcours historique chronologique s’appuie sur une muséographie et des textes d’interprétation relatifs aux diverses civilisations réhabilitées. Autant de témoignages forts des identités multiples de la Tunisie.
Un autre élément attestant la diversité culturelle est la multitude de langues pratiquées en Tunisie à travers l’Histoire. Elle atteste une diversité ethnique et une intensité des échanges culturels. Les trois langues officielles successives, à savoir le punique, le latin et l’arabe, n’ont pas effacé les langues usuelles locales, à savoir le libyque, le berbère, le dialectal et même le français qui fut introduit à l’époque du Protectorat . Cette coexistence des langues a constitué depuis la période libyco-punique un facteur d’enrichissement linguistique. Emprunter la langue de l’autre est un signe de partage, d’ouverture et de réconciliation. Passer d’une langue à l’autre, c’est s’adapter à une nouvelle réalité sans pour autant abandonner son substrat culturel. Etablir un rapport entre langue et nation peut ne pas être conforme à la réalité historique en Tunisie et dans la sphère maghrébine.
Le concept de tunisianité, encore en gestation, pourrait être un élément fédérateur pour la majorité des Tunisiens. Il s’est développé après la révolution du 14 janvier 2011 dans les cercles universitaires et associatifs en tant qu’aboutissement d’une maturation historique et d’un brassage de cultures qui ont forgé l’identité plurielle de la Tunisie et de ses habitants
A l’évidence, la Tunisie est à la fois africaine, maghrébine, méditerranéenne et arabo-islamique : un carrefour de civilisations. La revendication de ces divers points d’ancrage doit être au cœur des débats nationaux et servir de source inspiratrice à la création artistique et culturelle. L’acceptation de cette multiculturalité constituera un pas en avant vers la construction d’une société tunisienne réconciliée avec son patrimoine et consciente de ses diverses appartenances culturelles.
Taher Ghalia
Archéologue-chercheur
Institut national du patrimoine
- Ecrire un commentaire
- Commenter

Monsieur, la casssure a été faite pour la continuité de l´Antiquité en general(Carthage, Phenecie, de l` arabe n´en parlons pas). Qui des europeens sait que le nom d´Europe est en verité le nom d´une fille d´un Roi phenicien de Tyr au liban antique. Dans la langue Espagnole il ya 50. 000 mots de culture arabe. Gibraltar est lui même le nom d´un berbère qui a envahi l´Espagne en 711 a.c. Beaucoup d´europeens ne le savent pas et ne sont pas interessé á le savoir. Eux il se permettent facilement être nationalistes extremistes mais pas nous. Et je parles pas du Christ lui même qui est asiatique(sic) et parlant l´arameen. Les Europeens ne le voient nullement de cette facon.

.png)