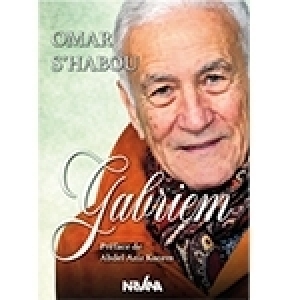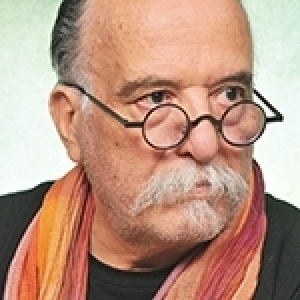Ammar Mahjoubi: Rome et l’échec final du “Dominium mundi”

.jpg) “Le monde romain, entendu au sens large, méditerranéen et proche oriental, avait connu bien des tentatives hégémoniques que l’on peut qualifier d’empires, les plus impressionnantes et les plus durables, celles des Perses ou d’Alexandre, avaient pris la forme monarchique. Les tentatives faites par les cités, Athènes, Sparte, ailleurs Carthage ou Syracuse, avaient été beaucoup plus limitées dans l’espace et dans le temps. Seule de toutes les cités, Rome a réussi à conquérir un empire mondial, donc extrêmement diversifié et segmentarisé, et à le faire durer. Il est vrai qu’au bout de deux siècles, en même temps que s’achevait la phase de la conquête, la forme républicaine de l’Etat romain, à bout de souffle, faisait place à l’Empire, au sens politique cette fois, que la cité se transformait en monarchie.” (C. Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen, Nouvelle Clio, p.469).
“Le monde romain, entendu au sens large, méditerranéen et proche oriental, avait connu bien des tentatives hégémoniques que l’on peut qualifier d’empires, les plus impressionnantes et les plus durables, celles des Perses ou d’Alexandre, avaient pris la forme monarchique. Les tentatives faites par les cités, Athènes, Sparte, ailleurs Carthage ou Syracuse, avaient été beaucoup plus limitées dans l’espace et dans le temps. Seule de toutes les cités, Rome a réussi à conquérir un empire mondial, donc extrêmement diversifié et segmentarisé, et à le faire durer. Il est vrai qu’au bout de deux siècles, en même temps que s’achevait la phase de la conquête, la forme républicaine de l’Etat romain, à bout de souffle, faisait place à l’Empire, au sens politique cette fois, que la cité se transformait en monarchie.” (C. Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen, Nouvelle Clio, p.469).
La compréhension historique d’un phénomène de cette ampleur, celui de la conquête d’un empire romain qui avait étendu son “dominium” sur le monde méditerranéen, des pays et des rives européens aux pays et aux rives du Proche-Orient, avait suscité des enquêtes diverses, menées par les historiens des siècles durant, depuis les temps antiques jusqu’à nos jours. Polybe, dans son livre VI, pensait en avoir décelé les arcanes, mais le rythme des changements dont il fut le témoin effaré, entre 172 et 146 av. J-C., modéra son optimisme et il dut, en avouant sa perplexité, montrer la vanité d’une explication unitaire. Depuis Thucydide et Polybe jusqu’aux modernes, cette recherche historique a pris des directions multiples, s’est étendue à nombre de domaines et, sans cesse renouvelée, elle a essayé de distinguer, selon les circonstances, les véritables décideurs et les motivations de la construction impériale. Elle a tenté de discerner les desseins des chefs politiques, magistrats, sénateurs, groupes de pression… s’est évertuée à montrer leurs intérêts, avoués ou dissimulés, leurs volontés plus ou moins libres, plus ou moins explicites, en essayant de reconnaître les sources de leurs informations géographiques, historiques, ethnographiques… et de comprendre, finalement, leur vision du monde.
La recherche, qui a concerné les motivations a montré celles de l’économie, sous sa forme la plus brutale d’abord, matérialisée par les profits individuels ou collectifs de la guerre, par le désir d’accaparer des biens rares ou nécessaires, métaux, bois et richesses agricoles ; plus élaborées étaient les motivations fiscales, les impôts et les prestations imposées aux provinciaux, dans les contrées conquises, pour en dispenser les citoyens romains et assurer leurs privilèges. D’autres motifs, souvent manifestes, impliquaient la ruine ou la destruction d’un concurrent plus ou moins inquiétant, d’un danger avéré ou potentiel. Il fallait aussi assurer la liberté de la navigation, éliminer la piraterie, bref imposer une “pax romana” avec le respect dû à Rome et à la “majestas populi romani”. Les temps forts de la conquête alternaient avec ses temps faibles, avec des étapes, des succès qui avaient entraîné Rome vers de nouveaux horizons et des obstacles, des revers qui l’avaient fait vaciller, même, s’arrêter ; et il convient aussi, enfin de confronter la vision des Romains avec celle de leurs adversaires, de leurs voisins et de leurs interlocuteurs.
.jpg) Pendant les conquêtes et en rapport avec la religion et l’idéologie romaines, la “fides”, la foi jurée, était souvent invoquée ; et après chaque victoire de Rome, les vaincus étaient censés effectuer une “deditio”, c’est-à-dire une remise de l’ensemble de leurs personnes et de leurs biens à la discrétion du vainqueur, avec un formulaire rituel transmis par Tite Live : “venire in fidem”, en vertu duquel le peuple vaincu devait respecter quasi religieusement la domination (l’imperium) et la supériorité (la majestas) du peuple romain. La “fides” était ainsi source de rapports inégaux et de relations asymétriques, adoucis cependant par une franchise et une loyauté qui, jusqu’au IIIe siècle avant le Christ, avaient été la maxime de la République romaine ; mais les choses changèrent tant avec la guerre de Persée qu’avec la troisième guerre punique. La “fides romana”, qui était une relation réciproque impliquant des obligations de modération et de clémence de la part du vainqueur et se situait dans un contexte de clientèle, changea totalement de nature à partir de 191 av. J.-C. Certains décideurs, à Rome, lui imposèrent une conséquence contraignante et humiliante pour le vaincu, si bien que cette sorte d’alliance, certes asymétrique, découlant des traités jurés, devint à partir du IIe siècle av. J.-C. une obligation militaire et financière draconienne. Lors de la guerre de Persée, le roi fut capturé et le royaume de Macédoine fut détruit ; et pour ce qui concerne la guerre punique, il suffit de lire Polybe, qui a montré son caractère fourbe et machiavélique (Polybe XXXVI, 2, 6). Ce même caractère fourbe et machiavélique que revêtit, à plus de deux millénaires d’intervalle, la destruction de l’Irak par les Etats-Unis d’Amérique et leur volonté de pérenniser leur “dominium mundi”.
Pendant les conquêtes et en rapport avec la religion et l’idéologie romaines, la “fides”, la foi jurée, était souvent invoquée ; et après chaque victoire de Rome, les vaincus étaient censés effectuer une “deditio”, c’est-à-dire une remise de l’ensemble de leurs personnes et de leurs biens à la discrétion du vainqueur, avec un formulaire rituel transmis par Tite Live : “venire in fidem”, en vertu duquel le peuple vaincu devait respecter quasi religieusement la domination (l’imperium) et la supériorité (la majestas) du peuple romain. La “fides” était ainsi source de rapports inégaux et de relations asymétriques, adoucis cependant par une franchise et une loyauté qui, jusqu’au IIIe siècle avant le Christ, avaient été la maxime de la République romaine ; mais les choses changèrent tant avec la guerre de Persée qu’avec la troisième guerre punique. La “fides romana”, qui était une relation réciproque impliquant des obligations de modération et de clémence de la part du vainqueur et se situait dans un contexte de clientèle, changea totalement de nature à partir de 191 av. J.-C. Certains décideurs, à Rome, lui imposèrent une conséquence contraignante et humiliante pour le vaincu, si bien que cette sorte d’alliance, certes asymétrique, découlant des traités jurés, devint à partir du IIe siècle av. J.-C. une obligation militaire et financière draconienne. Lors de la guerre de Persée, le roi fut capturé et le royaume de Macédoine fut détruit ; et pour ce qui concerne la guerre punique, il suffit de lire Polybe, qui a montré son caractère fourbe et machiavélique (Polybe XXXVI, 2, 6). Ce même caractère fourbe et machiavélique que revêtit, à plus de deux millénaires d’intervalle, la destruction de l’Irak par les Etats-Unis d’Amérique et leur volonté de pérenniser leur “dominium mundi”.
C’est aussi avec la troisième guerre punique qu’apparut, dans la politique romaine, l’initiative de la guerre préventive, l’idée d’abattre un ennemi qui avait disputé à Rome la suprématie à maintes reprises et qui, à l’occasion, pouvait la lui disputer de nouveau ; afin de garantir la domination romaine et d’écarter toute menace, réelle ou seulement potentielle. De cette politique de guerre préventive, qui soulevait des oppositions, la République romaine glissa, dès 168 av. J.-C., vers l’adoption d’une doctrine extrême, implacablement appliquée, qui prétendit que les rois et les peuples signataires d’un traité avec elle ne devaient leur liberté et leur existence même qu’à son bon vouloir, qu’à une mesure provisoire, révocable à tout moment, même si les traités signés les avaient déclarés, solennellement, libres, indépendants et amis du peuple romain. Doctrine qui prévalut pendant la guerre de Jugurtha : Rome revendiqua un droit de propriété et une créance fiscale sur le sol des royaumes numides, considéré comme un sol provincial, alors que ces royaumes avaient été proclamés libres et amis de Rome à l’issue de la troisième guerre punique.
Aux étapes consolidatrices de l’impérialisme romain et à l’évolution de ses motivations, de ses doctrines et de ses programmes politiques, vont faire suite les phases pendant lesquelles il ne cessa de se défaire. A partir de 235, avec la mort de Sévère Alexandre et la fin de la dynastie sévérienne, s’installa, un demi-siècle durant, une crise multiforme, malgré la consolidation incessante des institutions à l’interne et des frontières à l’externe à l’orée du IVe siècle, grâce à l’impulsion énergique de Dioclétien et au véritable redressement réalisé par les empereurs illyriens. Si les recherches du siècle dernier ont permis d’exclure l’idée d’une décadence irrévocable, qui avait péjoré cette époque du Bas-Empire, elles ont cependant réaffirmé que la crise très grave du IIIe siècle, après la “ pax romana ” des deux premiers siècles de l’Empire, avait ébranlé les structures de l’Etat, avec des soubresauts qui se prolongèrent jusqu’à 285. Période de troubles et de récession qui déstabilisa le régime mis en place par Auguste et ses premiers successeurs. Ses aspects multiples furent d’abord militaires ; les incursions répétées des Germains en Europe, des Perses en Orient et des Maures en Afrique du Nord enfonçaient périodiquement le “ limes ”, et les victoires difficiles étaient sans cesse remises en question. Au grand jour apparut ainsi l’inadaptation de l’armée face aux assauts généralisés des “ Barbares”.
Petit à petit, un choix politique s’imposa aux empereurs, celui de renoncer à la domination universelle pour se concentrer sur l’organisation d’un domaine limité. Choix nécessité assurément par la situation de l’empire et les limites de ses moyens humains et matériels. Le premier résultat positif fut le retour général à l’ordre et à la paix. De Dioclétien à Julien, les ennemis extérieurs, Germains et Perses, furent contenus, en dépit d’une chaude alerte de 352 à 357 sur le Rhin et le Danube, mais la victoire romaine à Strasbourg finit par ramener la paix et même si l’empereur Julien trouva la mort en Orient en 363, ce fut au cours d’une offensive de l’armée romaine menée en territoire perse. Aux échecs cuisants et à la situation désespérée du IIIe siècle fit suite une tranquillité prolongée pendant près de trois quarts de siècle, malgré quelques conflits civils à l’interne.
Le régime instauré à cette époque prit une tournure autoritaire, avec une accentuation de l’absolutisme, la concentration du pouvoir entre les mains de l’empereur et le renforcement de la centralisation, afin que les décisions émanant de la Cour puissent être plus rapidement exécutées. A l’affirmation de son commandement militaire, proche des soldats, l’empereur ajouta à l’interne une mesure de relâchement relatif, qui visa surtout la bureaucratie tatillonne. Rome cessa d’être capitale et résidence impériale unique, et des diocèses ainsi que des préfectures du prétoire régionales furent institués au-dessus des provinces, devenues plus nombreuses en raison de leur partition. Au niveau des cités, les curies municipales conservèrent une large autonomie.
Des transformations sociales profondes affectèrent la noblesse ; l’ordre équestre disparut et l’aristocratie sénatoriale, totalement reformée, accueillit de nouvelles élites. Mais les ordres sociaux continuèrent à segmenter la société ; chaque catégorie ayant conservé ses définitions, ses droits et ses devoirs. Ce qui explique la véhémence des reproches adressés par les historiens à cette classification sociale du IVe siècle, sclérosée en une série de castes séparées par des barrières infranchissables, qui interdisaient pratiquement toute mobilité. Mais l’époque de Constantin et de sa dynastie n’aurait pas, d’après A.Chastagnol, mérité cette critique, car la mobilité sociale, précisément, aurait été un trait fondamental de la période qui connut une véritable restructuration des ordres sociaux. Les anciens éléments qui, auparavant, appartenaient à l’ordre équestre rejoignirent l’ordre sénatorial et les sénateurs de Constantinople furent recrutés parmi les bureaucrates et les notables de la cité. Dans les provinces, les élites des cités vécurent aussi une époque de promotions sociales par l’accès des notables à l’ordre nobiliaire, alors que l’éducation et l’obtention d’un niveau de culture garantissaient l’accès aux grades de l’armée, aux emplois de la bureaucratie et aux fonctions du clergé. C’est surtout après le règne de Julien (361-363) et après cette mise en place des structures nouvelles que la société romaine fut figée en castes héréditaires étanches.
C’est aussi à cette époque que la distinction entre les riches et les pauvres devint très nette et se généralisa, aggravée par les réformes monétaires de Constantin. Les riches détenaient la monnaie d’or et d’argent, alors que les pauvres faisaient usage de la monnaie de billon, et leur indigence s’accroissait à mesure que se dévalorisait le métal vil face à l’or. Dans le domaine religieux, enfin, la conversion de Constantin ouvrit la voie large à une transformation considérable, mais paganisme et christianisme continuèrent longtemps à voisiner, surtout dans les familles aristocratiques. En certaines régions, les provinciaux s’étaient ralliés en masse à la religion du Christ, notamment dans les provinces africaines et en Orient, à un point tel que la nouvelle croyance s’y généralisa très vite, alors qu’en occident elle ne se répandit qu’après un délai de trente ans. Avec ce contraste entre Orient et Occident, l’Empire encore uni au IVe siècle s’achemina vers le partage, symbolisé par la fondation de Constantinople et encore plus par la division de l’ordre sénatorial en deux aristocraties distinctes en 357, préfigurant la partition politique réalisée pratiquement à partir de 396.
Ammar Mahjoubi
- Ecrire un commentaire
- Commenter