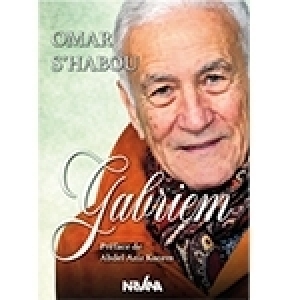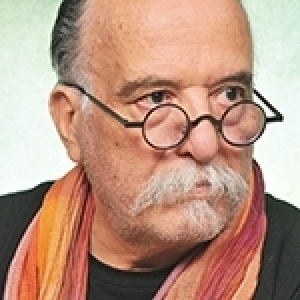Mohamed-El Aziz Ben Achour: Diversité ethnique et culturelle et cohabitation sociale dans l’histoire tunisienne
 Membres du tribunal rabbinique, Tunis, 1941 (photo Victor Sebag, in Tunisie 1910-1960, Gérard Sebag, cérès éditions, 2011)
Membres du tribunal rabbinique, Tunis, 1941 (photo Victor Sebag, in Tunisie 1910-1960, Gérard Sebag, cérès éditions, 2011)
.jpg) Il peut paraître surprenant, habitués que nous sommes à la relative uniformité de notre population actuelle renforcée par l’affirmation d’une identité arabo-musulmane (malgré la revendication encore marginale d’une berbérité à tendance laïque), de se pencher sur l’aspect apparemment insolite du cosmopolitisme, ou, si l’on préfère, de la diversité et de la cohabitation. Il suffit pourtant de remonter à quelques décennies en arrière pour découvrir, sous la banalité d’aujourd’hui, la formidable bigarrure d’une société où se côtoyaient, se mélangeaient et même s’intégraient des races, des nations et des confessions diverses.
Il peut paraître surprenant, habitués que nous sommes à la relative uniformité de notre population actuelle renforcée par l’affirmation d’une identité arabo-musulmane (malgré la revendication encore marginale d’une berbérité à tendance laïque), de se pencher sur l’aspect apparemment insolite du cosmopolitisme, ou, si l’on préfère, de la diversité et de la cohabitation. Il suffit pourtant de remonter à quelques décennies en arrière pour découvrir, sous la banalité d’aujourd’hui, la formidable bigarrure d’une société où se côtoyaient, se mélangeaient et même s’intégraient des races, des nations et des confessions diverses.
La conquête musulmane, ici comme en Orient, avait maintenu des communautés religieuses telles que les chrétiens et les juifs «gens du Livre». Depuis le haut Moyen Âge coexistaient dans le pays les musulmans sunnites mais aussi chiites ismaéliens, les juifs et les chrétiens. Dans les périodes troublées, la cohabitation ancienne entre ces différents groupes était remise en cause. C’est ainsi qu’en 1016, sous les émirs zirides, les sujets chiites, dont le rite avait été introduit sous le califat fatimide au Xe siècle, furent massacrés par la populace sunnite à Kairouan, Mahdia, Tunis et Béja. Toujours sous les Zirides, un bouleversement démographique et ethnique eut lieu avec l’arrivée en masse au XIe siècle des tribus arabes Banou Hilâl et Soulaym venues de Haute-Egypte et l’extension du genre de vie nomade bédouin dans une Ifriqiya à vieille tradition sédentaire.
.jpg)
La position géographique de la Tunisie (anciennement l’Ifriqiya) au cœur de la Méditerranée, ses contacts économiques et culturels anciens avec l’Orient et l’Europe auxquels il faut ajouter la nature allogène des pouvoirs politiques successifs, enclins– selon les caractères propres au despotisme oriental - à faire appel à des éléments étrangers comme collaborateurs, ont permis l’apparition d’une diversité ethnique plus ou moins importante dans la plupart des villes. En particulier à Tunis, ville depuis longtemps active comme port et arsenal. Devenue depuis le XIIIe siècle la capitale politique et la métropole économique, religieuse et culturelle, elle développa dès lors une tradition d’ouverture aux apports extérieurs indispensables à son essor et ne cessa de s’ouvrir sur le monde méditerranéen, en gardant de solides attaches avec son environnement maghrébin et arabe.
Les circonstances politiques et les interventions étrangères jouaient aussi au détriment de la coexistence intercommunautaire. C’est ainsi, comme nous l’avons vu dans un précédent article (Leaders, mai 2023), que les chrétiens de Mahdia et d’autres villes furent massacrés lors de la révolte contre les Normands de Sicile qui occupèrent Mahdia et le littoral ifriqiyen de 1148 à 1160. Les puissants Berbères Almohades venus du Haut Atlas avaient, certes, libéré l’Ifriqiya ziride de la domination normande mais leur intransigeance doctrinale, qui exigea des juifs et des chrétiens de se convertir sous peine de mort, allait porter un coup sévère à l’ancienne coexistence des communautés religieuses. Les communautés chrétiennes autochtones– probablement décimées– finirent par disparaître, sans doute à la suite de départs vers un exil dans l’Europe voisine. En revanche, les Ifriqiyens juifs survécurent à la tourmente et constituèrent une solide et dynamique communauté autochtone dont nous reparlerons.
.jpg)
En 1237, les émirs hafsides –à l’origine gouverneurs almohades devenus indépendants et ayant rompu avec le rigorisme religieux de leurs anciens suzerains – renouèrent avec cette tradition de tolérance propice à la cohabitation. Pour des raisons de sécurité, ils créèrent une milice dont les officiers et les hommes de troupe étaient des mercenaires venus de la Chrétienté. Deux sultans hafsides et non des moindres, Al Moustansir et Abou ‘Amrou Othmân, étaient nés de mères d’origine chrétienne. Abou ‘Amrou fit même venir d’Europe ses oncles maternels et les installa dans un quartier voisin de la citadelle connu dès lors sous le nom de «quartier des chrétiens» (Houmet el Oulouj). Tunis s’habitua à cette époque à la présence permanente des marchands européens pisans, génois, vénitiens, siciliens, aragonais ou catalans. Divers traités, dont les plus anciens signés entre le Prince hafside et Pise et Gènes remontent à 1230, constituaient le cadre juridique de cette présence d’étrangers. Aux termes de ces traités, les marchands avaient droit à un consul, un fondouk, une église et un cimetière. Avec leurs partenaires et fournisseurs musulmans et juifs tunisiens, la communication se fit au fil du temps dans un arabe approximatif et plus près de nous , à l’aide d’une sorte de lingua franca méditerranéenne, un sabir pittoresque où se mélangeaient l’italien, l’arabe et l’espagnol.
.jpg)
En ce qui concerne les populations du Maghreb et d’Espagne, Tunis accueillit au XIIe siècle les Marocains venus avec les Almohades, puis reçut les premiers réfugiés musulmans d’Andalousie, dont la famille d’Ibn Khaldoun, arrivés après la chute de Séville en 1248.
Plus tard, les pouvoirs issus de la conquête ottomane de 1574, c’est-à-dire les deys puis les deux dynasties des beys mouradites au XVIIe siècle et husseïnites à partir de 1705, organisés selon le modèle propre à l’Orient, s’appuyèrent jusqu’à la fin du XIXe siècle sur des éléments allogènes de race blanche de statut servile originaires du Caucase mais aussi d’autres régions européennes. Ces mamelouks, comme on les appelait, exerçaient de hautes fonctions civiles et militaires et constituaient le tout premier cercle du Prince. Largement «tunisifiés», ils gardaient toutefois un particularisme de caste vis-à-vis des personnalités autochtones. Leur descendance, par contre, s’intégrait parfaitement à la ville et à sa société. L’activité corsaire, stratégiquement si importante et si lucrative pour les Etats dits barbaresques (Alger, Tunis et Tripoli), requérait la maîtrise des techniques navales que les Européens dominaient, tout comme la défense des ports et des côtes. Aussi faisait-on appel à des convertis (les «renégats» selon le vocabulaire de l’historiographie chrétienne) qui constituèrent pendant de nombreuses années l’élite des capitaines (les fameux raïs), des charpentiers navals et des artilleurs. Ils vivaient «à la turque» et leur assimilation était totale. Deux d’entre eux accédèrent même au pouvoir suprême, un Corse né Jacques Santi (Mourad «Coursou») bey de 1613 à 1631 et un Italien, Ousta Mourad Genovese comme dey de 1637 à 1640.
.jpg)
Comme nous venons de le voir, l’onomastique perpétuait les origines géographiques et ethniques. Un registre de l’administration daté de 1195 et 1196 de l’hégire (1780 -1781) nous apprend ainsi que les artilleurs du Bardo, siège de l’Etat beylical, étaient Youssouf, Ali et Slimane Sardou, Youssouf El Malti, Mustafa Sbagnioul, Mohamed Fransis et Bayram Sicilian. Véritable microcosme de la diversité tunisienne, cette cité beylicale avec ses palais, ses installations militaires et son souk abritait un nombre important de personnes dont des Européens, captifs ou libres et fidèles à leur religion, exerçant les métiers de domestiques, d’armuriers, de contremaîtres, de maçons, de cuisiniers, de sculpteurs de marbre, de jardiniers, d’horlogers, de joaillers. Venaient également d’Europe, les médecins comme, sous le règne de Hammouda Pacha (1782-1814), El Nasrânî («le Chrétien») Bachicha (peut-être une déformation de Battista) ou encore Ingliz (l’«Anglais»). Certains étaient de confession israélite comme «El- Dhimmi Zaki El Brakiz». On rencontre toutefois quelques rares médecins maghrébins tel cet El Hâj Abdallah al Maghribi.
Du Levant et des provinces orientales de l’empire ottoman venaient les janissaires et, plus tard, du Maghreb, plus précisément de Kabylie, les zwawas, troupes beylicales destinées à contrebalancer la puissance de l’élément «turc». Les uns et les autres finissaient par s’intégrer à la société urbaine et exerçaient de paisibles activités artisanales. Aux XIXe et XXe siècles, les Maghrébins étaient principalement des Tripolitains et des Algériens qui alimentaient un flux ancien d’immigration que les événements politiques, comme les interventions étrangères, accéléraient. Rappelons, enfin, que la traite des Noirs (officiellement abolie en 1842, à l’initiative d’Ahmed 1er Pacha Bey) avait donné naissance à une communauté tunisienne d’origine africaine dont les membres étaient essentiellement affectés à des tâches domestiques.
Au XIXe siècle, dans un contexte marqué par les manœuvres des puissances impérialistes, les anciens équilibres furent ébranlés. Jouissant de la protection consulaire (comme certains musulmans d’ailleurs, qui cherchaient à se protéger de la voracité d’un Etat financièrement aux abois), les négociants et courtiers juifs commencèrent à se libérer en pratique de leur statut inférieur. Certains comptaient parmi les dignitaires beylicaux tels Nessim Chemmama et plus tard Gabriel Valensi. La communauté européenne était dominée par de riches familles résidant dans le quartier «franc» près de Bab el Bahr, italiennes comme les Gnecco, Fasciotti, Mascaro, Fedriani, ou françaises tels les Monge, Mercier, Vangaver, Chapelié, Ventre. Parmi cette élite européenne, figuraient deux influentes familles italiennes de dignitaires beylicaux : les Raffo et les Bogo. Ainsi qu'un Français d'Orient, Antoine Conti.
Au cours du XIXe siècle, la communauté européenne s’enrichit de l’arrivée de prolétaires siciliens, maltais, grecs. Certains parvinrent à réussir comme agriculteurs ou entrepreneurs. D’autres s’imposèrent comme médecins réputés. La communauté sicilienne de Tunisie vivait au contact des autochtones. Beaucoup, par exemple, habitaient dans la médina et ses faubourgs, comme les Maltais, autre communauté importante. A ceux-ci, s’ajoutaient des Grecs et au XXe siècle les réfugiés russes puis les républicains espagnols.
La communauté juive, installée depuis des temps immémoriaux, exerçaient un rôle économique important (orfèvres, tailleurs, divers autres métiers, marchands, changeurs, prêteurs ou courtiers). Les sujets du bey de confession juive avaient le statut de dhimmi-s et subissaient donc des mesures discriminatoires non seulement fiscales mais également immobilières et vestimentaires. Ces mesures entretenaient chez la population musulmane un sentiment de supériorité et une attitude plus ou moins exprimée de dédain. Au XVIIe siècle, cette communauté s’était scindée en deux groupes, celui des juifs Twansa (autochtones) et les Grâna, c’est-à-dire les juifs chassés par les rois catholiques d’Espagne. Accueillis par les princes de Toscane à Livourne, ville à partir de laquelle ils nouèrent des relations économiques avec Tunis où nombre d'entre eux s'installèrent définitivement. Européanisés, les Grana se spécialisèrent dans le grand commerce entre la Péninsule et Tunis et formèrent dans cette ville une sorte d’aristocratie judéo-italienne.
Le protectorat français (1881 à 1956) eut des conséquences importantes sur la culture de la diversité et l’habitude de la cohabitation. La notion de dhimmi disparaît. La communauté juive s’émancipe et son élite, véritable bénéficiaire autochtone du Protectorat, se francise et donne au pays des enseignants, des intellectuels, des médecins, des avocats, cependant qu’une grande partie reste très marquée par sa culture judéo-arabe. Partout dans le pays, des communautés juives d’artisans, de commerçants, de négociants, de courtiers, de gérants à Sousse, à Bizerte, à Nabeul à Béja, au Kef, à Djerba et ailleurs vivent en harmonie avec les musulmans à l’ombre de l’ordre beylical et colonial.
A la fin du XIXe siècle, de plus en plus de familles désertent le quartier juif historique mais insalubre de la Hara et s'installent principalement dans le quartier Lafayette de la ville européenne où une imposante synagogue est achevée en 1937. A Tunis, ce sont principalement les juifs qui donnèrent à l’ambiance de la ville européenne, de l’Ariana et des stations balnéaires de la banlieue nord son exubérance orientale et méditerranéenne.
La communauté française, devenue officiellement prépondérante, se diversifie. Outre l’élément traditionnel des marchands et négociants, s'ajoutèrent de nombreux fonctionnaires, militaires, médecins, avocats, enseignants, et bien entendu les colons qui accaparent les meilleures terres mais donnent aux campagnes et aux bourgs une atmosphère particulière. La communauté italienne, longtemps plus nombreuse que la population française, fut toutefois progressivement rattrapée puis dépassée à la suite de diverses mesures de l’administration du protectorat de sorte qu’en 1956, la Tunisie, dont la population totale était de 3.783 169 habitants dont 99.000 juifs, comptait 180.440 Français et 66.910 Italiens.
Le protectorat garantissait une coexistence entre les communautés malgré quelques batailles rangées entre Italiens et Français, parfois aussi entre fiers-à-bras musulmans et siciliens, exceptionnellement entre juifs et musulmans. A Tunis ( à l’exception de la médina et de ses faubourgs devenus sous le protectorat un refuge de l’identité avant le départ progressif des familles de dignitaires et de notables remplacées par des arrivants ruraux) ainsi que dans les quartiers modernes des villes côtières, un art de vivre cosmopolite s’épanouit autour des promenades, des cafés modernes, des théâtres et du cinéma et des arts plastiques. Seuls des événements graves et le plus souvent en relation avec une conjoncture internationale mettaient à rude épreuve la paix intercommunautaire comme lors des violences dont furent victimes les Italiens en 1912 en écho à l’occupation de la Libye.
Il faut cependant préciser que la cohabitation était davantage une juxtaposition des communautés qu’une interpénétration. L’obstacle principal était l’appartenance religieuse. Les relations cordiales relevaient plus du bon voisinage (entraide entre voisins, échanges de cadeaux à l’occasion des fêtes des uns et des autres) mais en général, à l’exception de solides amitiés individuelles et quelques mariages interconfessionnels plus ou moins bien vécus par l’entourage, les relations entre les groupes s’arrêtaient là.
A ce propos, l’histoire de la tolérance en pays musulman nous enseigne que la paix entre les communautés de diverses confessions et origines, bien davantage que par un choix assumé des populations, était garantie par la vigilance du pouvoir. De sorte que les villes où s’épanouissait l’acceptation de la différence ethnique, culturelle et religieuse étaient les capitales et les grandes villes soumises de ce fait à un étroit contrôle de l’autorité politique.
Encore une fois, dans l’histoire de la cohabitation intercommunautaire en Tunisie, un événement extérieur allait ébranler durablement les relations longtemps paisibles entre musulmans et juifs. Le plan de partage par l’ONU en novembre 1947 puis, en mai 1948, la fondation de l’Etat d’Israël et le drame palestinien furent douloureusement vécus en Tunisie. Ce choc n’affecta pas les relations entre juifs et musulmans de Tunisie et la réaction consista en un appel populaire pour une assistance financière au profit des réfugiés palestiniens et à des départs de combattants volontaires. Toutefois, au temps de la République, la défaite arabe de juin 1967 donna l’occasion à la foule de se déchaîner. A Tunis, outre l’attaque des ambassades d’Angleterre et des Etats-Unis, les émeutiers molestèrent des juifs, incendièrent des commerces, et profanèrent la grande synagogue de l’avenue de la Liberté avec une violence jusque-là inconnue dans l’histoire moderne et contemporaine de notre pays. Ces événements donnèrent lieu à un exode massif vers la France et Israël, affectant de manière définitive le caractère pluriel de la Tunisie, déjà amorcé à la suite du départ des Français et des Italiens à partir de 1956 et surtout de 1964 lors de la nationalisation des terres coloniales.
De cette longue histoire que reste-t-il aujourd’hui ? Démographiquement et sociologiquement, la diversité des nations, des races et des religions a disparu. Il n’y a plus que quelques centaines d’Européens et les juifs ne sont plus que 1 500 vivant et travaillant essentiellement à Djerba. Ceux qui sont partis ont gardé de l’atmosphère cosmopolite et bon enfant une profonde nostalgie, au point d’éprouver parfois des difficultés à s’adapter à l’étranger. Dans la société tunisienne très majoritairement musulmane, la foi, qui fut primordiale dans le maintien de l’identité à l’époque du protectorat et de la mobilisation des masses dans le combat pour l’indépendance, occupe toujours une place prépondérante. La culture citadine tunisienne elle-même est affectée non seulement par les effets déstructurants de l’exode rural mais également par l’évolution des mœurs et des usages, toutes classes confondues. Une tradition de réforme et d’ouverture sur le monde, dont les origines remontent aux années 1840-1870, persiste néanmoins. Il faut rappeler ici que la présence française et la politique scolaire bilingue mise en œuvre ont permis à la société citadine de connaître un enrichissement culturel et intellectuel considérable dont l’héritage est encore vivace. Le Tunisien n’est peut-être pas un «citoyen de l’univers » (cosmo/polites) mais il a une prédisposition à l’ouverture. Son attachement.
–généralement intransigeant– à sa personnalité musulmane peut, notamment au niveau des masses, entraver une entrée résolue dans la modernité. Tout cela pose de manière cruciale le problème de la culture politique et son rôle dans l’épanouissement de l’esprit civique par le biais de l’éducation et d’une connaissance raisonnée de notre histoire de la géopolitique et des civilisations.
Mohamed-El Aziz Ben Achour
- Ecrire un commentaire
- Commenter