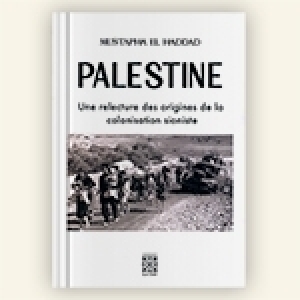Réformer ou mourir (VI) :La réforme de la politique de l'emploi
« Réformer ou mourir » : « nous voilà arrivés au terme de cette étude de M. Habib Touhami que vous avez été nombreux à suivre, avec la mise en ligne de la dernière partie consacrée à la réforme de la politique de l’emploi suivie des conclusions générales.
Comment faire en sorte que l’emploi cesse d’être caractérisé par le sous emploi et la précarité, par une inadéquation entre la formation et les offres de l’emploi de l’économie, par la prolifération du travail au noir et finalement par une grande incertitude ?
L’auteur propose ses solutions, comme il l’a fait pour les autres « grands chantiers »(1) sur lesquels devra se pencher le nouveau gouvernement qui sera choisi par la Constituante issue des élections du 24 juillet prochain.
.jpg) Jusqu’ici, la politique de l’emploi menée en Tunisie a été articulée autour de deux composantes: la croissance et ses bienfaits supposés sur les créations d’emploi, l'«ensemble des interventions publiques sur le marché du travail, visant à en améliorer le fonctionnement et à diminuer les déséquilibres qui peuvent y apparaître ». Si la première composante peut être considérée comme pouvant relever d’une politique de l’emploi (on y reviendra un peu plus loin), la seconde, par contre, ne relève que d’une politique du chômage. En fait, tant qu’elle a pu compter sur l’immigration et sur les recrutements en masse dans la fonction publique et les entreprises nationales, la politique de l’emploi en Tunisie a plus au moins tenu la route. Mais dès que les « sources » de l’immigration se sont plus au moins taries, que le recrutement dans le secteur public est devenu rare et que le différentiel demande-offre d’emploi est devenu important et qualitatif, les limites de cette politique sont devenues criardes. A cela plusieurs raisons.
Jusqu’ici, la politique de l’emploi menée en Tunisie a été articulée autour de deux composantes: la croissance et ses bienfaits supposés sur les créations d’emploi, l'«ensemble des interventions publiques sur le marché du travail, visant à en améliorer le fonctionnement et à diminuer les déséquilibres qui peuvent y apparaître ». Si la première composante peut être considérée comme pouvant relever d’une politique de l’emploi (on y reviendra un peu plus loin), la seconde, par contre, ne relève que d’une politique du chômage. En fait, tant qu’elle a pu compter sur l’immigration et sur les recrutements en masse dans la fonction publique et les entreprises nationales, la politique de l’emploi en Tunisie a plus au moins tenu la route. Mais dès que les « sources » de l’immigration se sont plus au moins taries, que le recrutement dans le secteur public est devenu rare et que le différentiel demande-offre d’emploi est devenu important et qualitatif, les limites de cette politique sont devenues criardes. A cela plusieurs raisons.
Pour l’essentiel les mesures « d’accompagnement » à la croissance ont tourné autour de l’incitation à l’embauche moyennant des dégrèvements fiscaux et sociaux, la création d’emplois supplémentaires dans le secteur public, l’aide à la création de micro-entreprises par les jeunes, l’aide à l’insertion dans la vie active par le biais de stages en entreprises, l’introduction d’une plus grande flexibilité sur le marché du travail et la favorisation du travail à mi-temps et des départs à la préretraite. Or, on sait que ces mesures, appliquées ailleurs aussi, n’ont jamais pu franchir un certain seuil. Dans notre cas, les politiques actives de l’emploi (PAE) n’ont servi qu’à dissimuler le sous- emploi et à occulter les dimensions réelles du chômage. Peu de stages du type SIVP ont abouti à un CDI et tout indique que les SIVP n’ont guère préparé les stagiaires à voler de leurs propres ailes, principalement dans les régions défavorisées. Sur la croissance et ses effets sur l’emploi, rien de vraiment tranché ne permet de confirmer ou d’infirmer une telle corrélation. Ce que l’on peut dire par contre est qu’un taux croissance élevé ne diminue automatiquement pas le chômage puisque des poches de croissance peuvent exister par simple inertie et que les situations, d’un pays à l’autre, d’un taux de croissance à l’autre, ne permettent pas de tirer des conclusions définitives. Au demeurant, les effets sur le volume de l’emploi dépendent du différentiel entre la croissance de la production et celle de la productivité. Pour sa part, la croissance de la production peut résulter de gains de productivité qui ont à leur tour des effets plus contrastés sur le volume de l’emploi (croissance intensive). Quoi qu’il en soit, le résultat est là puisque l’économie nationale a enregistré des taux de croissance relativement élevés à l’heure même où la situation du chômage s’est sensiblement aggravée.
Pour cacher aux yeux du monde et à nos propres yeux la vraie dimension du problème, tous les artifices furent utilisés. Ainsi les statistiques officielles nous révèlent-elles que Sidi-Bouzid a un taux de chômage « très modéré » (moins de 10% en 2007) comparativement à Siliana ou Jendouba par exemple (entre 24 à 26%) et que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ont des taux avoisinant les 20% (seulement). Plus grave, les indicateurs disponibles ne permettent pas de saisir la dimension de la précarité et du sous-emploi (le sous-emploi est défini comme étant « la productivité au travail d’une personne qui est inférieure à son niveau de plein-emploi » BIT 1999).
Taux de chômage par région en 2007
|
| Taux de chômage |
| District de Tunis | 13,9% |
| Nord-Est | 10,3% |
| Nord-Ouest | 19,6% |
| Centre-Ouest | 14,3% |
| Centre-Est | 11,7% |
| Sud-Ouest | 20,0 |
| Sud-Est | 17,6% |
| ENSEMBLE | 14,1% |
Source : INS, 2008.
Plus de la moitié des gouvernorats ont des taux supérieurs à la moyenne. Certains gouvernorats de l’intérieur ont même des taux de chômage très supérieurs à la moyenne du pays :
24 à 26% : Tozeur, Jendouba et Siliana.
20 à 22,5% : Kasserine, Gabès, Gafsa
14 à 19% : Tataouine, Mahdia, Manouba, Le Kef, Ben-Arous, Kébili, Médenine.
4 gouvernorats ont des taux très modérés (moins de 10%). Il s’agit de Zaghouan, Monastir, Nabeul et Sidi Bouzid.
Comment saisir la réalité de la situation de l’emploi dans ces conditions ? Question difficile puisque l’instrumentation méthodologique et statistique adéquate nous manque et que la situation politique ajoute à la confusion générale. Cependant, quelques traits peuvent être soulignés.
1. L’emploi en Tunisie se caractérise par le sous-emploi et la précarité. Les travailleurs du secteur informel (433036 emplois en 2002 selon l’INS) et les travailleurs à domicile (320 000 personnes selon certaines estimations) constituent plus du quart de l’emploi global. Le travail saisonnier (Agriculture, BTP et Tourisme pour l’essentiel) occupe le 1/10 de l’emploi total. Quant au travail à temps partiel, il occupe selon diverses sources plus de 16% de l’emploi global. Le sous-emploi touche donc près de 40% de la population occupée. Par ailleurs, les contrats à durée déterminée (CDD) représentent ainsi 41% des contrats de travail dans les industries textiles, de l’habillement, du cuir et de la chaussure (ITHCC), et 58% dans le tourisme. On peut donc dire que le sous-emploi et la précarité touchent plus que la moitié de la population active potentielle en 2007. Pour sa part, la Banque mondiale estime que près de 1,2 millions de travailleurs occupaient un emploi partiel, saisonnier ou précaire en 2002.
2. L’emploi en Tunisie se caractérise par une rapide tertiarisation. Toutefois, les données chiffrées infirment cette thèse, du moins à première vue. En effet, l’évolution de la structure de la population occupée par secteur d’activité montre que la part du Commerce et des Services se situe en 2010 à 49,3% (contre 17,7% pour l’agriculture et la pêche et 33,0% pour le secteur secondaire), soit à peu près le même niveau qu’en 2005 (49,0%) et même cinq auparavant. On pourrait donc évoquer une stabilisation et non une forte tertiairisation sauf que si l’on se reporte à l’évolution de la même structure dans les pays industrialisés tôt comme la Grande-Bretagne ou les pays industrialisés tard comme le Japon, le déversement de la main-d’œuvre du secondaire et du primaire vers le tertiaire s’est effectué en relation avec l’évolution des productivités sectorielles (cela explique d’ailleurs que la part du secondaire dans la population occupée totale est nettement plus élevée dans les pays industrialisés tôt par rapport aux pays industrialisés tard). Rien de tel ne s’est produit en Tunisie.
3. L’emploi en Tunisie se caractérise par l’inadéquation entre les formations et les offres d’emploi de l’économie. Dès le début des années quatre-vingt et une fois la source de l’immigration plus au moins tarie, aucun effort d’adaptation de la formation professionnelle par rapport aux offres d’emploi ne fût consenti. On continua à former en fonction des capacités d’accueil des centres et de l’Université sans jamais anticiper le moins du monde sur l’évolution des besoins futurs de l’économie. Il faut dire qu’aucune prévision spécifique n’a été réalisée, non faute de moyens mais bien par manque de volonté. Cela me rappelle l’anecdote, réelle, d’un bourgeois de ma région qui acheta naguère une voiture tout en ne sachant pas bien conduire. Un jour, dans un tournant qu’il connaissant bien pourtant, il lâcha tout, freins et volant, pour crier ‘fossé, fosse’ pour s’encastrer dans ce fossé. C’est très exactement ce qui se passa pour notre politique de l’emploi. Les effectifs scolaires étaient bien connus, leur évolution aussi. On savait donc que le nombre de diplômés du supérieur allait exploser et que parallèlement les besoins de l’Education allaient diminuer. On savait aussi que la formation universitaire correspondait peu à l’évolution économique et que le mode de savoir dispensé ne permettait pas aux diplômés de s’adapter même quand ils le voulaient bien.
4. L’emploi en Tunisie se caractérise par les effets du PAS (Plan d’Ajustement Structurel). D’un côté, les rigueurs de la politique économique et financière ont conduit au rétrécissement des capacités de l’emploi dans la Fonction Publique et les entreprises nationales, de l’autre les exigences du PAS ont conduit à la déréglementation du marché du travail et la précarisation de l’emploi salarié. Ainsi et selon la Banque Mondiale elle-même, 600 000 personnes occupaient un emploi partiel en 2004 et 550 000 autres personnes occupaient un emploi saisonnier, soit 42% de l’emploi global à l’époque. On peut donc dire que le travail précaire est donc devenu un trait caractéristique du marché du travail tunisien. Les contrats à durée déterminée (CDD) représentent ainsi 41% des contrats de travail dans les industries textiles, de l’habillement, du cuir et de la chaussure (ITHCC), et 58% dans le tourisme.
5. L’emploi en Tunisie se caractérise par la prolifération du travail au noir. Ce phénomène est lié d’une part à la fragilité et au rendement du travail dans le secteur informel, d’autre part à l’accroissement du nombre de personnes pourvues d’un « second emploi » et du nombre de retraités repositionnés sur le marché du travail après leur départ à la retraite. D’aucuns ont été tentés de vite sauter le pas en faisant prévaloir une corrélation entre le double-emploi (ou l’emploi-retraite) et le taux de chômage. Pour l’heure, aucune étude sérieuse ne confirme cette corrélation.
6. L’emploi en Tunisie se caractérise désormais par une grande incertitude. A l’heure actuelle, l’impact de la situation politique et sociale sur l’emploi existant n’est pas connu. Nonobstant l’emploi dans le primaire, l’industrie non manufacturière et l’Administration qui sera altéré à un degré moindre, l’emploi dans les industries manufacturières et les services marchands (Tourisme et Transport notamment) est directement lié à la conjoncture post-14 Janvier. Quant aux créations d’emplois et dans la mesure où elles sont nécessairement dépendantes de l’évolution de cette conjoncture, nul ne saurait avancer des hypothèses plausibles. Il faudra probablement attendre le résultat des élections et les premières mesures gouvernementales pour en statuer.
Quoi qu’il en soit, notre politique de l’emploi doit être revue, dans ses buts, ses moyens et sa philosophie générale. Des éléments constitutifs de cette politique ont déjà été exposés dans le chapitre consacré à la politique du développement. D’autres le seront en conclusion de celui-ci. Il s’agit pour l’heure d’insister sur les erreurs à ne pas commettre. En effet, l’affolement et l’amalgame n’ont jamais été de bons conseils.
1. Quelle que soit la gravité de la situation, c’est le nombre d’emplois qu’il faut augmenter et non le nombre d’employés. S’agissant de la Fonction Publique et des entreprises nationales, le recrutement doit correspondre aux besoins, strictement aux besoins. En effet, l’accroissement abusif du nombre de fonctionnaires conduit à l’alourdissement de la charge fiscale qui pèse sur l’économie et sur les salariés eux-mêmes, pire à clochardiser davantage les fonctionnaires et à pérenniser le comportement malsain du « beylik ». Si l’on procède de même dans les entreprises publiques, ce sont les consommateurs qui en paient le prix (Electricité, Gaz, Transport) ou bien encore les investissements futurs de ces entreprises avec des conséquences graves sur l’emploi lui-même.
2. Il ne faut pas recourir à la préretraite. En 1986, 4507 personnes ont été mises à la préretraite pour un coût total de plus de 72 MD et non pour 12 MD comme les services du Plan l’avait prévu (ces services ont tablé sur 10.000 préretraités). Ainsi le coût unitaire s’était élevé à quelque 18.000 dinars, soit trois fois plus que le coût d’un emploi créé dans l’industrie manufacturière en moyenne. Le simple sens aurait souscrit à la nécessité de créer plus d’emplois avec cet argent. Au demeurant, notre système de retraite est financé par répartition et non par capitalisation. Le financement de la préretraite signifie donc l’alourdissement de la charge qui pèse sur les actifs cotisants et la mise en danger des équilibres financiers des régimes.
3. Il ne faut pas céder aux sirènes trompeuses du malthusianisme. Dans son ouvrage « La montée des jeunes » Alfred SAUVY donne une définition très précise du malthusianisme en notant « chaque fois que se produit une différence (il s’agit ici de la différence entre la demande de population active et l’offre d’emplois), un écart entre deux grandeurs, deux choses qui devraient être au même niveau, il y a deux façons de rétablir l’équilibre, aligner vers le haut ou vers le bas. En annonçant qu’il y a excès de quelque chose, l’optique malthusienne suggère instinctivement de niveler vers le bas ». Autrement dit, cette vision se base sur le postulat erroné que la quantité de travail est limitée. Il faut donc « partager » le travail. Or sous-entendre que le travail est limité nous renvoie à un autre postulat erroné, lui aussi : c’est celui de la saturation des besoins. On sait pourtant que les besoins ne sont pas tous satisfaits, mais les politiques économiques n’en ont cure puisqu’elles sont confortées par le vox-populi et par la force de l’apparent, éventuellement même par les syndicats et les réflexes corporatistes : trop de médecins, trop d’avocats, trop de vendeurs, trop de professeurs, etc. Alfred Sauvy disait: « le travail crée le travail». Car il n’existe de leviers essentiels pour améliorer durablement la situation de l’emploi que l’investissement, la formation, le développement régional et l’amélioration des revenus.
A l’heure actuelle, près de 180.000 chômeurs du Supérieur attendent de trouver un emploi dont près de 80% de maitrisards et de diplômés des filières courtes. Dans les prochaines cinq années, 50.000 diplômés du supérieur au moins se déverseront annuellement sur le marché du travail dont l’essentiel sera toujours composé des filières les moins aptes à l’insertion dans la vie active. Ni l’économie tunisienne, ni nulle autre économie de taille ou de niveau de développement comparable ne sont capables de résorber ce type de chômage dans le court terme. Par ailleurs, il serait irresponsable de faire croire aux diplômés du supérieur que leur problème trouverait une solution indépendamment du chômage en général. En fait, le nombre d’emplois qui pourraient être offerts aux diplômés du supérieur est dépendant du volume des emplois créés de façon globale. Dans cette perspective, l’Université, le système éducatif et la formation professionnelle nous doivent un sérieux examen de conscience. Comment ces institutions acceptent-elles de rester neutres ou passives face à l’inadaptation « professionnelle » et sociale des diplômés alors que la Nation leur octroie plus de 8% de son PIB ? Au-delà de la responsabilité des pouvoirs publics, le corps enseignant et les formateurs ont à assumer les leurs de responsabilité. Par manque d’adaptation, notre politique éducative et de formation est en train de produire des effets négatifs sur la croissance, les revenus et l’emploi.
On ne bâtit évidemment pas sur du vent. Il nous faut donc partir des réalités économiques nationales et internationales : manque de compétitivité et d’intégration de l’économie nationale, poches de résistance aux progrès et à l’amélioration de la productivité, effets de la globalisation, de la concurrence étrangère et du caractère volatil des marchés financiers, etc. Parallèlement, l’idéologie, quelle qu’elle soit, doit être bannie. C’est dans ce cadre qu’il nous faudra passer nécessairement par la création de beaucoup plus d’emplois salariés dans les régions défavorisées afin de faire « émigrer » l’emploi au lieu d’encourager l’émigration des populations (il y a une corrélation directe et significative entre le niveau de l’emploi salarié et l’emploi total dans les régions d’une part, le niveau des dépenses par personne et par an d’autre part). Sur ce plan, le « volontarisme » n’y suffira naturellement pas. Malgré tout, certains pays libéraux n’ont pas hésité à recourir à des mesures volontaristes (exemple du Général de Gaulle en France concernant le « déménagement » de l’activité industrielle du bassin parisien vers la province). C’est pour dire que dans ce domaine, ce n’est pas l’idéologie qui doit primer, mais bien l’intérêt général. Au demeurant, entre un Etat « neutre » et un Etat « omnipotent », il y a bien une marge. Au-delà des querelles idéologiques, n’importe quel observateur avisé conviendrait que rien ne peut être fait dans certaines régions de l’intérieur et du sud sans l’intervention ou la bienveillance des autorités régionales. Le nier, c’est faire preuve d’une grande mauvaise foi.
Les mesures structurelles
- L’emploi n’étant en définitive que la résultante l’activité économique, le négatif de la photo en quelque sorte, la première mesure doit viser au déblocage et ensuite l’accélération du processus du développement. Un acte politique nécessaire peut symboliser le changement de cap ainsi introduit : la création d’un Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.
- La seconde mesure concerne l’orientation de l’investissement vers les activités à haute teneur en VA. Conformément à ce qui a été noté précédemment, cette orientation nécessite la révision du code de l’investissement et du mode de financement et peut être même la redéfinition du rôle de l’Etat dans le secteur concurrentiel. Cette hypothèse ne doit pas être écartée au nom de l’idéologie, qu’elle soit libérale ou étatiste.
- La troisième mesure est d’ordre « culturel ». Jusqu’ici, l’entreprise tunisienne a été considérée par les travailleurs et l’Etat comme une vache à lait, sans plus. Or, c’est l’entreprise qui créé la richesse et l’emploi en fin de compte. L’absence d’une culture d’entreprise fait toute la différence entre une société progressive et une société régressive. Il est donc indispensable qu’au sein des entreprises, le dialogue social puisse prendre corps pour aller au-delà des considérations classiques sur le salaire ou les conditions de travail.
- Pour ce faire, il est urgent de développer et de diversifier l’information économique. Il n’est pas normal que l’école ne puisse pas dispenser une culture économique minimale et basique ni que les informations économiques soient produites uniquement par les instances officielles. Et d’ailleurs comment rendre la vie démocratique aussi pleine que possible si le citoyen n’a pas les moyens de comprendre les implications des décisions économiques et financières que le gouvernement prend en son nom.
- Le cas particulier des petites et moyennes entreprises doit être pris en considération tant au niveau du financement qu’au niveau de l’octroi des marchés de l’Etat (les deux volets étant liés au demeurant) ou bien encore au niveau de la flexibilité En effet, le développement des entreprises ne s’opère pas de façon similaire ou linéaire selon qu’il s’agisse de grandes ou de moyennes et petites entreprises. Une grande entreprise sait négocier et obtenir un allègement de ses taux d’intérêt débiteurs, mais pas une PME. A ce problème s’ajoutent le manque de fonds propres des PME ainsi que la difficulté de fournir les garanties exigées par les banques.
- Il s’en suit que le système financier doit être réformé à son tour, et ce pour insuffler à l’activité économique la dynamique qui lui manque. Pour l’heure, ce système se contente de prélever des intérêts sans trop s’impliquer outre mesure dans le processus de développement du pays.
- Toute politique de l’emploi doit intégrer à l’avenir la participation active des régions à l’aménagement du territoire et à l’essor de la politique industrielle. Sans cette participation, on continuera à créer des emplois là où le chômage est le moins virulent alors qu’il s’agit de créer des emplois là où se trouvent les taux de chômage les plus importants.
- L’amélioration de la situation de l’emploi est dépendante de notre connaissance du marché de l’emploi et de son évolution future. Il s’agit d’une part d’affiner nos données relatives à la demande d’emploi à travers la révision des taux d’activité spécifiques par sexe et âge afin de mieux tenir compte de la réserve de population active qui vient à chaque fois perturber le volume de la demande additionnelle. Il s’agit d’autre part de mieux connaître l’offre par type et niveau de qualification. Cette logique s’applique naturellement à l’échelle régionale. Sans les données recueillies par ce biais, aucune prévision n’est possible à l’heure où les incertitudes liées à la conjoncture internationale ou nationale ajoutent à la faiblesse ou à l’insuffisance de notre instrumentation statistique et de prévision.
- L’amélioration de la situation de l’emploi passe aussi par la diminution de la durée du chômage. Ceci n’est possible que si les moyens de gestion du marché de l’emploi sont réformées et si, concomitamment, la formation professionnelle réaménagée afin qu’elle puisse répondre rapidement à la demande des entreprises. La structure qui chapeaute la formation professionnelle devra donc être revue en conséquence.
- Un dernier point et des plus importants : la préparation à la vie active. Il ne faut pas le cacher, notre système éducatif ne prépare pas suffisamment à l’entrée dans la vie active et notre système de formation ne prépare pas non plus à l’entrée dans la vie professionnelle. Il faut donc engager sans tarder la préparation des « assisses nationales à l’insertion ». Université, entreprises, spécialistes, formation professionnelle, parents d’élèves et élèves eux-mêmes doivent y être invités.
Mesures conjoncturelles
- Etant donné la place qu’occupe le secteur du BTP dans l’emploi et de son impact sur les autres secteurs économiques, un programme national de construction d’édifices publics peut être proposé. A l’heure actuelle, l’Etat et les Caisses de Sécurité Sociale dépensent des sommes considérables en location de bureaux. C’est le cas aussi bien à l’échelon central que dans les régions. Pour ce faire, un « réaménagement » des crédits alloués à certains projets d’infrastructure s’impose, en raison notamment de leur moindre impact sur l’emploi.
- La seconde mesure concerne la mise en place d’équipes pluridisciplinaires à la disposition des Gouverneurs : économistes, démographes, sociologues, pédagogues, planificateurs, financiers, etc. Ces équipent doivent donc recevoir une formation complémentaires au sein de l’Université, de l’Administration centrale et des instituts et organismes publics : INS, IEQ, Normalisation, CEPEX, etc.
- Un programme national d’archivage et micro-filmage des documents administratifs, juridiques et culturels doit être mis en place. Une Nation sans histoire est une Nation perdue. Ce travail, utile, est finalement à la portée des chômeurs du supérieur pour peu que les organismes officiels spécialisés soient appelés à la rescousse.
Conclusions
Au-delà des combinaisons possibles des facteurs favorables et des conclusions des théories économiques du développement, il semble que seuls les pays ayant réussi à établir une meilleure répartition des revenus aient été à même de développer durablement une épargne suffisante pour financer leurs investissements. Dans la situation d’un pays émergeant comme le nôtre caractérisé par un grand écart de patrimoine et de revenus, l'épargne des plus nantis n’est pas nécessairement consacrée à l’investissement mais plutôt à des consommations de luxe ou exportée vers l’extérieur. Parallèlement et en raison de la politique suivie, l’épargne des classes moyennes est insuffisante pour soutenir l’effort d’investissement. D’ailleurs l'épargne ne parvient pas directement à l'investissement puisque celui-ci transite par les institutions financières qui le rendent cher et parfois même inaccessible. La politique des revenus a donc des effets directs sur l'investissement et la croissance.
Notre pays semble avoir sacrifié son processus de développement en s’inclinant devant la théorie de l’offre telle qu’est prônée par les institutions financières internationales, notamment en ce qui concerne la question de la modération salariale. L’aggravation des inégalités et le moindre bénéfice tiré de la croissance par le plus grand nombre s’expliquent essentiellement par le bas niveau des salaires minima et par la compression des salaires réels. Cette compression (il s’agit en fait d’une baisse avérée des salaires réels) n’a pas manqué d’arrêter net l’évolution du profil de la demande mesurable par la stagnation relative de l’évolution des coefficients budgétaires. De plus, le resserrement des inégalités se traduit par des opportunités de croissance fondées en partie sur le marché intérieur alors que l’accroissement des inégalités, résultat de la compression des salaires, suscite invariablement une extraversion plus grande, c'est-à-dire une croissance fondée sur l’exportation de produits à faible valeur ajoutée et à faible niveau technologique.
C’est à ce niveau que le politique doit être réintroduit dans la réflexion en cours sur les rapports dialectiques entre développement et répartition des revenus, non qu’il fût absent dans l’explicitation des déterminants que nous venons d’évoquer, mais parce que de l’avis même des instances internationales le problème de la gouvernance se pose désormais en des termes tels que les interactions entre le fonctionnement et la nature des institutions politiques d’une part, le développement et la croissance d’autre part, doivent être prises en compte quant à l’efficience comparative des processus d’une part, du niveau et des conditions de l’aide apportée par le FMI et la BM d’autre part. Autrement dit, il nous faut poser le problème de l’interaction des institutions politiques et du développement économique sur le long terme. Dans ce cadre, plusieurs facteurs politiques ont été mis en avant pour expliquer les écarts de croissance entre pays : démocratie, respect des droits de l’homme et de la propriété, instabilité politique, etc. On reste malgré tout dans une logique particulière (tronquée dirait-on) dans la mesure où les études en question ont considéré les variables institutionnelles comme des facteurs exogènes, déterminant la croissance à long terme sans être eux-mêmes influencés par les performances de l’économie. Tout indique, au contraire, que sur le long terme, le cadre institutionnel n’est pas figé et qu’il a une influence significative sur les déterminants de la croissance tout en subissant lui-même l’influence négative ou positive du développement économique. C’est très exactement le sens du postulat que nous avons retenu dès le départ en réfutant l’existence d’une primauté de l’économique sur le social. Au demeurant, les liens entre sphère politique et sphère économique relèvent d’une relation très complexe, à l’instar de ce qui se passe entre démocratie et croissance. En tout cas, si la forme des institutions semble être en elle-même préjudiciable dans certains cas à de bonnes performances économiques, les relations qu’elle entretient avec les autres déterminants politiques renversent les termes de la réflexion. La démocratie se présente ainsi comme une condition essentielle à une alternance du pouvoir et affecte, par ce biais, positivement la croissance. En même temps, et cela a certainement été le cas pour nombre de pays, l’alternance politique non maîtrisée peut conduire à l’instabilité politique, et par voie de conséquence au blocage ou au freinage du processus de développement.
En fait, les résultats des études relatives à l'influence de l'instabilité politique sur la croissance économique sont moins indécis que ceux relatifs au rôle de la démocratie. Certes, l'instabilité politique ou institutionnelle a probablement des effets négatifs sur la croissance et le développement. Certes, l'alternance politique a une influence beaucoup moins claire sur les performances économiques d'un pays. Mais au bout du compte, ce type de raisonnement est vide de sens. La démocratie et la bonne gouvernance n’ont pas à être constituées en pendant ou en appendice de la croissance et du développement. De surcroît, si la nature du régime politique peut avoir des conséquences plus au moins directes et plus au moins quantifiables, certaines ou incertaines, positives ou négatives, sur la création des richesses, l’histoire montre avec autrement plus de certitude que la nature du régime politique a des incidences incontestables, presque logiques finalement, sur la répartition des richesses produites.
Cette proposition va naturellement à l’encontre des deux idéologies dominantes du siècle qui vient de s’écouler : le marxisme et le libéralisme. En effet, les doctrines libérales et le marxisme traditionnel ont partagé au fond la même croyance que la question de l’égalité n’en est pas une puisque la dynamique économique du marché d’un côté, la logique de la lutte des classes de l’autre, auront à résoudre toutes les questions sociales. Or si l’une a échoué au niveau de la création des richesses, l’autre a au niveau de leur répartition. Nous sommes donc en droit de renvoyer dos-à-dos ces deux conceptions et de poser la question des rapports liberté/égalité à partir d’une théorie à élaborer de la justice sociale. C’est d’autant plus nécessaire que la prédiction, très violemment contestée à son époque, de Raymond ARON sur la parenté des modèles marxiste et libéral (tous deux qualifiés par lui de modèle de croissance) sonne juste et que nous ne cessons de dire ici qu’il faut mettre l’accent en priorité sur les interrelations socioéconomiques propres à un processus de développement.
Si nous considérons qu’il y a bien quatre sphères jouant pleinement dans le déblocage de notre processus de développement et de son accélération par la suite: la politique de développement, la stratégie industrielle, le système éducatif et de formation, la politique de redistribution des revenus; on conviendra aisément qu’aucune sphère n’est indépendante par rapport aux trois autres, et que toute sphère est conditionnée dans son évolution par les évolutions des autres sphères tout étant elle-même à l’origine des évolutions affectant les autres sphères. Ainsi le rendement du système éducatif est tributaire des moyens que lui accorde la redistribution des revenus (les transferts sociaux notamment), mais il dépend dans une large mesure de la répartition primaire des revenus en ce sens que la démocratisation de l’enseignement n’est pas suffisante à elle seule pour rétablir l’équité sociale, encore moins la mobilité sociale. De son côté, le processus de développement requiert l’accroissement de la productivité qui dépend tout à la fois de l’accroissement du capital par travailleur (K/L) et de l’accroissement du capital humain, lequel dépend de l’efficience du système éducatif et de l’efficience des mécanismes de répartition et de redistribution des revenus. L’intégration « développante » ne trouve donc pas ses références uniquement dans les agrégats et les indicateurs strictement économiques tel le TEI ou le contenu en importations de la demande finale, mais bien dans l’ensemble des structures structurantes (ou cognitives) et des structures structurées (ou sociales).
L’accroissement des richesses produites par un pays peut donc cohabiter avec l’élargissement de l’éventail des revenus et du patrimoine. Elle peut alors conduire à l’appauvrissement, ce qui n’est pas du tout contradictoire avec le recul concomitant de la pauvreté telle qu’elle est mesurée par la Banque Mondiale ou l’INS (à titre de comparaison, le BIT situe le taux de pauvreté en 1900 à 20,7% contre 6,7% pour l’INS). Il existe donc bien un seuil quant à la répartition primaire des revenus au-delà duquel toutes les politiques de redistribution sont inopérantes. Autrement dit, si la part des salaires dans la valeur ajoutée est faible au regard de la part de l’emploi salarié dans l’emploi total et des niveaux de productivité sectorielle, les mécanismes de redistribution des revenus conduisent invariablement à l’aggravation des inégalités sociales au lieu de les atténuer. C’est dire que la répartition équitable des richesses doit d’abord s’effectuer au niveau de la répartition primaire, sinon la redistribution ne pourra jamais prendre le relais. Notre propos va évidemment à l’encontre d’une certaine orthodoxie économique qui entend laisser les lois du marché décider seuls de la répartition primaire, mais on conviendra que l’état de déséquilibre actuel ne constitue nullement le résultat « normal » de ces lois, mais bien le résultat d’une option politique puisant ses références ailleurs que dans les réalités socioéconomiques du pays.
Si la fiscalité relève de l’importance accordée aux valeurs de citoyenneté et de solidarité par une société quelconque, elle relève aussi du choix politique quant à la cohésion sociale et à la solidarité nationale. Sur ce plan, la fiscalité constitue le moyen le plus simple et le plus efficace pour réduire les inégalités. Or notre système fiscal donne des privilèges exorbitants aux plus riches, qui paient moins d’impôts et détournent la loi à leur seul bénéfice. L’héritage « culturel » de l’ère Ben Ali est à cet égard des plus révoltants puisque ce régime a ancré l’idée que la fiscalité est une charité envers les moins bien nantis, une obligation morale pour les riches (Fonds de solidarité type 26-26 etc.), alors qu’il ne s’agit en fin de compte que d’un devoir élémentaire : payer ce qu’on doit à la collectivité. En effet, « il y a une chose pire que de payer l’impôt sur le revenu, c’est de ne pas en payer ».
Il est temps d’en finir avec des schémas de développement élaborés de façon centralisée, sans dialogue, sans la prise en compte des aspirations régionales et des déséquilibres sociaux. Notre stratégie du développement doit être démocratique, c'est-à-dire discutée à tous les niveaux, partant des régions et de leur potentialité pour aboutir à un schéma d’ensemble, cohérent et intégré. Ceci ne veut surtout pas dire que les préoccupations à l’échelle nationale doivent être minimisées, au contraire. Notre politique de développement devra donc concilier la « construction » d’un modèle en deux volets, sinon elle ne sera ni réaliste ni efficace. Elle doit pour ce faire être tournée davantage encore vers les secteurs innovants et porteurs comme les TIC, la biochimie, l’économie du développement durable, etc. Mais elle doit surtout rechercher un point d’équilibre entre les secteurs riches en emplois mais pauvres en VA et les secteurs riches en capital et en VA, mais pauvres en emplois. Le même équilibre devrait être recherché entre les investissements directement productifs et les investissements à productivité différée comme l’enseignement, la formation, la culture et la santé.
Bref, des réformes de fond, difficiles et complexes, attendent le pays. D’autres non évoquées ici sont aussi urgentes : les équilibres financiers de la sécurité sociale, la réforme hospitalo-universitaire (un vieux serpent de mer), l’aménagement territorial, les circuits de distribution, la gestion de l’eau, la politique énergétique, etc. Aucun gouvernement aussi légitime et décidée qu’il soit, ne peut les réaliser si la société tunisienne reste exagérément impatiente, totalement amorphe ou foncièrement recroquevillée sur ses acquis. Des signes avant-coureurs n’incitent pas à l’optimisme : la pauvreté des débats et des programmes politiques, le développement exacerbé des corporatismes, le particularisme régional ou professionnel, l’absence de civilité, le nihilisme et le nombrilisme. La démocratie a pour tâche de rationaliser, canaliser et tempérer ces mouvements contradictoires. On verra bien si elle en sera capable et si le régime des partis généré inévitablement par le mode de scrutin choisi constituera oui ou non un handicap insurmontable. Souhaitons qu’il n’en soit pas ainsi, sinon le pays ira tout droit dans le mur.
Habib Touhami
(1) A lire aussi :
Télécharger le texte integral de cette étude
- Ecrire un commentaire
- Commenter

Je tiens en premier lieu à féliciter Mr touhami pour la série d’articles « réformer ou mourir » dont la qualité intellectuelle et la profondeur des idées sont certaines. A propos de ce dernier volet et de la conclusion générale,il y a lieu de formuler quelques remarques : 1- La réforme de la politique de l’emploi a été appréhendée d’un point de vue beaucoup plus idéologique (théorique) qu’orientée vers un éclaircissement des futurs décideurs (pourtant première intention de l’auteur) 2- Certains aspects très particuliers à la situation du pays post révolution et actuelle ne peuvent pas s’accommoder des théories classiques néo-classiques ou modernes développées en matière de politiques d’emploi en l’occurrence la malthusienne ou keynésienne (politique d’emploi active ou passive, à tendance de réduction de la règlementation ou réglementant tous les aspects du marché du travail) 3- Malgré l’effort d’exhaustivité recherchée de nombreux éléments de réflexion ayant une incidence sur le sujet n’ont pas été suffisamment développées en l’occurrence l’exiguïté du marché tunisien, les économies concurrentielles des économies de la région du Maghreb, ainsi que la politique décalée des décideurs dont vous avez parlé avec beaucoup de réussite dont notamment la prolifération des crédits à la consommation ayant anéanti l’épargne nationale et la politique salariale ayant paralysé la consommation considérée comme le moteur du développement en l’absence des matières premières et de la fragilité des exportations. 4- Je trouve que la conclusion souffre de raccourcis préjudiciables à la compréhension de l’article tel que l’affirmation que toute les politiques s’entremêlent (éducation –formation –fiscalité- transferts sociaux… etc) sans en expliquer les relations de cause à effet ente elles 5- En tout état de cause il a été aussi agréable qu’instructif de suivre cette initiative et on en redemande

Le titre est-il bien choisi ? Et si on ne voulait pas mourir, même si on ne veut pas réformer de la manière dictée ?

C'est bien .Soit . Et la réforme de la culture , qu'en est-il ? Toujours à la traine .

Pendant une génération, il faudra se limiter à 1 enfant par couple... Pendant une génération, les universités ne devront former QUE des créateurs d'entreprises, capables d'employer des millions de "travailleurs découragés" (comptés dans la statistique des travailleurs) Googlez " travailleurs découragés" et aussi NAIRU... Voyez comme les banquiers centraux sont pervers...